Découvrez des maladies comme : hallux valgus, hémorroïdes, hépatite B, hernie discale, hernie hiatale, hernie inguinale, herpès, hypertension, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, impétigo, infarctus, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies.
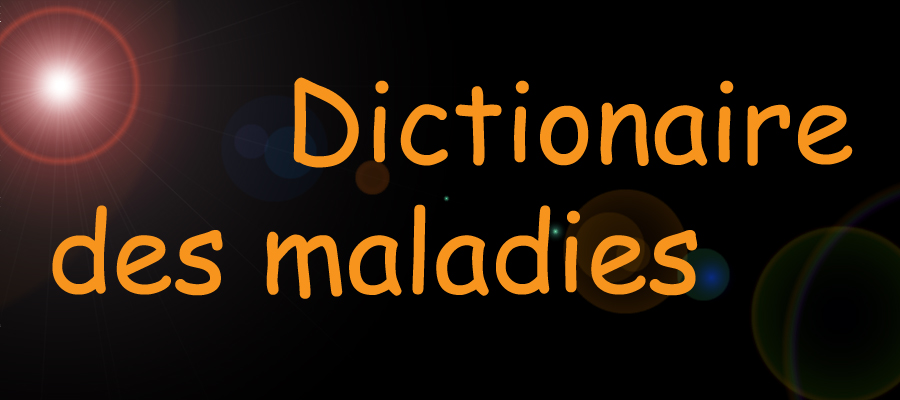
DICTIONNAIRE DES MALADIES H – I – J
La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des effets morbides qu’elle entraîne.
H – I – J
H
1033. HAAB-DIMMER (DYSTROPHIE CORNEENNE DE). Anomalie héréditaire de la cornée,
de transmission autosomique dominante. Elle est caractérisée par un réseau de
filaments situés dans la région centrale de la cornée. Elle apparaît vers l’âge
de 20 ans avec une baisse de la vison. Son évolution sera entrecoupée
d’ulcérations récidivantes et douloureuses.
1034. HABER (SYNDROME DE). Maladie cutanée génétique dont les lésions faciales
ressemblent à la rosacée, associées à des papules verruqueuses et à des
cicatrices déprimées. Una antibiothérapie par des cyclines apporte une
amélioration.
1035. HAGLUND (MALADIE DE) ou BURSITE POSTERIEURE DU TENDON D’ACHILLE.
Inflammation de la bourse située entre la peau et le tendon d’Achille au dessus
de son insertion et recouvrant la calcanéum. Ce trouble s’observe surtout chez
les femmes jeunes. Il se manifeste par une douleur au niveau du talon (talalgie)
ou l’n retrouve une petite zone inflammatoire, sensible, légèrement indurée. Le
port d’une talonnette, les anti-inflammatoires non stéroïdiens et l’infiltration
de corticoïdes apportent souvent un soulagement. En cas d’échec, une excision
chirurgicale est nécessaire.
1036. HAILEY-HAILEY (MALADIE DE ) ou (>) PEMPHIGUS CHRONIQUE BENIN FAMILIAL.
1037. HAJDU-CHENEY (SYNDROME DE). Maladie familiale osseuse rare, caractérisée
par une destruction osseuse (ostéolyse), des phalanges distales des doigts et
des orteils, qui gagne souvent les os du poignet, de la cheville et de l’avant
bras. Elle s’accompagne de malformations des vertèbres (forme biconcave) et de
malformations faciales.
1038. HALE (SYNDROME). Acronyme d’hyperplasie angiolymphoïde avec éosinophilie.
Il s’agit de formations vasculaires pseudo-tumorales inflammatoires, multiples,
localisées au niveau des oreilles, des tempes et de la face latérale du cou.
Elles sont souvent douloureuses et, parfois, associées à une hyperéosinophilie.
Le traitement est chirurgical.
1039. HALLERMAN-STREIFF-FRANÇOIS (SYNDROME DE).
Maladie génétique caractérisée par une perte de cheveux au niveau des sutures
crâniennes, un faciès d’oiseau, des anomalies oculaires et dentaires, ainsi que
parfois, un retard psychomoteur.
1040. HALLERVORDEN-SPATZ (MALADIE D’). Maladie neurologique familiale rare,
probablement de transmission autosomique récessive, caractérisée par une
atteinte dégérérative de certaines zones du cerveau qui sont envahies par des
pigments ferriques. Elle débute dans l’enfance par des troubles de la marche dus
à une hypertonie musculaire. Il existe également des troubles de la parole et de
la déglutition, des mouvements involontaires et une démence d’aggravation
progressive. Le décès survient en général dix ans après le début de la maladie.
1041. HALLGREN (SYNDROME D’). Maladie héréditaire de transmission autosomique
récessive, qui se caractérise par la survenue en général chez l’enfant, d’une
rétinite pigmentaire, laquelle aboutit, le plus souvent, à une cécité. Il existe
également une surdité congénitale, une ataxie vestibulo-cérébelleuse et une
arriération mentale. Il est parfois noté une cataracte avec un nystagmus. Ce
syndrome ressemble au syndrome de Usher (>).
1042. HALLOPEAU-SIEMENS (EPIDERMOLYSE BULEUSE DE) (>) EPIDERMOLYSES BULLEUSES
HEREDITAIRES.
1043. HALLUS VALGUS.
Définition et causes.
Déformation de l’avant pied caractérisée par une déviation en dehors du gros
orteil qui entraine la saillie interne de l’articulation métatarsophalangienne.
Les principaux facteurs favorisants sont des anomalies osseuses congéniales, un
terrain héréditaire, le port de chaussures à talons hauts.
Epidémiologie.
Affection très fréquente touchant principalement la femme.
Signes et symptômes.
Il existe des douleurs au niveau de la saillie (exostose) interne, qui se
complique d’un ‘oignon’ (hygroma), parfois ulcéré.
Investigations.
Le bilan radiologique (cliché dorsoplantaire de face en charge, incidence de
Guntz, profil interne en charge, cliché cerclé de Meary) confirme le diagnostic
et évalue les déformations.
Evolution, Complication et Pronostic.
L’évolution se fait en général vers une aggravation très handicapante pour le
port de chaussures de marche.
Traitement.
Le traitement est essentiellement chirurgical.
Prévention et Education.
Le port de chaussures larges, sans talons et les soins de pédicure sont
recommandés pour ralentir l’évolution et maintenir un bon état cutané du pied.
1044. HAMARTOCHONDROME PULMONAIRE. Tumeur bénigne pulmonaire la plus fréquente
constituée de tissu cartilagineux, musculaire et graisseux. La découverte et
fortuite sur une radiographie de thorax (nodule unique). L’image est souvent
typique au scanner et permet d’éviter une ponction biopsie. Elle peut être
extraite par simple énucléation.
1045. HAMARTOMES EPIDERMIQUES .
Tumeurs cutanées caractérisées par une hyperplasie (développement exagéré) de
l’épiderme.
1046. HAMARTOME PILAIRE . Tumeur cutanée bénigne caractérisée par l’émergence de
poils sur une zone cutane circonscrite, localisée en n’importe quel endroit du
corps.
1047. HAMARTOME SEBACE .
Définition et causes.
Tumeur cutanée bénigne, souvent congénitale, siégeant sur le cuir chevelu ou sur
la face. Pendant l’enfance il s’agit d’une plaque alopécique (sans cheveux)
ovalaire ou rosée, légèrement surélevée, de 2 à 5 cm de long dans le grand axe.
A partir de la puberté, la surface devient souvent mamelonnée verruqueuse. A
l’âge adulte, l’excision chirurgicale peut être indiquée en cas de modification
de l’aspect, du fait du risque de transformation maligne.
1048. HAMARTOME VERRUQUEUX . Tumeur cutanée bénigne, réalisant une hyperplasie
épidermique qui apparaît dans l’enfance. Les lésions unilatérales forment des
plaques ou des bandes verruqueuses grises, souvent situées sur les membres.
D’évolution indéfinie, elle récidive après une ablation chirurgicale, mais ne
dégénère pas.
1049. HAMBOURG (MALADIE DE) .
Définition et causes.
Maladie digestive infectieuse, due au germe clostridium pergringens qui secrète
une toxine à l’origine de lésions nécrotiques intestinales, prédominant au
niveau du jéjunum. Elle est due à l’ingestion de viande de porc mal cuite ou de
conserves avariées.
Epidémiologie.
Rare, De petites épidémies sont possibles. Quelques cas sporadiques sont
observés en France.
Signes et symptômes.
Elle débute brutalement par des douleurs abdominales violentes associées à des
vomissements et à un ballonnement abdominal, une fièvre et un état de choc.
Investigations.
L’examen direct et la culture du liquide interstitielle permettent le plus
souvent d’isoler le germe. La toxine peut également être mise en évidence.
Evolution, Complication et Pronostic.
L’évolution est souvent mortelle.
Traitement.
Seule la résection chirurgicale des zones nécrosées permet la guérison. Elle est
complétée par une antibiothérapie et l’administration d’un sérum antitoxine.
Prévention et Education.
La prévention nécessite le respect des règles de contrôle sanitaire, la bonne
cuisson de viande de porc et la destruction des conserves suspectes.
1050. HAMMAN-RICH (SYNDROME D’). Forme de fibrose pulmonaire interstitielle (>)
, de cause inconnue, caractérisée par une évolution aiguë et mortelle en
quelques mois.
1051. HAND-SCHÜLLER-CHRISTIAN. (SYNDROME DE). Forme particulière de
l’histiocytose X (maladie caractérisée par une prolifération des cellules de Langerhans) d’origine inconnue, qui commence le plus souvent dans la petite enfance mais peut apparaître chez les adultes. Les atteintes osseuses et pulmonaires prédominent, mais d’autres organes peuvent être atteints. Il peut également exister un diabète insipide (incapacité à concentrer les urines) et une exophtalmie. Les lésions osseuses peuvent être traitées chirurgicalement, les autres lésions nécessitent une corticothérapie ou des anticancéreux
cytostatiques en cas d’échec.
1052. HANHART (SYNDROME DE). Syndrome malformatif héréditaire, de transmission
autosomique récessive, caractérisée par l’association d’anomalies des membres
(absence en totalité ou en partie) et de la face ( petite bouche, anomalie de la
langue, fente palatine…).
1053. HANSEN (MALADIE DE) ou (>) LEPRE.
1054. HARADA (MALADIE DE) ou (>) VOGT KOYANAGI HARADA (MALADIE DE).
1055. HARTNUP (MALADIE DE).
Définition et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique récessive, due à une anomalie de
l’absorption et de l’excrétion du trytophane ainsi que d’autres acides aminés.
Epidémiologie.
Elle touche 1/24 000 naissances.
Signes et symptômes.
Association d’éruptions cutanées de type pellagre (>) au niveau des zones
découvertes, d’une ataxie cérébelleuse (débauche ébrieuse), d’un retard mental,
d troubles du caractère et d’une petite taille.
Investigations.
On retrouve un taux très élevé d’acides aminés dans les urines.
Evolution, Complication et Pronostic.
Les rechutes sont provoquées par de la fièvre, l’exposition au soleil, le stress
et les sulfamides. Le traitement prévient les poussées et le pronostic à long
terme est bon.
Traitement.
Il consiste en un régime riche en protéines et une supplémentation de vitamine
PP.
1056. HASIMOTO (THYROÏDITE DE) (>) THYROÏDITE DE HASHIMOTO.
1057. HASHIMOTO PRITZKER (MALADIE DE). Fore d’histiocytose (dysfonctionnement
des cellules de défenses de l’organisme) qui se manifeste dès la naissance, par
une éruption de nodules disséminés, fermes, indolores, de
couleur bleu-noirâtre qui se couvrent de croutes et régressent en laissant des
cicatrices atrophiques. L’évolution se fait vers une régression spontanée en
deux à trois mois.
1058. HAVERHILLOSE.
Définition et causes.
Infection due au streptobacillus moniliformis inoculé par une morsure de rat. La
période d’incubation est de 10 jours.
Epidémiologie.
Elle touche les populations défavorisées et certaines professions exposées.
Signes et symptômes.
La plaie est généralement cicatrisée lorsque débute la maladie. Les principaux
signes sont une fièvre aiguë récurrente, des frissons, des céphalées, des
vomissements, des myalgies et des arthralgies. Au bout de deux à quatre jours
débute une éruption cutanée avec une polyarthrite asymétrique.
Investigations.
La sérologie et la culture confirment le diagnostic.
Evolution, Complication et Pronostic.
Une endocardite, une pneumopathie et un méningo-encéphalite sont des
complications possibles.
Traitement.
Antibiothérapie par pénicilline G par voie intraveineuse pendant 14 jours.
1059. HECK (MALADIE DE). Maladie cutanée due aux paipillomavirus humains
également appelée hyperplasie épithéliale focale. Initialement décrite chez les
amérindiens d’Amérique du Sud et Centrale, ainsi que chez le esquimaux d’Alaska,
elle est maintenant observé dans de nombreux pays, mais reste rare dans la
population blanche. Elle est caractérisée par de multiples papules de la
muqueuse buccale, de couleur rosée, de 1 à 5 mm de diamètre et d’évolution
chronique asymptomatique icβ γ δ ε ζ es ou (>)
1060. HEERFORD (SYNDROME D’). Forme rare de sarcoïdose (>) associant une
atteinte oculaire (iridocyclite bilatérale), un état subfébrile prolongé, une
hypertrophie des glandes parotides et une atteinte nerveuse de type paralysie
faciale périphérique.
1061. HELLP SYNDROME. Complication grave de l’éclampsie (>) qui associe une
hémolyse (hemolysis), une élévation des enzymes hépatiques (elevated liver
enzymes) et une thrombopénie (low platelets). Elle impose un accouchement
imédiat. Le pronostic vital de la mère et du fœtus est engagé.
1062. HEMANGIECTASIE HYPERTROPHIQUE ou (>) PARKES WEBER (SYNDROME DE).
1063. HEMANGIOME DU FOIE.
Définition et causes.
Tumeur bénigne du foie formée de cavités vasculaires mesurant de quelques
millimètres à quelques centimètres. Dans les deux tiers des cas, les tumeurs
sont multiples. Il s’agit vraisemblablement de malformations vasculaires
congénitales.
Epidémiologie.
Il est présent dans 2 à 4 % de la population, sans prédominance de sexe.
Signes et symptômes.
Il est le plus souvent asymptomatique.
Investigations.
L’échographie, le scanner et l’IRM permettent le diagnostic.
Evolution, Complication et Pronostic.
La tolérance de l’hémangiome même volumineux est bonne. Les rares complications
sont les ruptures spontanées ou provoquées par un traumatisme, entrainant des
hémorragies intrapéritonéales.
Traitement.
Il ne nécessite aucun traitement particulier du fait de la rareté des
complications.
1064. HEMATOME EXTRADURAL
Définition et causes.
Collection sanguine située entre la dure mère et l’os qui comprime le cerveau
sous jacent. Il s’agit d’une complication d’un traumatisme crânien, en général
peu sévère. Le saignement est le plus souvent artériel (notamment des branches
de l’artère méningée moyenne).
Epidémiologie.
L’hématome extradural apparait dans 1 à 3% des traumatismes crâniens,
principalement chez l’enfant et l’adulte jusqu’à l’âge moyen de la vie.
Signes et symptômes.
Il existe souvent une brève perte de connaissance initiale, suivie d’une période
de quelques heures sans signes particuliers, appelée intervalle libre. Puis
apparaissent une obnubilation, des céphalées, enfin un coma rapidement
progressif. Parallèlement se développe un déficit moteur unilatéral, avec
souvent une mydriase du côté opposé.
Investigations.
Le scanner pratiqué en urgence, montre une image dense, collée contre l’os, en
forme de lentille (biconcave) qui refoule le cerveau.
Evolution, Complication et Pronostic.
En l’absence de traitement, le coma s’aggrave avec l’apparition de signes de
décérébration (réactions en extension inadaptées aux stimuli et la mort survient
rapidement. Si le traitement est précoce, le pronostic est bon, le plus souvent
sans séquelle.
Traitement.
Le traitement est neurochirurgical (évacuation de l’hématome).
Prévention et Education.
La surveillance systématisée des traumatisés crâniens, notamment en cas de perte
de connaissance initiale, avec la réalisation d’un scanner au moindre doute,
permet un diagnostic précoce.
1065. HEMATOME RETROPLACENTAIRE.
Définition et causes.
Séparation prématurée d’un placenta normalement implanté dans l’utérus survenant
au cours du dernier trimestre de la grossesse. Près de la moitié des hématomes
rétroplacentaires surviennent chez les patientes qui présentent une hypertension
artérielle ou une toxémie gravidique (>). Un traumatisme peut également être en
cause. Les principaux facteurs de risque sont l’âge, la multiparité, le
tabagisme, la consommation de cocaïne.
Epidémiologie.
Il complique 0,25% des grossesses.
Signes et symptômes.
Il existe une douleur abdominale brutale au niveau de l’utérus, accompagnée de saignements noirâtres. A la palpation, l’utérus est tonique, douloureux et augmenté de volume.
Investigations.
Le diagnostic est clinique dans les formes typiques. L’échographie confirme le diagnostic.
Evolution, Complication et Pronostic.
La principale complication est la mort fœtale (mortalité périnatale d 30 à 50% ). Le pronostic maternel est conditionné par le choc hypovolémique et les troubles de la coagulation sanguine (> Coagulation intravasculaire disséminée (CIVD)).
Traitement.
Si les hémorragies sont peu abondantes, si les bruits du cœur fœtaux sont normaux et si le terme est éloigné, le repos au lit est conseillé. Si les hémorragies se poursuivent ou s’aggravent, l’accouchement est indiqué, en général par césarienne.
1066. HEMATOME SOUS DURAL AIGU.
Définition et causes.
Collection de sang sous la dure mère qui comprime le cerveau sous jacent. La principale cause est un traumatisme, souvent peu sévère (chez le nourrisson, notamment), parfois plus violent (accident de la voie publique) et il peut-être alors accompagné d’autres lésions intracérébrales.
Epidémiologie.
L’hématome sous dural se rencontre principalement chez les enfants (enfants battus notamment) , les polytraumatisés et les personnes âgées.
Signes et symptômes.
Dans la plupart des cas , les signes se développent rapidement dans les minutes qui suivent l’accident. Les principaux symptômes sont une obnubilation, un coma, parfois une hémiplégie, des convulsions et une asymétrie des pupilles.
Investigations.
Le scanner permet le diagnostic. Il montre une image dense, collée contre l’os, en forme de croissance qui refoule le cerveau sous jacent.
Evolution, Complication et Pronostic.
L’évolution est variable. Elle peut évoluer avec une aggravation rapide vers la mort, en particulier dans les traumatismes graves ou il existe souvent un œdème cérébral important associé. Dans d’autres cas, un passage à la forme chronique est possible.
Traitement.
Les petits hématomes asymptomatiques nécessitent une simple surveillance. Dans les autres cas, une évacuation est le plus souvent nécessaire (ponction chez le nourrisson,, trépanation ensuite).
1067. HEMATOME SOUS DURAL CHRONIQUE.
Définition et causes.
Collection sanguine d’origine veineuse qui se constitue lentement entre la dure mère et l’arachnoïde. Un traumatisme préalable est souvent en cause, mais il peut être ancien et/ou complètement banal (se cogner la tête contre une porte) et avoir été oublié. Des facteurs prédisposants sont souvent présents : âge avancé, éthylisme chronique, traitement anticoagulant, déshydratation sévère chez le nourrisson.
Epidémiologie.
Fréquent chez la personne âgée ou la symptomatologie est souvent négligée et mise sur le compte d’une démence débutante ou s’aggravant.
Signes et symptômes.
Les signes sont souvent peu typiques et trompeurs ; céphalées fluctuantes, altération progressive des fonctions supérieures et/ ou de la conscience (somnolence, troubles de l’attention…).
Investigations.
Le scanner permet le diagnostic. Il montre une image dense, collée contre l’os,
en forme de croissant (parfois l’hématome est bilatéral avec la même image de
l’autre côté du crâne).
Evolution, Complication et Pronostic.
Une évolution brutale avec un passage à une forme aiguë est toujours possible et
peut entrainer la mort en l’absence de traitement. Une intervention
chirurgicale, même chez des patients très âgés, permet souvent une guérison sans
séquelles.
Traitement.
Une évacuation chirurgicale est le plus souvent effectuée après une correction des éventuels troubles de l’hémostase.
Prévention et Education.
La réalisation d’un scanner, au moindre doute, chez les personnes âgées, présentant des troubles neurologiques atypiques d’apparition récente, permet de détecter de manière précoce les hématomes sous duraux chroniques.
1068. HEMERALOPIE CONGENITALE ESSENTIELLE. Maladie génétique rare, de
transmission variable (autosomique dominante ou récessive, récessive liée à l’X), caractérisée par une dysfonction rétinienne non évolutive prédominant sur les bâtonnets. Le seul symptôme est le trouble de la vision nocturne (héméralopie), l’acuité visuelle étant modérément abaissée. Il n’existe pas de traitement spécifique.
1069. HEMIATROPIE FACIALE PROGRESSIVE ou (>) ROMBERG (MALADIE DE).
1070. HEMISPASME FACIAL ESSENTIEL. Syndrome caractérisée par des crises de contraction d’abord parcellaires, puis envahissant rapidement tous les muscles d’une moitié de la face. La cause est inconnue et l’évolution peut se faire sur des années. Il existe une forme secondaire à une paralysie faciale.
1071. HEMOCROMATOSE PRIMITIVE.
Définition et causes.
Maladie génétique, de transmission autosomique récessive, caractérisée par une surcharge chronique en fer qui se fixe dans les différents tissus.
Epidémiologie.
Il s’agit de la maladie héréditaire récessive la plus fréquente qui concerne 1a personne sur 300 dans les populations blanches.
Signes et symptômes.
Les signes apparaissent, en général dans la deuxième partie de la vie. Les signes classiques sont une atteinte hépatique (cirrhose), une atteinte cutanée (hyperpigmentation brun-gris), des signes endocriniens (diabète, ménopause précoce chez la femme, impuissance chez l’homme) et une atteinte articulaire (arthralgies diffuses au niveau de la main).
Investigations.
Le fer sérique, la ferritine et le coefficient de saturation de la sidérophiline sont augmentés. La biopsie hépatique est indispensable pour confirmer et quantifier la surcharge en fer.
Evolution, Complication et Pronostic.
Les eux principales complications sont le cancer du foie et l’atteinte cardiaque (insuffisance cardiaque, trouble de rythme) qui sont à l’origine d’une mortalité non négligeable. La mise en route d’un traitement précoce normalise l’espérance de vie du malade.
Traitement.
Le traitement utilise principalement les saignées. Dans certains cas, un chélateur de fer (fixation du fer et élimination biliaire ou urinaire), peut être utilisé. L’abstinence alcoolique est recommandée mais un régime pauvre en fer, nécessairement déséquilibré n’est pas souhaitable.
1072. HEMOCHROMATOSE SECONDAIRE. Surcharge en fer de l’organisme due
principalement à une hépatopathie alcoolique et à des maladies nécessitant des transfusions répétées (thalassémie, drépanocytose…).
1073. HEMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE A FRIGORE ou SYNDROME DE DONATH LANDSTEINER.
Définition et causes.
Anémie hémolytique auto-immune (>) dans laquelle la destruction des globules rouges survient quelques minutes à quelques heures après une exposition au froid localisée (lavage des mains) ou générale. La plupart des cas surviennent après une maladie virale.
Epidémiologie.
C’est une affection rare qui représente moins de 5% des anémies hémolytiques auto-immunes.
Signes et symptômes.
Il existe des douleurs du dos et des jambes avec des céphalées, des
vomissements, une diarrhée et une coloration brun foncé des urines.
Investigations.
On retrouve une hémoglobinurie, une anémie discrète et une légère augmentation
du nombre des réticulocytes. Le test de Coombs direct est positif pendant la
crise mais négatif en dehors. Le test de Donath landsteiner met en évidence des
anticorps particuliers.
Evolution, Complication et Pronostic.
L’évolution est habituellement favorable après les premiers jours, souvent
dramatiques.
Traitement.
Il consiste à éviter strictement l’exposition au froid. Les immunosuppresseurs
peuvent être efficaces dans les formes prolongées.
1074. HEMOGLOBINURIE PAROXYSTIQUE NOCTURNE ou (>) MARCHIAFAVA MICHELI (MALADIE
DE).
1075. HEMOPHILIE.
Définition et causes.
Maladie hémorragique héréditaire, de transmission autosomique récessive liée au
chromosome X, due à un déficit en facteur VIII (hémophilie A, 80% des cas) ou en
facteur IX (hémophilie B, 20% des cas).
Epidémiologie.
Seuls les hommes sont touchés : 1/ 5 000 naissances pour l’hémophilie A et 1/ 30
000 naissances pour l’hémophilie B.
Signes et symptômes.
Il existe des hémorragies dès le plus jeune âge pour des traumatismes minimes :
hématomes, hémarthroses (épanchements articulaires sanglants)…
Investigations.
Le diagnostic repose sur le dosage des facteurs VIII et IX (lorsque le taux est
supérieur à 1% , la maladie est grave).
Evolution, Complication et Pronostic.
Le risque permanent d’hémorragies graves conditionne le diagnostic. De très
nombreux hémophiles on été contaminés par le VIH et les virus hépatites B et C.
L’apparition chez certains malades d’anticorps inhibiteurs du facteur VIII ou IX
peut compliquer le traitement.
Traitement.
Il repose sur l’administration de facteur VIII ou IX par voie veineuse. Dans
l’hémophilie A, la desmopressine peut être également utilisée pour prévenir et
traiter des hémorragies.
Prévention et Education.
Tout hémophile doit être porteur d’une carte indiquant la conduite à tenir en
cas d’accident (avec les coordonnées du centre référent). L’éducation des
parents hémophiles à l’évitement des traumatismes, à l’auto-traitement
(précocité du traitement, mise en place d’une perfusion de facteur VIII ou IX)
et à l’auto-prévention (entretien de la force musculaire, pratique du sport en
milieu associatif, prise de risque mesurée) est indispensable.
1076. HEMOPTYSIE.
Définition et causes.
Rejet par la bouche de sang provenant des voies aériennes sous glottiques. Les
causes sont soient pulmonaires ‘cancer bronchique primitif, tuberculose
pulmonaire, dilatation des bronches, infections bronchiques, pneumopathies
infectieuses), soit cardiovasculaires (embolie pulmonaire, rétrécissement mitra
malformations vasculaires pulmonaires), soit traumatiques au niveau du thorax.
Epidémiologie.
C’est une affection assez fréquente.
Signes et symptômes.
Ce sont des crachats sanglants qui doivent être distingués d’une hématémèse ou
d’un saignement des voies aériennes supérieures.
Investigations.
Elles comprennent radiographie du thorax, fibroscopie bronchique, scanner,
scintigraphie et angiographie pulmonaire.
Evolution, Complication et Pronostic.
En cas de grande abondance, il existe u risque d’inondation alvéolaire et de
détresse respiratoire plus ou moins associés à un collapsus cardiovasculaire.
Traitement.
Il associe traitement symptomatique, en particulier avec les vasoconstricteurs
et traitement de la cause.
1077. HEMORRAGIE DE BENCKISER.
Définition et causes.
C’est une hémorragie fœtale par dilacération d’un ou de plusieurs vaisseaux
ombilicaux insérés sur les membranes. Elle survient lors de la rupture de la
poche des eaux.
Epidémiologie.
Elle complique 1 grossesse sur 3 00 à 5 000.
Signes et symptômes.
Elle se manifeste par un saignement indolore lors de la rupture des membranes,
sans modification de l’état maternel mais avec une souffrance fœtale immédiate.
Evolution, Complication et Pronostic.
Le risque fœtale est majeur, avec une mortalité de 50 à 100% .
Traitement.
La seule solution est l’extraction la plus rapide possible du fœtus par
césarienne.
1078. HEMORRAGIE DE LA DELIVRANCE OU DU POST PARTUM.
Définition et causes.
Pertes sanguines anormalement importantes prenant origine au niveau de la zone
d’insertion du placenta et survenant dans les 24 heures qui suivent
l’accouchement. Les causes sont une rétention placentaire, une inertie utérine
ou des troubles de la coagulation.
Epidémiologie.
Elle reste une complication grave de l’accouchement, responsable d’une part non
négligeable de la mortalité maternelle.
Signes et symptômes.
Que le placenta soit sorti ou non, il existe une hémorragie extériorisée
indolore ou un utérus mou et flasque dont la pression fait sortir un flot de
sang. Le pouls accéléré, la pression artérielle pincée et des malaises sont des
signes de rétention hémodynamique.
Investigations.
Elles sont inutiles.
Evolution, Complication et Pronostic.
En l’absence de traitement, le décès est certain. En cas de troubles de
coagulation, la mortalité reste élevée malgré le traitement.
Traitement.
Initialement, une délivrance artificielle ou une révision utérine associée aux
ocytociques assurent une bonne rétraction utérine. En cas d’échec, le traitement
chirurgical s’impose (ligatures des artères hypogastriques, hystérectomie,
embolisation des artères utérines).
Prévention et Education.
La prévention consiste à effectuer une révision utérine en cas de placenta
incomplet et une délivrance artificielle dans certaines situations à risque.
1079. HEMORRAGIE DIGESTIVE BASSE.
Définition et causes.
Emission de sang rouge par l’anus dont les principales causes sont les
pathologies anales ou coliques qui peuvent léser les vaisseaux de la muqueuse.
Une hémorragie digestive haute très abondante peut donner également du sang
rouge par l’anus, mais il existe alors en général un retentissement
hémodynamique (tachycardie et chute de la pression artérielle) et la sonde
gastrique ramène du sang rouge.
Epidémiologie.
L’incidence des hémorragies digestives est de 1/ 1 000 habitants. Elles
représentent une des principales urgences digestives.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont liés au retentissement hémodynamique et à l’existence
d’une éventuelle irritation péritonéale (douleurs, abdomen sensible ou tendu).
Investigations.
La recherche de la cause utilise l’anuscopie, la coloscopie, l’artériographie en
période hémorragique ou la scintigraphie aux hématies marquées (en cas de
faibles saignements).
Evolution, Complication et Pronostic.
En cas d’hémorragie abondante, un choc hypovolémique est possible.
Traitement.
Il comprend la compensation d’hypovolémie et de l’anémie, ainsi que le
traitement de la cause par une électrocoagulation au cours de l’endoscopie, une
embolisation au cours de l’artérioscopie ou la chirurgie.
Prévention et Education.
La prévention consiste dans le dépistage et le traitement des facteurs de
risque, en particulier les polypes colorectaux.
1080. HEMORRAGIE DIGESTIVE HAUTE.
Définition et causes.
Hémorragie dont le siège est œsophagien, gastrique ou duodénal. Les causes
principales sont l’ulcère duodénal ou gastrique, les varices œsophagiennes et
les tumeurs.
Epidémiologie.
L’incidence des hémorragies digestives est de 1/ 1 000 habitants. Elles
représentent une des principales urgences digestives.
Signes et symptômes.
L’hémorragie est extériorisée dans 80% des cas et se traduit par une hématémèse,
le plus souvent, ou un méléna (émission de sang noir par l’anus) ou encore une
rectorragie (émission de sang rouge par l’anus). Dans les autres cas, les signes
d’anémie aiguë prédominent (pâleur tachycardie, chute tensionnelle, malaise ou
état de choc).
Investigations.
La fibroscopie après lavage gastrique permet de retrouver la cause de
l’hémorragie. Elle est éventuellement complétée par une angiographie en cas
d’échec et de persistance de l’hémorragie.
Evolution, Complication et Pronostic.
L’hémorragie cataclysmique avec choc hypovolémique est le principal risque. Le
pronostic est lié au terrain ; il est mauvais en cas de cirrhose évoluée.
Traitement.
Il associe compensation de l’hypovolémie et de l’anémie ainsi qu’un traitement
de la cause par endoscopie, par vasoconstricteur (terlipressine ou
somatostatine) ou sonde d’hémostase en cas d’ avarices œsophagiennes, par
chirurgie ou par embolisation artérielle.
Prévention et Education.
Les règles de prescription des médicaments gastro-toxiques, notamment les
anti¬inflammatoires non stéroïdiens, doivent être respectés. Les bêtabloquants
préviennent en cas de rupture des varices œsophagiennes.
1081. HEMORRAGIE MENINGEE NON TRAUMATIQUE.
Définition et causes.
Saignement dans les espaces sous arachnoïdiens dû, dans 80% des cas, à la
rupture d’un anévrisme intracrâniens. L’hypertension artérielle est un facteur
favorisant.
Epidémiologie.
3 000 cas/an en France (6 à 8% des accidents vasculaires cérébraux). Elle est
rare avant 15 ans et l’incidence augmente avec l’âge.
Signes et symptômes.
Le début est brutal, parfois à la suite d’un effort,, avec une céphalée intense,
continue, inhabituelle, avec des vomissements, une obnubilation et une
agitation. Ensuite s’installe un syndrome méningé subfébrile (> Méningite)
accompagné d’une tachycardie et d’une élévation de la pression artérielle.
Investigations.
Le scanner détecte la présence de sang et évalue l’importance de l’hémorragie.
S’il est négatif et en l’absence de contre indication, la ponction lombaire est
indiquée et montre un liquide uniformément rosé ou rouge. L’artériographie
permet la détection de l’anévrisme
Evolution, Complication et Pronostic.
La récidive du saignement est fréquente dans les mois suivants. La mortalité est
de 30% à la phase initiale et il existe des séquelles dans un tiers des cas.
Traitement.
Le traitement médical associe contrôle de la pression artérielle et prévention
du vasospasme par un inhibiteur calcique. Le traitement de l’anévrisme (ligature
ou embolisation) se fait soit par chirurgie classique, soit par voie vasculaire.
1082. HEMORROÏDES.
Définition et causes.
Dilatation, à types de varices, des veines du plexus hémorroïdal (veines de
l’anus et du rectum). Les principaux facteurs sont les troubles du transit.
Epidémiologie.
Très fréquent.
Signes et symptômes.
La plupart du temps elles sont asymptomatiques. Les signes habituels sont des
saignements habituellement après la défécation, qui tachent le papier
hygiénique, des masses molles palpables au niveau de l’anus (protrusion ou
procidence) et de douleurs.
Investigations.
Un examen proctologique avec rectoscopie est nécessaire pour éliminer une autre
pathologie (cancer, rectocolite hémorragique…).
Evolution, Complication et Pronostic.
La principale complication est la thrombose hémorroïdaire aiguë avec des
douleurs violentes et des paquets hémorroïdaire durs et augmentés de volume.
Traitement et Prévention.
La thrombose hémorroïdaire est traitée par des antalgiques et des
anti-inflammatoires ou par une incision chirurgicale. Le traitement de fond
utilise : la régulation du transit, des suppositoires ou des pommades améliorant
la circulation veineuse, des injections sclérosantes, le laser, la ligature
élastique et la chirurgie en cas de procidence majeure ou d’accidents aigus à
répétition.
1083. HEMOSIDEROSE PULMONAIRE IDIOPATHIQUE. Maladie rare de cause inconnue,
caractérisée par des épisodes d’hémorragies pulmonaires dont la cause est
inconnue. Elle atteint le plus souvent, les jeunes enfants, mais peut se voir
chez l’adulte. La biopsie pulmonaire montre des dépôts caractéristiques. La
gravité et l’évolution sont variables. En cas d’évolution chronique, une fibrose
avec une insuffisance respiratoire ainsi qu’une anémie chronique se développent.
La mort peut venir par hémoptysie massive.
1084. HEPATITE ALCOOLIQUE AIGUË.
Définition et causes.
Souffrance hématique compliquant une intoxication alcoolique aiguë, souvent
massive. Elle survient sur un fond de stéatose (accumulation de graisses dans
les cellules hépatiques), voire sur une cirrhose déjà présente.
Epidémiologie.
Sa fréquence est directement liée à celle de l’alcoolisme.
Signes et symptômes.
Elle peut être asymptomatique et découverte lors d’une hospitalisation pour une
autre complication de l’alcoolisme. Dans la forme typique, on retrouve une
fièvre, une hépatomégalie douloureuse et un ictère.
Investigations.
Les examens biologiques montrent une élévation des transaminases et des γ-Gt. En
fonction du degré d’insuffisance hépatique, le taux de prothrombine, de facteur
V et d’albumine est plus ou moins diminué. La biopsie hépatique fait le
diagnostic (stéatose, infiltrat inflammatoire et présence de corps de Malory.
Evolution, Complication et Pronostic.
Les principales complications sont des troubles de la conscience (>
Encéphalopathie hépatique), une hémorragie digestive, voire pancréatite. Dans
les formes sévères avec une encéphalopathie, la mortalité à court terme atteint
50%. A long terme, le pronostic dépend de l’arrêt de l’intoxication éthylique.
Traitement.
Il comprend l’arrêt de l’alcool, le repos et la rééquilibration
hydro-électrolytique. Tout médicament hépatotoxique doit être arrêté. Dans
certains cas les corticoïdes ont un intérêt.
Prévention et Education.
La lutte contre l’alcoolisme est la base de la prévention. Le sevrage de
l’intoxication pemet d’éviter les récidives et d’obtenir une régression de
l’atteinte hépatique si le stade de cirrhose n’est pas encre atteint.
1085. HEPATITE MEDICAMENTEUSE OU TOXIQUE AIGUË.
Inflammation du foie liée à la prise d’un médicament ou d’un toxique, similaire
à l’hépatite alcoolique aiguë. Les signes régressent à l’arrêt de la prise du
médicament ou du toxique, mais la récupération peut être longue. Dans certains
cas, heureusement exceptionnels, l évolution peut entre très rapide-on parle
d’hépatite fulminante-avec une destruction complète du foie souvent mortelle :
dans ce cas la seule chance de sauver le patient est une greffe du foie en
urgence, malheureusement pas toujours possible.
1086. HEPATITE VIRALE A.
Définition et causes.
Infection du foie par le virus de l’hépatite A (VHA), transmis par voie
orofécale (eaux et aliments contaminés par des matières fécales, coquillages,
crustacés). L’incubation est de 15 à 45 jours.
Epidémiologie.
15000 cas/ an en France. Elle survient en général dans l’enfance ou chez le
jeune adulte. De petites épidémies existent dans les collectivités (crèche,
école…) et la transmission est de plus en plus fréquente au cours des voyages.
Signes et symptômes.
L’infection aiguë passe la plupart du temps inaperçue chez l’enfant et est
symptomatique dans plus de deux tiers des cas chez l’adulte. L’évolution se fait
en trois phases :
• Phase pré-ictérique durant 1 semaine, avec un syndrome pseudogrippal.
• Phase ictérique durant deux semaines, avec une asthénie intense.
• Phase de convalescence durant de deux à six semaines, voire plus, avec la
disparition progressive des signes, mais une asthénie prolongée possible.
Investigations.
Elle comprend un bilan hépatique et le sérodiagnostic.
Evolution, Complication et Pronostic.
La guérison spontanée est constante sauf dans la forme fulminante (1/ 10 000
cas). Il n’y a pas de forme chronique.
Traitement.
Il se limite au repos. La transplantation hépatique est indiquée dans les formes
fulminantes.
Prévention et Education.
La prévention comporte les mesures d’hygiène (lavage des mains, précaution avec
les crudités et les coquillages) et la contamination (pour les voyageurs et
certaines professions à risque).
1087. HEPATITE VIRALE B.
Définition et causes.
Infections par le virus de l’hépatite B (VHB), transmis par voie sanguine,
sexuelle et salivaire, dont la gravité est due à la forme chronique avec le
risque de transformation en cirrhose et de cancérisation. L’incubation est de 30
à 180 jours.
Epidémiologie.
300 millions de personnes sont porteuses chroniques dans le monde. En France la
prévalence est de 1% de la population avec 200 000 à 300 00 porteurs chroniques
du virus. Le nombre de décès annuels liés à l’hépatite B est d’envions 1 000
personnes.
Signes et symptômes.
Seules 10 à 25% des fromes aiguës sont symptomatiques, avec un tableau identique
à celui de l’hépatite A. La forme chronique se manifeste soit comme une
prolongation d’une forme aiguë, soit est découverte devant une asthénie, un
subictère, un amaigrissement ou des signes extra-digestifs (périartérite
noueuse, atteinte articulaire…).
Investigations.
Elles comprennent un bilan hépatique et le sérodiagnostic. La biopsie et la
recherche d’ADN viral sont indiquées dans la forme chronique.
Evolution, Complication et Pronostic.
Une forme fulminante se déclare dans 1/ 1 000 cas. La guérison survient dans 90%
des cas, mais dans 10% des cas, il y a un passage à la forme chronique.
L’évolution de la forme chronique active fait toute la gravité de la maladie
avec transformation en cirrhose et cancérisation : au total, vingt à trente ans
plus tard, 10 000 infections entraineront 45 carcinomes hépatiques.
Traitement.
Dans l’hépatite chronique active, l’interféron alpha ou encas de contre
indication ou d’échec, des antiviraux comme la lamivudine induisent des réponses
prolongées chez environ 20% des patients. En cas d’hépatite fulminante et
d’hépatite chronique au stade terminal, la transplantation est indiquée avec une
survie à 3 ans de plus de 60%.
Prévention et Education.
La sécurité transfusionnelle, la vaccination, la prévention de la contamination
périnatale, l’usage de préservatif et l’abandon du partage de seringue sont les
principales mesures utiles.
1088. HEPATITE VIRALE C.
Définition et causes.
Infection par le virus de l’Hépatite C (VHC), transmise par voie sanguine
(transfusions, hémophiles, toxicomanes, hémodialysés, transmission sexuelle ou
maternofoetale possibles, mais rares) dont la gravité est due à la forme
chronique, avec le risque de transformation en cirrhose et de cancérisation.
L’incubation est de 30 à 100 jours.
Epidémiologie.
500 000 à 1 million de personnes infectées en France (dont plus de 50% de
porteurs chroniques).
Signes et symptômes.
Seules 5 à 10% des formes aiguës sont symptomatiques avec un tableau identique à
celui de l’hépatite A. La forme chronique est également souvent asymptomatique
ou se présente sous la forme d’un ictère, d’une hépatomégalie, d’angiomes
stellaires ou de signes d’hypertension portale.
Investigations.
Elles comprennent un bilan hépatique, le sérodiagnostic et une biopsie
hépatique.
Evolution, Complication et Pronostic.
10 000 sujets infectés donneront plus de 5 000 formes chroniques, puis 1 000
cirrhoses dans un délai de vingt ans et enfin 200 carcinomes dans un délai de
dix ans, avec évolution vers une cirrhose.
Traitement.
L’association interféron alpha et ribavirine représente un progrès majeur avec
un taux de rémission initial supérieur à 50%, mais des essais sont encore
nécessaires pour confirmer la persistance de ces résultats à moyen et long
terme.
Prévention et Education.
La prévention repose sur la sécurité transfusionnelle.
1089. HEPATITE VIRALE D. Infection par le virus de l’Hépatite D (VHD), transmise
par voie sanguine ou sexuelle, nécessitant la présence du VHB pour se
développer. L’incubation est de 45 jours à 180 jours. Il s’agit d’une
co-infection avec le VHB ou d’une surinfection d’un porteur chronique du VHB.
Elle affecte presque exclusivement les toxicomanes. Il existe une hépatite
fulminante dans 10% des cas. Le passage à la chronicité est de 80% lors d’une
surinfection, avec une évolution rapide vers la cirrhose.
1090. HEPATITE VIRALE E. Le virus a été découvert en 1900. La transmission est
orofécale. Elle est présente en Afrique et en Asie (épidémies). C’est une
hépatite sans forme chronique, dont le tableau clinique initial est similaire à
celui de l’hépatite A (>). En revanche l’hépatite E est une maladie aiguë grave
: la mortalité (formes fulminantes) est de 1-2% et, chez la femme enceinte, peut
atteindre 10-20% (d’autant plus que l terme est proche), sans que l’on sache
pourquoi. Le traitement se limite au repos (interdiction au paracétamol et tout
autre médicament toxique pour le foie comme pour toutes les hépatites). La
guérison sans séquelles, après un délai variable est de règle. Dans les formes
fulminantes, la transplantation en urgence est possible. Il n’existe ni
sérodiagnostic, ni traitement, ni vaccination. La prévention repose sur les
mesures d’hygiène.
1091. HEPATOBLASTOME. Tumeur embryonnaire du foie observée dans la plupart des
cas avant l’âge de 3 ans. La sécrétion d’alpha foetoprotéine permet de confirmer
le diagnostic et de suivre l’évolution. Le traitement associe chimiothérapie te
chirurgie (dans quelques cas, il faut envisager une transplantation hépatique).
La survie sans récidive est de 65 à 70%.
1092. HEPATOCARCINOME.
Définition et causes.
Tumeur maligne primitive du foie développée à partir des hépatocytes. Dans 9 cas
sur 10, elle se développe sur une cirrhose (post hépatique, alcoolique). Une
autre cause relativement fréquente est l’hémochromatose.
Epidémiologie.
L’incidence annuelle est d’environ 20 à 30 cas par million d’habitants (près de
20 fois inférieurs aux métastases hépatiques). Il est beaucoup plus fréquent en
Afrique noire et en Asie. Ce cancer affecte principalement des hommes entre 40
et 50 ans.
Signes et symptômes.
Lorsque la tumeur est de petite taille, les symptômes sont absents. Les signes
les plus fréquents sont des douleurs de l’hypocondre droit, un amaigrissement et
parfois, une décompensation de la cirrhose avec un ictère et une ascite.
Investigations.
L’échographie et le scanner, complétées par la biopsie, assurent le diagnostic.
L’élévation de l’alpha-foetoprotéine au dessus de 400 μg/ L est très
significative.
Evolution, Complication et Pronostic.
Le pronostic est mauvais et les traitements décevants, avec de multiples
récidives. Seule la transplantation en cas de tumeur unique de petite taille
donne de très bons résultats ; malheureusement la découverte se fait rarement à
ce stade et le nombre de greffons est limité.
Traitement.
Les quatre méthodes utilisées sont la résection chirurgicale, l’alcoolisation
par injection d’éthanol à l’intérieur de la tumeur, l’embolisation par injection
d’anticancéreux dans le territoire artériel de la tumeur et la transplantation
hépatique.
Prévention et Education.
La prévention de l’hépatocarcinome est celle de la cirrhose : limitation de la
consommation d’alcool, puis abstinence, vaccination contre l’hépatite B,
contrôle des produits sanguins…
1093. HEPATORENAL (SYNDROME) ou (>) SYNDROME HEPATORENAL
1094. HEREDO-ATAXIE CEREBELLEUSE. Maladie neurologique héréditaire, de
transmission autosomique dominante, qui apparaît chez l’adulte jeune et qui est
due à une atrophie des lobes latéraux du cervelet. Elle est caractérisée par une
absence de coordination des mouvements, une démarche ébrieuse et spastique, des
troubles de la parole, un nystagmus, des réflexes ostéotendineux très vifs et un
signe de Babinski. L’évolution est très lente mais aboutit à une infirmité
complète.
1095. HERLITZ (EPIDERMOLYSE BULLEUSE DE) (>) EPIDERMOLYSES BULLEUSES
HEREDITAIRES.
1096. HERMANSKY PUDLAK (SYNDROME DE). Association d’un albinisme (>) oculaire et
cutané, et d’un syndrome hémorragique dû à une anomalie de l’agrégation des
plaquettes.
1097. HERMAPHRODISME. Affectio très rare définie par la coexistence de tubes
séminifères et d’ovocytes, soit dans la même gonade (ovotestis), soit avec deux
gonades distinctes (testicule du côté droit, ovaire de l’autre). Les organes
génitaux externes sont ambigus, tous les intermédiaires possibles existent entre
les morphotypes masculin et féminin. Le caryotype est XX dans 9 cas sur 10. Le
sexe choisi pour l’éducation de l’enfant est le plus souvent féminin et un
traitement hormonal complété par la chirurgie est mis en œuvre.
1098. HERNIE CRURALE OU FEMORALE.
Définition et causes.
Passage d’un diverticule du péritoine, pouvant contenir des viscères, au travers
de l’orifice crural au niveau de l’aine. Il s’agit d’une hernie de faiblesse au
niveau de l’anneau crural qui apparaît souvent à la suite d’efforts de toux ou
du port d’une charge lourde.
Epidémiologie.
L’hernie crurale est beaucoup plus rare que la hernie inguinale et se rencontre
dans 75% des cas chez la femme.
Signes et symptômes.
Il existe une tuméfaction à la racine de la cuisse, en dedans des battements de
l’artère fémorale, indolore, le plus souvent réductible, impulsive et expansible
à la toux. Parfois son volume est peu important et elle peut passer inaperçue,
en particulier chez les patients obèses.
Investigations.
Le diagnostic est clinique
Evolution, Complication et Pronostic.
La principale complication est l’étranglement qui se manifeste par une douleur
vive et une irréductibilité de la hernie. Il nécessite un geste chirurgical
immédiat. Lorsque l’intestin est inséré, il existe une occlusion par
strangulation qui évolue rapidement vers une nécrose et une perforation.
Traitement.
Il est chirurgical et systématique du fait du risque d’étranglement.
Prévention et Education.
La prévention des récidives implique l’interdiction du port de charges lourdes.
1099. HERNIE DIAPHRAGMATIQUE CONGENITALE.
Définition et causes.
Malformation congénitale caractérisée par une absence de fermeture du
diaphragme, le plus souvent à gauche, avec ascension dans le thorax d’une partie
du gobe digestif.
Epidémiologie.
C’est une affection non exceptionnelle dont le diagnostic échographique
anténatal est possible.
Signes et symptômes.
Il existe une détresse respiratoire dès la naissance, avec un silence
auscultatoire dans un hémithorax, un déplacement des bruits du cœur et un
abdomen plat. Parfois les signes s’installent quelques jours plus tard, lorsque
les viscères ne passent que progressivement dans le thorax.
Investigations.
La radiographie du thorax permet le diagnostic.
Evolution, Complication et Pronostic.
La détresse ventilatoire impose la mise sous ventilation assistée en salle
d’accouchement. Le pronostic est sévère avec une mortalité élevée.
Traitement.
Il est chirurgical et précoce.
Prévention et Education.
En cas de diagnostic anténatal, l’accouchement se fera à proximité d’un service
de chirurgie adapté.
1100. HERNIE DIAPHRAGMATIQUE TRAUMATIQUE.
Définition et causes.
Lésion du muscle diaphragmatique permettant le passage de viscères abdominaux
dans la cage thoracique Les ruptures surviennent dans le cadre d’un
polytraumatisme et les plaies sont liées à des lésions thoraco-abdominales
pénétrantes (arme blanche…). La hernie de la coupole gauche est la plus
fréquente (80%).
Signes et symptômes.
Il faut y penser devant tout polytraumatisé thoraco-abdominal présentant de
signes abdominaux (douleurs vomissements) et respiratoires (dyspnée, cyanose,
hoquet). L’auscultation peut révéler des bruits hydro-aériques dans l’hémisphère
gauche.
Investigations.
La radiographie du thorax peut montrer la présence de tout pu partie de
l’estomac dans l’hémithorax gauche avec l’aide d’une sonde radio-opaque).
Evolution, Complication et Pronostic.
Cette lésion peut aggraver l’état respiratoire et hémodynamique d’un patient
dont l’état de bas est déjà précaire. Parfois, la lésion n’est découverte qu’à
distance, car certaines hernies diaphragmatiques sont bien tolérées.
Traitement.
Il est chirurgical.
1101. HERNIE DISCALE.
Définition et causes.
Détérioration du disque intervertébral entrainant une saillie du noyau central
(nucleus pulposus) par rupture de l’anneau fibreux assurant la stabilité du
disque. L’origine du disque est une dégénérescence liée à l’âge et facilitée par
les traumatismes (chute, effort de soulèvement, port de lourdes charges…). Dans
la plupart des cas, l’atteinte se situe au niveau du rachis lombaire bas (L5,
S1), plus rarement elle concerne le rachis cervical. La principale conséquence
est une compression d’une racine nerveuse à la sortie du canal rachidien.
Epidémiologie.
Très fréquent. Globalement, le ‘mal de dos’ est une des principales causes
d’arrêt de travail.
Signes et symptômes.
Le principal signe est une douleur dans le territoire du nerf irrité (>
sciatique, Lumbago aigu).
Investigations.
Les radiographies du rachis montrent, en général, un pincement du disque ; Le
scanner et l’IRM permettent de visualiser le disque.
Evolution, Complication et Pronostic.
La principale complication est une souffrance du nerf qui entraine des signes de
déficit neurologique (moteur ou sensitif) et qui nécessite un traitement rapide.
Traitement.
Le repos au lit, les antalgiques et les anti-inflammatoires sont en général
suffisants pour soulager le patient au cours de la crise. En cas d’échec ou de
complication, une nucléolyse (dissolution du noyau par injection d’un produit
chimique) ou une intervention chirurgicale de décompression sont indiquées.
Prévention et Education.
L’éducation du patient, avec pour objectif de limiter les contraintes sur le
rachis ( école du dos) ; est très importante pour prévenir la récidive de crises
aiguës..
1102. HERNIE HIATIALE .
Définition et causes.
Passage intermittent ou permanent d’une partie de l’estomac à travers l’orifice
œsophagien du diaphragme. La cause exacte est inconnue, mais elle est favorisée
par l’obésité et les déformations du thorax et du rachis.
Epidémiologie.
Elle toucherait près du quart de la population de plus de 60 ans.
Signes et symptômes.
Elle est souvent asymptomatique. Le signe le plus fréquent est le pyrosis
(brulure partant de l’épigastre et remontant l’œsophage jusqu’à la gorge avec un
renvoi du liquide acide et brulant).
Investigations.
La biopsie permet de reconnaître la hernie et d’évaluer l’état de la muqueuse
œsophagienne ( le transit baryté est de moins en moins employé). La pHmétrie
œsophagienne permet de quantifier le reflux.
Evolution, Complication et Pronostic.
La première complication est l’œsophagite par reflux de liquide gastrique acide
avec le risque d’ulcère et d’hémorragie digestive. Un étranglement de la hernie
est également possible et se traduit par des douleurs, une intolérance gastrique
et/ ou des signes respiratoires.
Traitement.
Le traitement médical utilise les antisécrétoires (anti H2 ou inhibiteurs de la
pompe à protons), les stimulants de la motricité œsophagienne et les protecteurs
de la muqueuse œsophagienne. Le traitement chirurgical est indiqué en cas
d’œsophagite récidivante et dans les formes avec un risque d’étranglement.
Prévention et Education.
La prévention de l’œsophagite, comprend des règles hygiéno-diététiques
(amaigrissement en cas d’obésité, évitements des postures déclenchantes et des
vêtements comprimant l’abdomen, suppression des aliments irritants, repas léger
le soir, buste surélevé pendant la nuit…).
1103. HERNIE INGUINALE.
Définition et causes.
Passage d’un diverticule du péritoine, pouvant contenir des viscères, au travers
de l’orifice inguinal au niveau de l’aine. La cause est une faiblesse de la
paroi abdominale congénitale ou acquise. Chez l’homme, la forme la plus
fréquente suit le cordon spermatique et se développe vers les bourses. Chez la
femme, la hernie accompagne le ligament rond et se développe vers la grande
lèvre.
Epidémiologie.
La forme congénitale se rencontre chez le nourrisson, l’enfant, l’adolescent, ou
l’adulte jeune chez lequel elles se révèlent souvent à l’occasion d’un effort
sportif. La forme acquise touche surtout l’homme après la cinquantaine.
Signes et symptômes.
Il existe une tuméfaction de l’aine indolore, augmentant de volume à la toux ou
à une pression ferme de l’abdomen. Il est possible de la réintégrer dans
l’abdomen avec le doigt.
Investigations.
Le diagnostic est clinique.
Evolution, Complication et Pronostic.
La principale complication est l’étranglement qui se manifeste par une douleur
vive et une irréductibilité de la hernie. Il nécessite un geste chirurgical
immédiat. Lorsque l’intestin est intéressé, il existe une occlusion par
strangulation qui va rapidement évoluer vers une nécrose et une perforation.
Traitement.
Il est chirurgical et ne se discute que chez le nourrisson (possible guérison
spontanée avant l’âge de deux ans) et chez le vieillard comportant un état
général mauvais.
Prévention et Education.
La prévention des récidives, en particulier chez le sujet âgé, implique
l’interdiction du port de charges lourdes.
1104. HERNIE DE LITTRE. Type de hernie décrite par Littré en 1770 correspondant
à la présence du diverticule de Meckel (>) dans un sac herniaire. Le diagnostic
est souvent posé en peropératoire d’un tableau de hernie étranglée avec une
occlusion intestinale, le plus souvent chez la personne âgée.
1105. HERNIE OMBILICALE.
Définition et causes.
Passage d’un diverticule du péritoine, pouvant contenir des viscères, au travers
de l’orifice ombilical. Chez l’enfant il s’agit de persistance de l’orifice
ombilical laissé par les vaisseaux ombilicaux. Chez l’adulte, la hernie est
acquise par distension de l’anneau ombilical (grossesses multiples, cirrhose
avec ascite…).
Epidémiologie.
Il s’agit d’une anomalie très fréquente chez le nourrisson.
Signes et symptômes.
Pour les petites hernies, on retrouve une petite masse, souvent réductible et
impulsive à la toux. Les grosses hernies sont, en général, irréductibles du fait
des adhérences et recouvertes d’une peau fine et distendue.
Investigations.
Le diagnostic est clinique.
Evolution, Complication et Pronostic.
La complication majeure est l’étranglement, qui se manifeste par des douleurs et
des signes d’occlusion. Il est nécessaire un geste chirurgical immédiat pour
éviter dune nécrose des anses intestinales et une péritonite.
Traitement.
Il est chirurgical (suture de l’orifice, prothèse de renforcement).
1106. HERPANGINE.
Définition et causes.
Infection due au virus Coxackie A.
Epidémiologie.
Elle touche surtout les jeunes enfants.
Signes et symptômes.
Il existe une pharyngite fébrile érythémateuse. Diffuse sur laquelle quelques
vésicules respectant l’amygdale et la langue, s’ulcèrent rapidement. Elles sont
sources de douleurs et de difficultés pour avaler.
Investigations.
Le virus peut être isolé à partir des lésions et on constate une ascension du
titre des anticorps.
Evolution, Complication et Pronostic.
L’évolution est en général favorable en une semaine.
Traitement.
Il est symptomatique.
1107. HERPES CIRCINE.
Définition et causes.
Infection cutanée du groupe des dermatophyties du à un champignon, Trichophyton,
de transmission interhumaine, animale ou tellurique (par la terre).
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente.
Signes et symptômes.
Il s’agit de lésions rose-rouge annulaires, papulosquameuses avec des bordurent
surélevées qui s’étendent par la périphérie tout en s’éclaircissant au centre.
Elles sont très prurigineuses et sont localisées sur la peau glabre (sans
poils).
Investigations.
L’examen direct et la mise en culture d’un prélèvement de la zone atteinte
identifient le champignon.
Evolution, Complication et Pronostic.
Le traitement est efficace mais les récidives sont fréquentes.
Traitement.
Il comporte des antifongiques locaux et la griséofulvine ou le kétoconazole par
voie générale en cas d’échec.
Prévention et Education.
La prévention consiste à traiter tous les foyers chez le patient ( les pieds en
particulier), ainsi que toutes les personnes et les animaux de l’entourage.
1108. HERPES GENITAL.
Définition et causes.
Infection par le virus Herpès simplex, le plus souvent de type 2 (HSV2), qui
touche la partie inférieure du corps, notamment les organes génitaux. La
contamination se fait par contact avec une personne infectée, soit par voie
néonatale, soit par voie sexuelle (MST). La contagiosité est importante pendant
et autour des périodes de poussée.
Epidémiologie.
On estime que 30% de la population est infectée et la prévalence continue
d’augmenter. Bien que la majorité des sujets reste asymptomatique, tous ont un
risque de récurrence, symptomatique ou non, facteur de transmission de
l’infection. La contamination survient à l’adolescence ou à l’âge adulte.
Signes et symptômes.
La primo infection se manifeste par un œdème inflammatoire des lèvres et du
gland, parsemé de petites vésicules qui s’érodent et se transforment en
ulcérations confluentes, jaunâtres ayant l’aspect d’aphtes. Ces lésions
entrainent des douleurs spontanées intenses à type de brulures.
Investigations.
Dans la majorité des cas, le diagnostic est clinique. En cas de doute, un
prélèvement au niveau des lésions permet soit une détection directe, soit une
mise en culture.
Evolution, Complication et Pronostic.
Une fois le virus présent dans l’organisme, il y restera à vie et la maladie va
évoluer par poussées (environ trois ou quatre par an) , qui sont en général
moins symptomatiques que la primo-infection. Les principaux facteurs favorisants
les poussées sont : la fièvre, le stress, une exposition au soleil, les règles,
la fatigue, la prise d’alcool…Le traitement peut raccourcir la durée des
poussées et les espacer. Les principales complications sont neurologiques
(encéphalite pouvant entrainer la mort). La transmission néonatale touche 1 sur
10 000 grossesses, entrainant une mortalité et des séquelles neurologiques
importantes chez l’enfant. Les infections peuvent être particulièrement graves
chez les sujets immunodéprimés.
Traitement.
Les antiviraux utilisés lors de la primo-infection et les récurrences sont le
valaciclodir ou l’aciclovir.
Prévention et Education.
Exclusion des rapports pendant les poussées et port du préservatif le reste du
temps. Les contacts orogénitaux sont contaminants.
1109. HERPES GESTATIONIS. Forme de pemphigoïde bulleuse (>), qui survient au
cours de la grossesse et dont la prévalence se situe entre 1 : 3 000 et 1/ 50
000. Elle survient en général lors de la première grossesse (ou lors d’une
grossesse issue d’un nouveau père). Elle débute après le premier trimestre et
l’évolution est spontanément régressive en un ou deux mois après l’accouchement.
Elle récidive lors des grossesses ultérieures, souvent de façon plus précoce et
plus sévère. Les corticoïdes par voie générale sont efficaces et n’ont pas de
retentissement grave sur le fœtus.
1110. HERPES LABIAL.
Définition et causes.
Infection par le virus herpes simplex, le plus souvent de type 1 (HSV 1), qui
touche en général la partie supérieure du corps, notamment les lèvres. La
contamination se fait par contact direct avec la lésion ou le sécrétions
(salive, mucus nasal). La contagiosité est importante pendant et autour des
périodes de poussées.
Epidémiologie.
On estime que dans certaines régions, la prévalence atteint 80% de la
population. Bien que la majorité des sujets restent asymptomatiques, tous ont un
risque de récurrence, symptomatiques ou non, facteur de transmission d
l’infection. La contamination survient habituellement entre 6 mois et 4 ans.
Signes et symptômes.
Chez l’enfant, la primo-infection est totalement asymptomatique. La poussée se
manifeste par le classique ‘bouton de fièvre’, situé en général sur la lèvre. Il
s’agit d’un bouquet de vésicules reposant sur une base érythémateuse qui
s’érodent puis se recouvrent de croutes.
Investigations.
Dans la majorité des cas, le diagnostic est clinique. En cas de doute, un
prélèvement au niveau des lésions, permet soit une détection directe, soit une
mise en culture.
Evolution, Complication et Pronostic.
Une fois le virus présent dans l’organisme, il y restera à vie et la maladie va
évoluer par poussée (environ 3 ou 4 par na), qui sont en général moins
asymptomatiques que la primo-infection. Les principaux facteurs favorisants les
poussées sont ; la fièvre, le stress, une exposition au soleil, la règle, la
fatigue, la prise d’alcool…L’évolution se fait vers la cicatrisation en 8 à 10
jours. Les principales complications sont oculaires (cécité possible),
neurologiques (encéphalite pouvant entrainer la mort) et cutanées (> érythème
polymorphes). Les infections peuvent être particulièrement graves chez les
sujets immunodéprimés.
Traitement.
Il n’y a pas vraiment de traitement. L’aciclovir en pommade diminuerait la durée
des poussées.
Prévention et Education.
Le baiser lors d’une poussée doit être évité, notamment des adultes vers les
enfants. Les contacts orogénitaux sont contaminants.
1111. HERPES ZOSTER ou (>) ZONA.
1112. HERS (MALADIE DE). Maladie héréditaire, de transmission autosomique
récessive, due à un déficit enzymatique qui entraine une accumulation de
glycogène dans les tissus (glycogènose). Elle peut se manifester par une
hépatomégalie et des hypoglycémies à jeun, mais souvent aucun symptôme n’est
présent.
1113. HEVIL (SYNDROME DE). Acronymes pour hamartome épidermique verruqueux
inflammatoire linéaire. Il s’agit de placards rouges avec des squames disposés
en bandes linéaires longitudinales sur les membres et transversales, plus ou
moins curvilignes sur le tronc, n’atteignant qu’une moitié du corps. L’évolution
se fait par poussées et le risque de surinfection est important .Le traitement
es décevant ; dans certaines localisations peu étendues, une exérèse
chirurgicale est possible.
1114. HIDRADENITE ECCRINE NEUTROPHILIQUE.
Atteinte cutanée rare, caractérisée par une infiltration de polynucléaires
neutrophiles autour des glandes sudorales, par l’association à une leucémie
aiguë myéloblastique (>) et la survenue fréquente en période de neutropénie. Les
lésions sont de deux types, soit un placard inflammatoire périorbitaire, soit
une éruption d’éléments papuleux de petite taille. Le diagnostic est confirmé
par la biopsie. La régression est spontanée et aucun traitement n’est
nécessaire, sauf en cas de lésions très inflammatoires et étendues ou une
corticothérapie générale peut être utile.
1115. HIDRADENOMES ou SYRINGOMES.
Tumeurs bénignes développées aux dépens d’une cellule d’une glande sudoripare de
la peau. Elles prennent l’aspect de petites papules dont la consistance est
ferme et qui sont souvent associées à de petits kystes. Les localisations les
plus fréquentes sont le thorax (hidradénome éruptif survenant au moment de la
puberté), les paupières inférieures (notamment chez les femmes âgées), les
grandes lèvres (hidradénome papillaire bénin survenant pendant les règles) et le
cou , ainsi que le cuir chevelu (hidradénome verruqueux fistulo-végétant, qui
est une variété de naevus formée de petites tumeurs verruqueuses regroupées en
plaques ou e lignes, donnant un aspect de minuscules kystes avec des orifices
suintants) ; l’électrocoagulation est le traitement préférentiel.
1116. HIDROSADENITE ou MALADIE DE VERNEUIL.
Définition et causes.
Maladie inflammatoire, suppurative et chronique, affectant les zones corporelles
riches en glandes sudoripares apocrines. Les localisations habituelles sont les
régions axillaires, périnéales, inguinales et les fesses. La cause est mal
connue mais l’hypothèse avancée est celle d’une anomalie de la production
sudorale avec une macération locale.
Epidémiologie.
C’est une maladie de l’adulte sans prédominance de sexe.
Signes et symptômes.
Il existe au début un prurit et une hyperhidrose (exagération de la sécrétion de
sueur), puis apparaissent des nodules sous cutanés, isolés ou regroupés,
douloureux ou regroupés, douloureux saillants sous une peau rouge, qui
s’affaissent et s’ulcère à la peau en émettant du pus.
Evolution, Complication et Pronostic L’évolution se fait par poussées sur
plusieurs années avec des périodes de rémission. Il existe un risque de
développement d’un carcinome spinocellulaire.
Traitement.
Les formes mineures bénéficieront d’antiseptiques locaux associés à une
antibiothérapie prolongée par les cyclines ou éventuellement de l’isotrétinoïne.
Dans les formes graves, l’évidement chirurgical et la greffe cutanée sont
indiqués.
1117. HIDS . Acronyme anglais pour hyperimmunoglobulinaemia Dsyndrome. Il
correspond en France, au syndrome hyperimmunoglobulinémie D avec fièvre
périodique (>).
1118. HINSON PEPYS (MALADIE DE) . Inflammation bronchopulmonaire d’origine
allergique survenant chez des patients asthmatiques anciens et liée à une
infection à Aspergillus fumigatus (> Aspergillose). Le traitement utilise les
corticoïdes et les antifongiques par aérosols.
1119. HINTNER-WOLFF (EPIDERMOLYSE BULLEUSE DE) (>) EPIDERMOLYSES BULLEUSES
HEREDITAIRES .
1120. HIPPOCRATISME DIGITAL. Elargissement des phalanges distales des doigts
avec bombement et épaississement des ongles. Le mécanisme de formation est
inconnu. Il se rencontre principalement dans le cadre d’affections pulmonaires
(bronchite chronique, dilatations des bronches, abcès, cancer…) Plus, rarement,
il s’agit de cardiopathies congénitales ou de maladies intestinales chroniques
(Crohn, rectocolite hémorragique). La guérison est possible lorsque la cause est
curable.
1121. HIRSCHSPRUNG (MALADIE DE) ou MEGACOLON CONGENITAL.
Définition et causes.
Maladie congénitale due à l’absence des plexus nerveux végétatifs de Meissner et
d’Auerbach dans la paroi de l’intestin terminal. Elle se traduit par une
hypertonie permanente du muscle lisse intestinal réalisant un obstacle
fonctionnel à la pression du bol alimentaire, ce qui entraine une dilatation.
Epidémiologie.
Elle touche 1/5 000 naissances avec une prédominance masculine, le risque est
multiplié par 50 chez les apparentés.
Signes et symptômes.
Le diagnostic est plus ou moins précoce. A la naissance, il existe un retard à
l’élimination du méconium, un syndrome occlusif avec des vomissements bileux et
un ballonnement abdominal. Les manifestations plus tardives sont un syndrome
subocclusif et une constipation avec abus de laxatifs.
Investigations.
Elles comprennent un abdomen sans préparation, la manométrie rectale et un
lavement opaque.
Evolution, Complication et Pronostic.
L’évolution est grave en l’absence de traitement. Les complications sont
l’occlusion, la péritonite par perforation et l’entérocolite ulcéronécrosante
par ischémie. Le pronostic est lié à la longueur du segment atteint et au
rétablissement de la continence anale après traitement.
Traitement.
La mise en place d’une sonde rectale et des lavements évacuateurs précédent la
chirurgie.
Prévention et Education.
En période néonatale, le nursing à domicile est utile pour retarder la
chirurgie.
1122. HIRSUTISME.
Définition et causes.
Pilosité abondante chez la femme dans des zones habituellement sans poils.
Plusieurs mécanismes sont possibles :
• Augmentations de la sensibilité des récepteurs pileux aux androgènes (forme
idiopathique, souvent familiale).
• Hypersécrétion d’androgène par la surrénale (hyperplasie ou tumeur) ou les
ovaires (syndrome de Stein Leventhal ou tumeur) ;
• Iatrogénie (corticoïdes, androgènes…).
Epidémiologie.
La forme idiopathique est, de loin, la plus fréquente.
Signes et symptômes.
Des poils sont présents sur le visage, les mamelons, la poitrine, la ligne
blanche abdominale avec une pilosité pubienne en losange et sur la face interne
des cuisses. Des signes d’hyperandrogénie sont présents en cas de cause
surrénalienne ou ovarienne : voix rauque, acné, golfes frontotemporaux,
hypertrophie clitoridienne, règles irrégulières.
Investigations.
Les examens biologiques et l’imagerie recherchent une éventuelle cause
surrénalienne ou ovarienne.
Evolution, Complication et Pronostic.
Le pronostic est variable selon la cause. Dans les formes idiopathiques, le
traitement est très efficace.
Traitement.
Dans les formes idiopathiques, on utilise les antiandrogènes associés aux
androgènes. L’épilation est un complément utile. Dans les autres formes, le
traitement est celui de la cause.
1123. HISTIOCYTOFIBROME ou FIBROME EN PASTILLE.
Tumeur cutanée bénigne, fréquente, développée dans le derme. Unique ou multiple,
elle siège généralement aux membres inférieurs. Elle est légèrement en relief,
ferme à la palpation et l’invagination que provoque le pincement latéral est
caractéristique. Elle n’est pas douloureuse, mais elle peut être gênante, si
elle est au contact d’une surface osseuse. Sa couleur est variable du rose pale
au noir. En l’absence de gêne fonctionnelle ou de motivation esthétique, son
ablation chirurgicale n’est pas nécessaire.
1124. HISTIOCYTOSE HEMOPHAGOCYTAIRE FAMILIALE ou (>) LYMPHOHYSTICYTOSE
FAMILIALE.
1125. HISTIOCYTOSE MUCINEUSE PROGRESSIVE HEREDITAIRE.
Affection de transmission autosomique dominante, se présentant sous la forme de
papules rouge-brun du nez et des membres, apparaissant vers l’âge de 20 ans et
n’évoluant pas vers le régression spontanée. On retrouve la biopsie des
histiocytes dendritiques produisant de la mucine. Aucun traitement n’a été
proposé en dehors de l’exérèse chirurgicale des lésions gênantes.
1127. HISTIOCYTOSE X.
Définition et causes.
Groupe de maladies, de cause inconnue, caractérisée par une prolifération des
histiocytes ou cellules de Langerhans qui peut être localisées dans certains
tissus (os, poumon, peau) ou être généralisée.
Epidémiologie.
C’est une affection rare (incidence 1/ 200 00 enfants par an). Les formes
disséminées se voient surtout chez le jeune enfant, et les formes localisées
chez l’adulte.
Signes et symptômes.
Les atteintes osseuses sont destructrices (‘trous à l’emporte pièce). L’atteinte
pulmonaire se manifeste souvent par une bronchiolite diffuse. Au niveau cutané,
il s’agit d’une éruption papuleuse avec des ulcérations (les muqueuses peuvent
être touchées).
Investigations.
La biopsie des tissus atteints montre des lésions spécifiques (granulome à
cellules de langerhans).
Evolution, Complication et Pronostic.
L’évolution et la gravité de la maladie dépendent de la diffusion de l’atteinte
et des organes touchés. Les formes disséminées de l’enfant sont mortelles en
l’absence de traitement.
Traitement.
Il est fondé sur les corticoïdes et les anticancéreux cytostatiques en cas
d’échec. Les lésions osseuses nécessitent une prise en charge chirurgicale.
1128. HISTOPLASMOSE. Maladie infectieuse due à un champignon histoplasma
capsulatum . Elle est caractérisée principalement par une atteinte pulmonaire.
C’est une infection opportuniste du sida.
Epidémiologie.
Elle est endémique sur le continent américain (elle peut se rencontrer en
Afrique et en Asie du Sud-Est et d’importation en France métropolitaine.
Signes et symptômes.
La primo-infection pulmonaire est asymptomatique dans 90% des cas ou se limite à
un syndrome grippal non spécifique. La forme disséminante se traduit par de la
fièvre, une altération de l’état général, une pneumopathie et des atteintes
viscérales variées (méningo¬encéphalite, hépatite, insuffisance surrénalienne).
Dans la forme pulmonaire chronique, il existe une aggravation de la dyspnée, des
hémoptysies et des infiltrats pulmonaires bilatéraux évoluant vers la
cavitation.
Investigations.
Elles comprennent l’examen direct ou une culture sur les crachats ou le sang, la
sérologie et la radiographie pulmonaire.
Evolution, Complication et Pronostic.
La primo-infection est bénigne. La forme disséminée évolutive entraine 90% de
mortalité. La forme chronique évolue vers une insuffisance respiratoire
chronique.
Traitement.
Il est fondé sur l’amphotéricine B ou les imidazolés.
Prévention et Education.
Pour les immunodéprimés, il faut éviter les séjours dans les zones d’endémie et
instaurer un traitement d’entretien pour éviter les récidives.
1129. HODGKIN (MALADIE DE).
Définition et causes.
Cancer du système lymphatique (lymphome) caractérisée par une polyadénopathie
avec la prolifération de cellules de Reed-Sternberg dans des ganglions remaniés.
Epidémiologie.
La fréquence annuelle est d’environ 3 cas pour 100 000 habitants, avec une
légère prédominance masculine. Elle existe à tout âge, mais avec un pic entre 20
et 30 ans.
Signes et symptômes.
Le plus souvent, la découverte se fait par la présence de gangliomes cervicaux
ou sus claviculaires. D’autres fois, des adénopathies médiatiques sont
découvertes sur un cliché thoracique ou devant une toux, une dyspnée ou des
douleurs thoraciques. Parfois, il existe des signes généraux : fièvre,
amaigrissement et sueurs nocturnes.
Investigations.
La biopsie ganglionnaire permet le diagnostic (présence de cellules de
Sternberg, caractéristiques de la maladie). Le bilan d’extension comprend un
scanner thoracique et abdominal, l’échographie de la rate et du foie et,
éventuellement, une biopsie médullaire et hépatique.
Evolution, Complication et Pronostic.
La classification de Ann Arbor qui utilise le stade d’extension aux différentes
aires ganglionnaires (une ou plusieurs aires, d’un seul ou des deux côtés du
diaphragme, existante d’une atteinte viscérale et de signes généraux) permet
d’adapter le traitement et à une valeur pronostique. Le traitement permet une
rémission complète prolongée dans presque 90% des cas dans les formes
localisées, mais de seulement de 50% dans les formes étendues. Des rechutes sont
possibles. Les principales complications (cardiaques, pulmonaire, infectieuses)
sont à long terme et liées aux séquelles des traitements. Le risque de leucémie
est fortement augmenté.
Traitement.
Il associe radiothérapie et chimiothérapie selon des protocoles standardisés.
Prévention et Education.
La surveillance des récidives et des complications liées aux traitements est
essentielle.
1130. HOFFA (MALADIE DE). Tumeur de tissu graisseux (lipome) se développant aux
dépens de la synoviale du genou. Elle entraine la disparition des deux
dépressions situées de chaque côté du tendon rotulien ou même une tuméfaction
globale du genou. Elle s’accompagne d’une douleur et d’une gêne lors des
mouvements.
1131. HOFFMANN (SYNDROME DE). Atteinte musculaire (myopathie) associée à une
hypothyroïdie chez l’adulte. Elle est caractérisée par une hypertrophie
musculaire associée à une faiblesse, des crampes, un enraidissement musculaire
douloureux et une lenteur du mouvement. L’ensemble de ces symptômes est aggravé
à l’effort.
1132. HOFFMANN ET HABERMANN (MALADIE DE) . Affection cutanée caractérisée par
une pigmentation du visage, accompagnée d’inflammation des glandes sébacées
(comédons, folliculite). Elle est due à l’action des huiles de graissage, des
crèmes de beauté et des fards de mauvaise qualité.
1133. HOLT-ORAM (SYNDROME DE). Ensemble de malformations transmises sur le mode
autosomique dominant. La fréquence est de 1/100 000. II associe une atteinte
cardiaque (communication interventriculaire ou interatriale avec des troubles du
rythme) et des anomalies des membres supérieurs.
1134. HOMME DE PIERRE (MALADIE DE L’) ou (>) FIBRODYSPLASIE OSSIFIANTE
PROGRESSIVE.
1135. HOMME RAIDE (SYNDROME DE L’) ou (>) MOERSCH WOLTMAN (SYNDROME DE).
1136. HOMOCYSTINURIE.
Définition et causes.
Maladie génétique, de transmission autosomique récessive, caractérisée par une
augmentation de la concentration de l’acide aminé homocystine dans le sang et
dans les urines du fait d’un déficit enzymatique.
Epidémiologie.
C’est une maladie rare (1/200 000 naissances).
Signes et symptômes.
Le premier symptôme est une luxation du cristallin qui expose au glaucome.
Ensuite apparaissent des atteintes du squelette (scoliose, pieds plats, genu
valgum, aspect longiligne) et des atteintes vasculaires avec des thromboses
artérielles et veineuses. Le retard mental est d’importance très variable,
parfois complètement absent.
Investigations.
Elles comprennent la réaction de Brand dans les urines (très sensible mais non
spécifique), la chromatographie des acides aminés sanguins et urinaires, ainsi
que le dosage de l’homocystine plasmatique.
Evolution, complications et pronostic.
Près du quart des patients meurent de maladies vasculaires avant l’âge de 30
ans.
Traitement.
Il utilise l’apport de pyridoxine et un régime pauvre en méthionine, supplémenté
en cystine.
Prévention et éducation.
Le diagnostic anténatal est possible par dosage enzymatique sur les villosités
choriales et sur les cultures de cellules amniotiques.
1137. HOOFT (SYNDROME DE) Affection familiale due à un trouble du métabolisme
des lipides. Toutes les fractions lipidiques sont abaissées dans le sang, sauf
celle des bêta-lipoprotéines. Le phosphore sanguin est également abaissé et il
existe une aminoacidurie. Ce syndrome se caractérise par un nanisme, une
éruption rouge et squameuse de la face et des extrémités des membres. Il existe
une dystrophie des ongles, du système pileux, des dents et, parfois, une
dégénérescence de la couche pigmentaire de la rétine, pouvant intéresser la
choroïde.
1138. HOQUET
Définition et causes.
Contraction spasmodique et involontaire du diaphragme qui provoque un mouvement
inspiratoire, brusquement interrompu par une fermeture brutale de la glotte.
L’origine est une irritation du nerf phrénique dont la cause la plus fréquente
est une ingestion rapide ou excessive de liquide ou d’aliment. Il peut être lié
à une pathologie thoracique (péricardite, pleurésie, tumeur de l’œsophage ou du
médiastin…), abdominale (péritonite, pancréatite…) ou neurologique
(tumeurs).
Epidémiologie.
Le hoquet banal est très fréquent.
Signes et symptômes-Investigations.
La fermeture de la glotte produit un bruit sec caractéristique. Le diagnostic
est clinique.
Evolution, complications et pronostic.
La répétition des contractions peut être de durée variable. Elles cèdent en
général rapidement. Certaines formes qui se prolongent peuvent être très
invalidantes.
Traitement.
Les petits moyens pour arrêter le hoquet sont: boire rapidement un verre d’eau
froide, avaler du sucre en poudre, presser les globes oculaires, masser le sinus
carotidien… Les antinauséeux peuvent être utiles dans les formes sévères.
1139. HORTON (MALADIE DE)
ou ARTÉRITE TEMPORALE
ou ARTÉRITE GIGANTOCELLULAIRE
Définition et causes
Maladie inflammatoire chronique des gros vaisseaux, en particulier des artères
du crâne (artère temporale). Un processus auto-immun est suspecté. La
pseudopolyarthrite rhizomélique (>) est associée dans près de la moitié des cas.
Epidémiologie.
C’est une maladie fréquente dont l’incidence augmente à partir de 60 ans, avec
un pic entre 70 et 80 ans et une légère prédominance féminine.
Signes et symptômes.
Le tableau typique associe:
• Une céphalée sévère (notamment temporale).
• Une douleur 0 la palpation de l’artère temporale.
• Une atteinte oculaire (baisse brutale de l’acuité visuelle). Dans certains
cas, il n’existe qu’une simple fébricule avec une altération de l’état général.
Investigations.
La vitesse de sédimentation est très élevée (> 100, la première heure). Le
diagnostic est affirme par la biopsie de l’artère temporale ‘artérite a cellules
géantes’.
Evolution, complications et pronostic.
La cécité est la principale complication. Des accidents vasculaires cérébraux ou
une atteinte aortique sont possibles. Le pronostic sous traitement est excellent
et une rémission complète peut être obtenue chez la plupart des patients.
Traitement.
La corticothérapie à forte dose doit être instituée aussitôt le diagnostic
suspecte afin d’éviter une cécité définitive. Le traitement sera poursuivi à
doses dégressives pendant au moins un an.
1140. HOWELL-EVANS (SYNDROME DE) . Affection cutanée héréditaire, de
transmission autosomique dominante, caractérisée par un épaississement de la
couche corn& de la paume des mains et de la plante des pieds (kératodermie
palmoplantaire). Dans 70 % des cas est associe un cancer de l’œsophage qui
survient après 40 ans, alors que les signes cutanés apparaissent dans l’enfance.
1141. HUGHES-STOVIN (SYNDROME DE). Affection associant un syndrome cave
inferieur (manifestations liées a un arrêt de la circulation dans la veine cave
inferieure obstruée par une thrombose, >) à des anévrismes pulmonaires.
1142. HUNTER (MALADIE DE) ou MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE II.
Maladie génétique, de transmission récessive liée au sexe, due a un déficit
enzymatique. Elle est caractérisée par des anomalies morphologiques avec un
facies grossier, une atteinte cardiovasculaire et une raideur articulaire. II
existe une forme sévère, pour laquelle la mort est habituelle avant l’âge de 15
ans, et une forme légère, avec une survie jusqu’a 40-50 ans et peu d’atteinte
psychique. Un nouveau médicament, l’idursulfatuse , est maintenant disponible
pour le traitement a long terme de la maladie.
1143. HUNTINGTON (MALADIE DE) ou (>) CHOREE DE HUNTINGTON.
1144. HURLER (MALADIE DE) OU MUCOPOLYSACCHARIDOSE DE TYPE 1 H.
Maladie génétique de transmission autosomique récessive due a un déficit
enzymatique. Elle est caractérisée par:
• Des anomalies morphologiques, notamment craniofaciales (gargoylisme) et des
membres donnant une attitude simiesque ;
• Un abdomen volumineux avec des hernies fréquentes et une hépatosplénomégalie ;
• Une pilosité anormale;
• Des opacités cornéennes. Le pronostic très sévère avec une espérance de vie
limitée sera vraisemblablement améliore par un nouveau médicament apportant
l’enzyme déficient. Dans les cas les plus graves, une greffe de moelle osseuse
est proposée dans l’enfance.
1145. HUTCHINSON-GILFORD (MALADIE DE) ou (>) PROGERIA.
1146. HYALINOSE CUTANEO-MUQUEUSE ou (>) URBACH WIETHE (MALADIE D’).
1147. HYALINOSE SEGMENTAIRE ET FOCALE.
Définition et causes.
Affection rénale caractérisée par une atteinte de certains glomérules (focale)
dont seule une portion est anormale (segmentaire), présentant une sclérose et
une hyalinose (aspect transparent des cellules) avec des dépôts
(immunoglobulines et fractions du complément). Le mécanisme est immunologique,
mais la cause précise reste obscure.
Epidémiologie.
Elle touche l’enfant et l’adulte jeune, avec une prédominance masculine.
Signes et symptômes.
Les signes se limitent a des œdèmes d’apparition progressive, accompagnes
parfois d’une hypertension artérielle. Une hématurie microscopique est souvent
retrouvée.
Investigations.
Le bilan biologique retrouve les anomalies typiques du syndrome néphrotique (>)
: protéinurie, hypoalbuminémie et hyperlipidémie. La biopsie rénale confirme le
diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait en général, plus ou moins rapidement, vers une insuffisance
rénale chronique.
Traitement.
Les corticoïdes associes à la ciclosporine permettent d’obtenir des remissions
chez un certain nombre de patients.
1148. HYDARTHROSE INTERMITTENTE
Définition et causes.
Maladie caractérisée par la survenue périodique d’un épanchement liquidien
intra-articulaire. La cause est inconnue.
Epidémiologie.
Très rare. Elle s’observe surtout chez la femme et commence le plus souvent
entre 10 et 30 ans.
Signes et symptômes.
L’épanchement, généralement unilatéral, atteint essentiellement le genou. Il est
abondant et peu douloureux.
Investigations.
Le liquide articulaire est clair et contient peu de cellules.
Evolution, complications et pronostic.
La régression s’effectue spontanément en quelques jours, puis la récidive
survient au bout d’un intervalle variable, en moyenne une dizaine de jours, mais
toujours identique pour le même sujet. L’évolution peut s’étaler sur de
nombreuses années. Des remissions de plus en plus longues, voire une guérison
définitive, l’interrompent souvent. Des lésions articulaires de type arthrose
sont possibles.
Traitement.
Le traitement médicamenteux est décevant. Une synoviorthèse (destruction de la
synoviale, le plus souvent par injection d’un produit chimique) se discute chez
les patients très handicapés.
1149. HYDATIDOSE ou KYSTE HYDATIQUE ou ECCHINOCOCCOSE KYSTIQUE
Définition et causes.
Parasitose due a un petit ver, le tænia du chien ou Echinococcus granulosus .
Les œufs sont présents dans les excréments du chien. L’homme se contamine en
consommant des végétaux souffles ou en portant a la bouche des mains souillées
par contact direct avec le pelage de l’animal.
Epidémiologie.
La maladie se rencontre particulièrement dans les pays d’élevage ovin (le mouton
est l’hôte intermédiaire qui se contamine par l’herbe souillée et les chiens se
réinfectent en mangeant les viscères des moutons).
Signes et symptômes.
Les kystes pulmonaires donnent des symptômes précoces et marques. Les kystes
hydatiques hépatiques ne donnent des signes qu’âpres une latence de cinq à vingt
ans.
Investigations.
L’échographie, la radiographie de thorax, le scanner ou l’IRM visualisent les
kystes. L’hyperéosinophilie est constante, mais souvent modérée. Il existe un
sérodiagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est la rupture et l’infection des kystes.
Traitement.
Le traitement consiste en une ablation chirurgicale des kystes, complète avant
et après l’intervention par l’administration d’albendazole . Depuis quelques
années, certaines équipes pratiquent la technique PAIR (ponction, aspiration,
injection et respiration), qui peut apporter des résultats intéressants
permettant d’éviter la chirurgie.
Prévention et éducation.
La prévention est fondée sur le traitement des chiens domestiques et
(‘interruption du cycle mouton-chien (miler et enterrer profondément les animaux
morts d’hydatidose).
1150. HYDROA VACCINIFORME. Affection cutanée rare qui débute dans l’enfance et
disparait spontanément à l’adolescence. Apres une exposition solaire importante
en été apparait en quelques heures une sensation de tiraillement et de brûlures.
En moins de 24 heures se développe une éruption vésiculeuse des zones les plus
exposées. Les vésicules deviennent confluences, se couvrent d’une crane et
disparaissent en quelques semaines en laissant une cicatrice de type variole.
L’affection récidive chaque été au prix de cicatrices parfois importantes. Le
traitement utilise la PUVA- et la photothérapie.
1151. HYDROCELE VAGINALE.
Définition et causes
Epanchement de liquide dans la vaginale autour du testicule. La cause peut être
congénitale (communication avec la cavité abdominale par un prolongement de la
vaginale), une production excessive de liquide (inflammation, infection) ou une
résorption insuffisante (occlusion lymphatique ou veineuse dans le cordon
spermatique).
Epidémiologie.
Fréquent.
Signes et symptômes.
Le scrotum est augmente de volume. Le testicule est palpable et fibre.
Investigation.
La masse de liquide se laisse traverser par une source de lumière appliquée en
arrière du scrotum (transillumination).
Evolution, complications et pronostic
L’hydrocèle congénitale peut se résoudre spontanément par la fermeture de la
communication après la naissance. La régression est spontanée dans les formes
inflammatoires.
Traitement.
La ponction permet initialement de mieux apprécier l’état du testicule mais
n’est que temporaire. La chirurgie est le traitement de la forme persistante.
1152. HYDROCEPHALIE DU NOURRISSON.
Définition et causes.
Accumulation de liquide céphalorachidien (LCR) dans des ventricules élargis. La
cause est soit une obstruction à l’écoulement du LCR par une tumeur ou une
malformation, soit un défaut de résorption du liquide secondaire à une
hémorragie méningée (prématuré) ou a une infection (méningite, toxoplasmose).
Epidémiologie.
C’est la cause la plus fréquente d’augmentation anormale de la taille de la tête
chez le nouveau-né.
Signes et symptômes.
Le principal signe est une augmentation rapide du périmètre crânien avec une
fontanelle tendue, un front bombant et une disjonction des sutures. Des
convulsions sont possibles.
Investigations.
L’échographie peut faire le diagnostic en anténatal. L’échographie et le scanner
confirment le diagnostic après la naissance.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic est variable en fonction de la cause et de l’existence de
l’hydrocéphalie en anténatal.
Traitement.
Le traitement consiste en la mise en place d’une dérivation du LCR. Une
surveillance attentive pour dépister l’apparition de complications (infection,
obstruction de la valve) est indispensable.
1153. HYDROCEPHALIE A PRESSION NORMALE.
Définition et causes.
Dilatation du système ventriculaire cérébral avec une pression normale du
liquide céphalorachidien (LCR). Elle est due un trouble de la résorption du LCR
qui se constitue progressivement, sans qu’il existe d’obstacle à son écoulement.
La plupart du temps, aucune cause précise n’est retrouvée ; dans d’autre cas,
elle est secondaire à une hémorragie méningée, une méningite ou un traumatisme
crânien.
Epidémiologie.
Elle touche le plus souvent des sujets âges de plus de 60 ans.
Signes et symptômes.
II existe une démence de type frontal (désintérêt, indifférence affective,
ralentissement psychomoteur…), des troubles de l’équilibre et de la marche
(début de marche hésitant puis devient possible), des troubles sphinctériens
(mictions incontrôlables).
Investigations.
Le scanner, l’IRM et, éventuellement, le transit isotopique de LCR permettent le
diagnostic. La soustraction de LCR par ponction lombaire (avec mesure de la
pression qui est normale) permet une amélioration transitoire.
Evolution, Complications Et Pronostic.
Révolution est variable et le traitement n’améliore pas toujours le patient.
Traitement.
Lorsque la soustraction de LCR provoque une amélioration, la mise en place d’une
valve de dérivation est indiquée. Ce dispositif expose à de nombreuses
complications, notamment infectieuses, qui nécessitent une surveillance
rigoureuse.
1154. HYDROCHOLECYSTE. Distension aiguë de la vésicule qui se remplit d’un
liquide clair, à la suite de l’obstruction du canal cystique, habituellement par
un gros calcul unique. A l’examen, la vésicule est palpable, volumineuse, dure.
La douleur est inconstante. Les principales complications sont une infection,
une perforation ou une gangrène. Le traitement est l’ablation de la vésicule
(cholécystectomie).
1155. HYDROCYSTOMES. Tumeurs cutanées bénignes localisées sur les paupières et
les joues. II s’agit de petites élevures claires, légèrement bleutées, à contenu
liquide, souvent accentuées par l’exposition à la chaleur. Le traitement est
l’excision chirurgicale.
1156. HYDRONEPHROSE.
Définition et causes.
Dilatation du bassinet et des calices rénaux en amont d’un obstacle.
L’hydronéphrose primaire est due à une malformation, le plus souvent au niveau
de l’insertion de l’uretère dans le bassinet (anomalie de la jonction
pyelocalicielle). L’hydronéphrose secondaire est due a un obstacle en aval du
bassinet (calcul, tumeur…) ou à un reflux vésico-urétéral.
Signes et symptômes.
Elle petit être complètement asymptomatique. Les signes les plus frequents sont
les douleurs lombaires sourdes ou bien a type de coliques.
Investigations.
L’échographie et l’urographie intraveineuse avec des cliches tardifs permettent
le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Les infections urinaires sont fréquentes. La principale complication est la
destruction progressive du rein.
Traitement.
La base du traitement est la levée de l’obstacle. En attendant, une dérivation
chirurgicale des urines est nécessaire en cas d’altération de la fonction rénale
ou d’infection. Si le rein ne fonctionne plus, une néphrectomie (ablation du
rein) sera réalisée.
1157. HYPERAMMONIEMIES HEREDITAIRES. Groupe de maladies héréditaires, de
transmission autosomique récessif ou lie à l’X, résultant d’un dysfonctionnement
du cycle de l’urée hépatique (détoxification de l’ammoniaque en urée) lié à un
déficit enzymatique. L’incidence est de 1/25 000 à 1/50 000 naissances. Dans les
formes néonatales, les enfants sont bien portants à la naissance puis, dans un
délai de 24 a 72 heures, s’installe une léthargie se transformant en coma. Dans
les formes tardives, les troubles sont moins marques avec des signes
neurologiques transitoires accompagnes de symptômes digestifs. Le dosage de
l’ammoniémie confirme le diagnostic. Le traitement est fondé sur un régime
hypoprotidique (diminution de la production d’azote) et un nouveau médicament,
qui permet d’éliminer l’ammoniaque en excès.
1158. HYPERCALCEMIES.
Définition et causes.
Calcémie totale supérieure a 2,55 mmol/L. Mais attention aux fausses
hypercalcémies en cas d’hyperprotidémie qui augmente la calcémie totale
(augmentation du calcium lie aux protéines) mais pas le calcium ionise qui est
biologiquement actif. Les principales causes sont les maladies parathyroïdiennes
et les cancers.
Signes et symptômes.
Association de manifestations digestives (constipation, anorexie, vomissements),
de manifestions neurologiques (fatigabilité, hypotonie musculaire et
hyperréflexie tendineuse, état dépressif, léthargie, confusion, coma), de
manifestations cardiaques (troubles du rythme ventriculaire) et de
manifestations rénales (soif, polyuropolydipsie = soif excessive et urines
abondantes, nephrocalcinose, lithiase).
Investigations.
Elles comprennent : calcémie, protidémie et gaz du sang (car l’acidose augmente
le calcium ionise). L’ECG montre un raccourcissement du QT et une
hyperexcitabilité ventriculaire. La recherche de la cause nécessite des examens
ciblés.
Evolution, complications et pronostic.
Les troubles du rythme ventriculaire peuvent engager le pronostic vital. Les
formes d’origine parathyroïdiennes sont plutôt d’évolution chronique et révélées
par des lithiases rénales. Les formes d’origine cancéreuse sont plutôt aiguës,
d’évolution rapide et révélées par des signes cliniques d’hypercalcémie.
Traitement.
II utilise les diurétiques de l’anse et les diphosphonates, acide clodronique ,
complétés par un traitement étiologique.
Prévention et éducation.
Enseigner au patient à limiter ses apports alimentaires de calcium (fromages,
laitages …). Les diurétiques thiazidiques sont interdits.
1159. HYPERCALCEMIE HYPOCALCIURIQUE FAMILIALE.
Maladie autosomique dominante à pénétrance forte, caractérisée par une
hypercalcémie asymptomatique qui dure route la vie, elle-même associée à une
excrétion rénale de calcium comparativement basse. Les seuls symptômes sont,
parfois, une pancréatite aigue ou une chondrocalcinose (>).
1160. HYPERCALCIURIE.
Définitions et causes.
Excrétion urinaire quotidienne de calcium supérieure 7,5 mmol (300 mg) chez
l’homme et 6,25 mol (250 mg) chez la femme, ou supérieure a 0,1 mmol/kg (4
mg/kg), sans distinction de sexe ni d’âge. Dans la grande majorité des cas
aucune cause n’est trouvée.
Epidémiologie.
C’est une affection très fréquente.
Signes et symptômes.
On retrouve une lithiase rénale calcique, une nephrocalcinose et/ou une
déminéralisation osseuse exposant au risque de fracture.
Investigations.
Elles comprennent une calciurie des 24 heures couplée à la créatininurie et une
mesure de l’excrétion urinaire de calcium après absorption d’une quantité connue
de calcium.
Evolution, complications et pronostic.
Seules les complications qui révèlent le plus souvent la maladie justifient un
traitement.
Traitement et éducation.
II repose sur des mesures diététiques (limiter les apports de calcium: fromages,
laitages…) et l’administration d’un diurétique thiazidique qui augmente la
réabsorption rénale du calcium.
1161. HYPERCHOLESTEROLEMIE PURE ou (>) HYPERLIPIDEMIE DE TYPE IIA.
1162. HYPERCHYLOMICRONEMIE ou (>) HYPERLIPIDEMIE DE TYPE I.
1163. HYPEROESINOPHILIE IDIOPATHIQUE (SYNDROME D’).
Définition et causes.
Hyperéosinophilie persistant depuis plus de six mois, sans cause connue, qui
s’accompagne d’une atteinte de plusieurs organes (cœur, système nerveux, peau,
poumons, œil, rate, foie…).
Epidémiologie.
Rare. Touche le plus souvent l’homme entre 20 et 50 ans.
Signes et symptômes.
L’atteinte cardiaque est la plus grave, avec une insuffisance cardiaque due à
une fibrose de la paroi interne du cœur. Les troubles neurologiques se
manifestent par des troubles sensitifs périphériques (neuropathie périphérique),
une altération de la conscience (encéphalopathie) ou une paralysie (accident
ischémique). Des signes cutanés, pulmonaires et oculaires sont présents dans
prés de la moitie des cas.
Investigations.
L’éosinophilie est supérieure a 1,5 x 109/L (1500/mm3). Une thrombopénie est
fréquente.
Evolution, complications et pronostic.
La mortalité est importante a court terme en cas d’atteinte cardiaque initiale
sévère.
Traitement.
La corticothérapie est la base du traitement. En cas d’échec, on utilise
l’hydroxyurée.
1164. HYPERIMMUNOGLOBULINEMIE D AVEC FIEVRE PERIODIQUE
Il s’agit d’une affection héréditaire de transmission autosomique récessive, qui
se manifeste en général dans l’enfance. Les accès inflammatoires durent
typiquement 7 jours et reviennent toutes les 4 à 8 semaines; ils sont
caractérises par une fièvre à 39 °C avec des douleurs abdominales, une diarrhée,
des vomissements et des douleurs articulaires. Leur spécificité par rapport aux
autres syndromes de fièvre périodique est la présence d’adénopathies cervicales
et d’une hépatosplénomégalie. En revanche, l’élévation des immunoglobulines D se
retrouve dans d’autres affections et l’élément essentiel du diagnostic est le
déficit en un enzyme: La mevalonate kinase. Le traitement est symptomatique et
le pronostic est en général bon
1165. HYPERLIPIDEMIES.
Définitions et causes.
Augmentation des graisses dans le sang liée à des anomalies des protéines sur lesquelles elles sont fixées. Elles peuvent être d’origine génétique ou secondaires à une autre pathologie (diabète…), à des facteurs nutritionnels, à des médicaments (œstrogènes…)
Epidémiologie.
Elles représentent le premier facteur de risque des maladies cardiovasculaires
qui restent la première cause de mortalité en France.
Signes et symptômes.
Les signes observes sont lies à des dépôts de graisses dans certains tissus: arc
cornéen, xanthélasma (dépôt jaunâtre sur les paupières) et xanthomes (>)
tendineux ou cutanés (petites tumeurs de tissu conjonctif riche en graisse).
Investigations.
Le bilan biologique permet de classer l’hyperlipidémie : cholestérol total,
triglycérides, LDL-cholestérol, HDL-cholestrerol.
Evolution, complications et pronostic.
L’athérome (dépôts lipidiques dans la paroi des artères ayant pour conséquence
une athérosclérose >) à l’origine d’atteintes cardiovasculaires et, plus
rarement, la pancréatite sont les deux principales complications.
Traitement.
Il comprend le traitement de la cause dans les formes secondaires, ainsi que des
mesures diététiques et des médicaments (résines échangeuses d’ions, les statines
et les dérivés des fibrates).
Prévention et éducation.
Les formes familiales doivent être diagnostiquées et traitées précocement pour
limiter les complications. La compliance au régime nécessite une prise en charge
multi professionnelle (médicale, diététicienne, psychologue…), ainsi qu’une
éducation diététique du patient.
1166. HYPERLIPIDEMIE DE TYPE I ou HYPERCHYLOMICRONEMIE ou HYPERTRIGLYCERIDEMIE
EXOGENE
Hyperlipidémie héréditaire, de transmission autosomique récessive. Elle est
exceptionnelle (1 cas sur 1 million) et due à un déficit enzymatique qui
entraine une accumulation de chylomicrons (triglycérides en suspension dans le
sang). La principale complication est la pancréatite. Le traitement comporte un
régime très restrictif en graisse et l’utilisation de triglycérides à chaines
moyennes .
1167. HYPERLIPIDEMIE DE TYPE IIA ou HYPERCHOLESTEROLEMIE PURE
Définitions et causes.
Surcharge de l’organisme en cholestérol. Il s’agit soit d’une forme héréditaire,
de transmission Autosomique dominante, soit d’une forme essentielle sans
antécédents familiaux.
Epidémiologie
La forme familiale touche 1 personne sur 500. La forme essentielle est encore
plus fréquente.
Signes et symptômes
Le tableau clinique dépend du taux de cholestérol et correspond au dépôt de
cholestérol dans différents tissus: arc cornéen (arc blanchâtre à la périphérie
de la cornée), xanthélasma (dépôt jaunâtre sur les paupières), xanthomes (>)
tendineux et cutanés.
Investigations
Le cholestérol total est augmente par augmentation de la fraction LDL, alors que
la HDL est normale ou basse. Les triglycérides sont normaux.
Evolution, complications et pronostic.
Le risque d’athérome est majeur avec des accidents coronariens et des accidents
vasculaires ischémiques cérébraux qui peuvent se manifester très jeune (avant 20
ans) dans les formes les plus sévères.
Traitement.
La première étape du traitement consiste en un régime adapte : diminution de la
viande rouge, de la charcuterie, des abats, du fromage, des œufs, du beurre au
profit du poisson, de la viande blanche, des légumes et des huiles végétales.
Les différents médicaments utilises sont les résines échangeuses d’ion, les
fibrates et les statines.
Prévention et éducation.
La détection et le traitement les plus précoces possibles dans les formes
familiales permettent de diminuer le nombre des complications liées à
l’athérome. L’éducation diététique du patient est essentielle.
1168. HYPERLIPIDEMIE DE TYPE II B. Elévation du cholestérol et des triglycérides
avec le plus souvent un taux de HDL-cholesterol abaisse. Elle est le plus
souvent héréditaire, de transmission autosomique dominante. C’est une affection
fréquente (1 personne sur 200) qui se démasque généralement après 25 ans. Le
principal risque est l’athérome. Le traitement fait appel à l’éducation
diététique et aux médicaments hypolipérniants (fibrates, statines).
1169. HYPERLIPIDEMIE DE TYPE III ou (>) DYSBETALIPOPROTEINEMIE.
1170. HYPERLIPIDEMIE DE TYPE IV ou (>) HYPERTRIGLYCERIDEMIE DE TYPE IV.
1171. HYPERLIPIDEMIE DE TYPE V ou (>) HYPERTRIGLYCERIDEMIE DE TYPE V.
1172. HYPERLORDOSE LOMBAIRE. Exagération de la cambrure naturelle du rachis au
niveau lombaire. Elle s’observe le plus fréquemment chez les femmes après la
ménopause (syndrome trophostatique de la post-ménopause). La principale
manifestation consiste en des douleurs diffuses. Le traitement est axé sur le
repos sur un plan dur, les antalgiques et la kinésithérapie.
1173. HYPERMETROPIE.
Définition et causes.
Un œil est hypermétrope lorsque l’image d’un objet situe à l’ infini se forme en
arrière de la rétine. La cause la plus fréquente est un petit œil dont l’axe
antéropostérieur est plus court que la normale.
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente, mais moins que la myopie. Selon son degré, elle
se manifeste soit très jeune, soit parfois après 40 ans.
Signes et symptômes.
Le sujet ne voit net à aucune distance et il est gêné dans la vision de près qui
nécessite un effort d’accommodation supplémentaire.
Investigations.
La skiascopie (détermination de la réfraction totale) permet le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Elle peut entrainer un strabisme du aux efforts d’accommodation.
Traitement.
La correction par lunettes ou lentilles est efficace. Le traitement chirurgical
est exceptionnel.
Prévention.
La correction est d’autant plus nécessaire que l’hypermétropie est importante et
que le sujet avance en âge.
1174. HYPERNEPHROME (>) CANCER DU REIN.
1175. HYPEROSTOSE VERTEBRALE ANKYLOSANTE.
Définition et causes
Atteinte du rachis caractérisée par des excroissances osseuses (ostéophytes)
très importantes constituant une sorte de gaine autour des vertèbres. La cause
est inconnue. Elle est également appelée mélorhéostose vertébrale ou syndrome de
Forestier et Rotes-Quérol.
Epidémiologie
Affection assez fréquente. Elle touche surtout l’homme après 50 ans (trois hommes pour une femme), souvent obese et atteint d’un diabète non insulinodépendant.
Signes et symptômes
L’atteinte est souvent asymptomatique. Le rachis est raide et il existe parfois
des douleurs intermittentes et modérées.
Investigations
Les radiographies du rachis permettent le diagnostic.
Evolution, complications et pronostics
D’autres localisations sont souvent associées : hanche, crêtes iliaques, coudes,
calcanéum, genoux… L’évolution se fait vers l’arthrose (>).
Traitement
Le traitement comprend, en cas de besoin, des anti-inflammatoires, des
décontracturants et la kinésithérapie
Prévention et éducation
L’éducation du patient consiste à l’apprentissage d’exercices pour limiter les
contraintes sur son rachis (Ecole du dos).
1176. HYPERPARATHYROIDIE PRIMITIVE
DEFINITIONS ET CAUSES.
Conséquence d’une production inappropriée et excessive d’hormone
parathyroïdienne (PTH = hormone intervenant dans l’équilibre phosphocalcique),
par une ou plusieurs glandes parathyroïdes. La principale cause est l’adénome
parathyroïdien unique d’une glande parathyroïde.
EPIDEMIOLOGIE.
La prévalence est de 100 cas/100000 habitants, ce qui en fait la troisième endocrinopathie après le diabète et l’hyperthyroïdie. Elle peut s’observer à tout âge mais prédomine entre 40 et 65 ans et touche deux fois plus de femmes que d’hommes.
SIGNES ET SYMPTOMES.
Elle est asymptomatique dans 80 % des cas. Sinon, elle se révèle par des signes
d’hypercalcémie et, en particulier, une lithiase rénale.
INVESTIGATIONS.
La biologie indique une hypercalcémie, une hypophosphatémie, une augmentation de
la PTH. Les radiographies du crane et des os longs révèlent des lésions
ostéolytiques a type de géodes (cavités) ou d’ostéoporose diffuse. La tumeur
sera localisée par la scintigraphie ou lors d’une cervicotomie exploratrice.
EVOLUTION, COMPLICATIONS ET PRONOSTIC.
L’évolution est chronique avec des poussées nécessitant un traitement en
urgence. Les complications sont une pancréatite, une insuffisance rénale, des
fractures et des ulcères gastriques multiples. Le pronostic est bon à long terme
après un traitement chirurgical.
TRAITEMENT.
II est chirurgical avec exérèse de l’adénome.
PREVENTION.
Dans les formes asymptomatiques, une simple surveillance est suffisante. II faut
éviter l’immobilisation prolongée.
1177. HYPERPARATHYROIDIE SECONDAIRE Conséquence d’une production inappropriée et
excessive d’hormone parathyroïdienne (PTH), hormone intervenant dans l’équilibre
phosphocalcique, par une ou plusieurs glandes parathyroïdes sous l’influence
d’une autre affection provoquant un trouble du métabolisme du calcium.
1178. HYPERPHOSPHASIE HEREDITAIRE Maladie osseuse héréditaire à transmission
autosomique récessive, elle apparait dès l’enfance et est caractérisée par
• Un gros crane, parfois bosselé, à la voute épaisse.
• Une évacuation, un épaississement et une fragilité des os longs.
• Des taux très élevés de phosphatases alcalines sanguines et d’hydroxyproline.
Le traitement par calcitonine peut améliorer certains patients.
1179. HYPERPLASIE CONGENITALE DES SURRENALES.
Définitions et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique récessive, caractérisée par une
insuffisance surrénale et des anomalies de la différentiation sexuelle. Elle est
due à un déficit enzymatique touchant, a un niveau variable, une des étapes de
la biosynthèse du cortisol. La forme classique est sévère avec un début
d’expression in utero; la forme lente est moins sévère et d’expression plus
tardive.
Epidémiologie.
La forme classique survient dans 1/15 000 naissances avec une incidence très
grande dans les populations a fort taux de consanguinité (La Réunion). La
fréquence de la forme lente est difficile à évaluer, mais semble élevée (1/1 000
dans certaines ethnies).
Signes et symptômes.
La forme classique présente un pseudohermaphrodisme féminin (masculinisation des
filles) avec malformation génitale. Chez le nourrisson, elle peut se révéler par
un ‘syndrome de perte de sel’ avec hyponatrémie, hyperkaliémie, hypoglycémie,
hypotension et choc. Dans la forme lente, les organes génitaux externes sont
normaux a la naissance, mais il existe une pseudo¬puberté précoce clans les deux
sexes et des signes d’hyperandrogénie (acné, hirsutisme, irrégularités
menstruelles, stérilité) après la puberté chez la fille.
Investigations.
Elles comprennent le dosage de la 17-hydroxyprogesterone avec un test à l’ACTH
dans la forme lente.
Evolution, complications et pronostic.
L’absence de traitement du ‘syndrome de perte de sel’ entraine un décès rapide.
Dans les formes traitées, la fonction de reproduction est normale.
Traitement.
II associe la substitution hormonale (hydrocortisone et minéralocorticoïde) et
la réparation chirurgicale des malformations sexuelles.
Prévention.
La prévention implique un diagnostic et un traitement anténatal. Un dépistage
néonatal systématique au troisième jour de vie est obligatoire depuis quelques
années.
1180. HYPERPLASIE EPITHELIALE FACIALE DE HECK ou (>) HECK (MALADIE DE).
1181. HYPERPLASIE NODULAIRE FOCALE DU FOIE
Définition et causes.
Tumeur bénigne formée de nodules d’hépatocytes, séparés par des travées
fibreuses. Dans deux tiers des cas, il existe une seule tumeur et, dans un tiers
des cas, deux a cinq, voire plus. La cause semble être une hyper vascularisation
d’une partie du foie par une artère hépatique.
Epidémiologie.
Tumeur rare qui affecte principalement la femme entre 15 et 40 ans. La
contraception orale semble un facteur favorisant.
Signes et symptômes.
Asymptomatique dans la majorité des cas. Il existe parfois des douleurs de
l’hypochondre droit et une masse palpable.
Investigations.
L’échographie, le scanner et l’IRM permettent le diagnostic
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est bénigne. Les hémorragies intra tumorales et intrapéritonéales
sont exceptionnelles.
Traitement.
L’abstention thérapeutique est la règle.
1182. HYPERPROLACTINEMIE
Définition et causes.
Augmentation de la production de prolactine qui à pour rôle de provoquer et de
maintenir la lactation chez la femme enceinte. Les deux principales causes sont
les tumeurs (adénomes hypophysaires = prolactinomes) et les médicaments
(neuroleptiques, ‘pilules’).
Epidémiologie.
Relativement fréquent.
Signes et symptômes.
Chez la femme, il existe un arrêt des règles et un écoulement laiteux par les
mamelons (syndrome aménorrhée-galactorrhée). Chez l’homme, s’agit d’une
impuissance et du développement des seins (gynécomastie). Des signes en rapport
avec une éventuelle tumeur sont possibles : céphalées, troubles visuels.
Investigations.
Le taux de prolactine sanguine est élevé. Le scanner et 1’IRM recherchent une
tumeur.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement médical permet une récupération de la fertilité dans près de 90 %
des cas. Le principal risque est celui d’une poussée tumorale au cours de la
grossesse en cas de prolactinome déjà volumineux.
Traitement.
L’arrêt d’un éventuel médicament en cause est la première mesure. Le traitement
médical utilise la bromocriptine . La chirurgie est utilisée en cas de signes
cliniques, notamment visuels, liés à la tumeur.
1183. HYPERSOMNIE IDIOPATHIQUE. Maladie rare (entre 6 000 et 9 000 cas en
France) caractérisée par un sommeil nocturne et diurne d’une durée excessive,
souvent supérieure à 16 heures par jour, sans qu’aucune anomalie ne puisse
expliquer ce trouble. Les premiers symptômes apparaissent après l’âge de 30 ans
et la maladie dure toute la vie. Le traitement est identique à celui de la
narcolepsie (>).
1184. HYPERSPLENISME.
Définition et causes.
Syndrome associant une splénomégalie (grosse rate) et une cytopénie (diminution
des éléments d’une ou plusieurs lignées sanguines). Les principales causes sont
la cirrhose du foie, la thrombose des veines porte ou splénique, les syndromes
lympho-et myeloprolifératifs, les maladies de surcharge (par exemple, maladie de
Gaucher) et les maladies de système (par exemple, lupus).
Signes et symptômes.
En plus de la splénomégalie palpable, les cytopénies peuvent provoquer des
symptômes: infections en cas de leucopénie, purpura ou hémorragie muqueuse en
cas de thrombopénie ou symptômes d’anémie.
Investigations.
La séquence des examens comprend : un hémogramme, un myélogramme, une
scintigraphie et un scanner de la rate.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic est lié à celui de la maladie causale. Les sujets sans rate sont
plus sensibles aux infections.
Traitement.
Dans la majorité des cas, it faut traiter la maladie causale. Les indications de
la splénectomie et de la radiothérapie aux formes graves avec un retentissement
de la cytopénie.
Prévention.
La vaccination antipneumococcique est indiquée chez les splénectomisés.
1185. HYPERTENSION ARTERIELLE
Définitions et causes.
Au-delà de 140/90 mmHg, la pression artérielle est considérée comme anormale.
Dans 95 % des cas, aucune cause n’est retrouvée et on parle d’hypertension
artérielle essentielle. Les autres causes sont surrénales (phéochromocytome,
syndrome de Conn, syndrome de Cushing), rénales (atteinte des artères rénales,
néphropathies) ou toxiques (oestroprogestatifs, réglisse, anti-inflammatoires
non stéroïdiens…)
Epidémiologie.
On estime à 7 millions le nombre d’hypertendus en France. L’hypertension
multiplie par deux le risque de mortalité cardiovasculaire (accident vasculaire
cérébral, infarctus).
Signes et symptômes.
Dans la grande majorité des cas, l’hypertension est asymptomatique. Les signes
évocateurs sont des vertiges, des céphalées, des acouphènes (sifflements
d’oreille), des mouches volantes devant les yeux.
Investigations.
La mesure doit se faire sur un sujet allongé depuis 15 minutes. Elle s’effectue
aux deux bras, en position couchée et debout. Pour affirmer le caractère
permanent de l’hypertension, il faut retrouver des chiffres élevés à plusieurs
reprises.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont l’insuffisance coronaire, les accidents
vasculaires cérébraux, la cardiomyopathie hypertrophique, les lacunes cérébrales
(micro-infarctus cérébraux) et l’atteinte rénale (nephro-angiosclérose).
Traitement.
Le changement du mode de vie est la première mesure : amaigrissement, diminution
de la consommation d’alcool, activité physique régulière, diminution des apports
de sel, arrêt du tabac. En cas de réponse inadaptée, le traitement médicamenteux
est instauré d’abord avec un seul médicament, puis deux, voire trois en
association (diurétiques, (3-bloquants, inhibiteurs de l’enzyme de conversion,
inhibiteurs calciques, a-bloquants, inhibiteurs de l’angiotensine II). Dans les
formes secondaires, le traitement de la cause est essentiel.
Prévention et éducation.
Le traitement de l’hypertension artérielle diminue fortement (de plus d’un
tiers) le risque d’accident vasculaire cérébral et plus modestement (10 a 15 %)
celui de l’insuffisance coronaire. L’éducation du patient à l’auto mesure
tensionnelle contribue au succès du traitement.
1186. HYPERTENSION ARTERIELLE PULMONAIRE PRIMITIVE
Définitions et causes.
Maladie caractérisée par une atteinte occlusive des artères pulmonaires de moyen
et de petit calibre. La cause est inconnue.
Epidémiologie.
Très rare. L’âge de survenue le plus fréquent se situe entre 30 et 40 ans, avec
une prédominance féminine. Certains anorexigènes ont été incriminés.
Signes et symptômes.
Le principal signe est une dyspnée d’effort progressive. Des douleurs
thoraciques et des syncopes sont possibles.
Investigations.
L’échographie cardiaque retrouve une hypertrophie et une dilatation du cœur
droit et évalue la pression artérielle pulmonaire. Les gaz du sang montrent une
hypoxie et une hypocapnie.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait vers le décès par insuffisance cardiaque droite ou mort
subite dans les deux a cinq ans après le diagnostic.
Traitement.
Les médicaments utilises sont les vasodilatateurs (notamment des prostacyclines)
mais cet emploi nécessite des explorations hémodynamiques avec un test
d’efficacité, car ils peuvent aggraver la maladie. Les anticoagulants sont
recommandés. En cas d’échec, le seul recours reste la transplantation pulmonaire
ou cœur-poumon (aucune récidive n’a été rapportée).
1187. HYPERTENSION ARTERIELLE RENOVASCULAIRE
Définitions et causes.
Forme d’hypertension artérielle due à une sténose des artères rénales. Cette
hypertension est la conséquence d’une ischémie rénale due, dans deux cas sur
trois, à des lésions athéroscléreuses des artères rénales (touche plutôt l’homme
après la cinquantaine) et, dans un cas sur trois, à une anomalie de la paroi
musculaire des artères (touche plutôt les femmes jeunes).
Epidémiologie
Cette forme ne représente que 2 a 5 % des patients hypertendus.
Signes et symptômes
L’hypertension artérielle est en général sévère avec une pression diastolique
supérieure à 110 mmHg sans traitement. Le tableau est souvent celui d’une
hypertension artérielle résistante à un traitement bien suivi.
Investigations
L’exploration du système rénine-angiotensine par cathétérisme des veines rénales
montre une élévation concomitante de la rénine et de l’aldostérone, souvent
associée à une hypokaliémie. L’échographie et la scintigraphie rénales explorent
la morphologie et la fonction rénale. La mise en évidence de la sténose est
réalisée par l’echodoppler (difficile à réaliser) et, surtout, l’angiographie
des artères rénales.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications aigues sont la crise hypertensive et l’œdème aigu
du poumon. En l’absence de traitement rapide, des lésions viscérales
apparaissent : atteinte rétinienne, insuffisance rénale, ischémie myocardique,
insuffisance cardiaque, accidents vasculaires cérébraux…
Traitement.
Le traitement de choix est l’angioplastie (dilatation de l’artère par un
cathéter introduit par voie cutanée). En cas d’échec, la chirurgie est indiquée.
Le traitement médicamenteux est difficile, d’autant que les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion sont contre-indiqués en cas de sténose bilatérale ou de
sténose sur rein unique et doivent être manies avec précaution dans les autres
cas.
1188. HYPERTENSION INTRACRANIENNE
Définition et causes.
Augmentation de la pression intracrânienne (normale = 10 mmHg) entrainant une
compression des structures nerveuses qui peut entrainer la mort. Les principales
causes sont une tumeur, un abcès, un accident vasculaire cérébral (hémorragie,
infarctus, phlébite) ou un traumatisme. La forme dite ‘bénigne’, dont les causes
exactes sont discutées, est particulière.
Epidémiologie.
Sa fréquence est directement liée à celle de ses causes.
Signes et symptômes.
Les trois signes principaux sont:
• Les céphalées a type de serrement ou de tension et insensibles aux
antalgiques;
• Les vomissements en jet qui surviennent au maximum des accès de céphalées et
qui les soulagent ;
• L’obnubilation avec un ralentissement et une somnolence.
Investigations.
Le fond d’œil retrouve un œdème papillaire. Le scanner et l’IRM permettent de
faire le diagnostic et de retrouver la cause. La ponction lombaire est
contre-indiquée car elle risque d’aggraver l’état clinique (engagement).
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est l’engagement qui est une hernie d’une partie de
l’encéphale, sous l’effet de la pression, à travers les orifices de la boite
crânienne (faux du cerveau, tente du cervelet, trou occipital…). Sa traduction
clinique est des troubles de la conscience évoluant vers le coma, des crises
convulsives et une évolution vers l’arrêt cardiorespiratoire. Dans la forme
‘bénigne’, il n’y a pas d’engagement et le pronostic est uniquement visuel avec
un risque d’atrophie optique et de cécité.
Traitement.
Le traitement symptomatique utilise les corticoïdes, les solutés osmotiques en
perfusion (mannitol) et la dérivation du liquide céphalorachidien dans certains
cas. Il est complet par le traitement de la cause.
1189. HYPERTENSION PORTALE.
Définition et causes.
Augmentation de la pression sanguine dans la veine porte. Elle est due à un
obstacle à l’écoulement sanguin au niveau du foie (cirrhose), au niveau de la
veine porte (tumeur) ou au niveau des veines sus-hépatiques (par exemple,
syndrome de Budd-Chiari >).
Epidémiologie.
La cirrhose du foie, notamment d’origine éthylique, est la principale
pourvoyeuse d’hypertension portale.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont une augmentation de volume de la rate
(splénomégalie), l’apparition de veines au niveau de la paroi abdominale
(circulation collatérale), une ascite et le développement de varices
œsophagiennes (>).
Investigations.
L’échographie, le scanner et l’IRM permettent de faire le diagnostic et de
détecter la cause de l’hypertension portale.
Evolution, complications et pronostic.
La complication la plus grave est l’hémorragie par rupture de varices
œsophagiennes. La splénomégalie peut entrainer une thrombopénie et une anémie
par hyperfonctionnement (hypersplénisme).
Traitement.
II s’agit essentiellement de prévenir les récidives des hémorragies digestives
en utilisant les bétabloquants, la sclérothérapie ou la ligature des varices,
l’anastomose portocave et la mise en place de shunts par voie transjugulaire
(TIPS : transjugular intrahepatic portal systemic shunt).
Prévention.
La prévention réside dans la lutte contre l’alcoolisme chronique
1190. HYPERTHERMIE MALIGNE
Définitions et causes.
Trouble caractérisé par une augmentation rapide de la température lors de
l’utilisation d’anesthésiques volatiles (halothane principalement) ou de curares
. Il s’agit le plus souvent d’une anomalie héréditaire de transmission
autosomique dominante (anomalie d’un récepteur musculaire).
Epidémiologie.
La fréquence de l’hyperthermie maligne est de 1/40 000. La forme héréditaire est
comprise entre 1/50 000 et 1/100 000).
Signes et symptômes.
La fièvre est comprise entre 39 °C et 42 °C. Elle est accompagnée de
contractures musculaires, d’une hypotension, d’une cyanose et de troubles du
rythme cardiaque.
Investigations.
A distance de l’accident, des tests fonctionnels sur des fibres musculaires
prélevées par biopsie permettront d’affirmer le diagnostic (mais leur
réalisation est difficile).
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement immédiat, révolution se fait vers la mort.
Traitement.
II comporte l’arrêt immédiat de la chirurgie, l’arrêt des anesthésiques
volatils, le refroidissement externe et l’injection de dantrolène par voie
intraveineuse.
Prévention.
La détection des familles à risques est essentielle. La prévention consiste en
l’interdiction des produits concernes et l’administration de dantrolène dans les
jours précédant l’intervention.
1191. HYPERTHYROIDIE
Définitions et causes.
Hyperfonctionnement thyroïdien avec augmentation de la production des hormones
thyroïdiennes dont la conséquence est la thyrotoxicose. Les causes sont la
maladie de Basedow (>), un nodule toxique, une induction par l’iode, une
thyroïdite, une atteinte auto-immune familiale, une grossesse, une affection
hypophysaire.
Epidémiologie
Elle touche 1 a 2 % de la population, avec une très nette prédominance féminine.
Signes et symptômes
Tous les signes de thyrotoxicose sont en rapport avec une accélération du
métabolisme : nervosité, tremblements, tachycardie, amaigrissement, soif,
hypersudation, thermophobie, diarrhée, faiblesse musculaire. Il existe un goitre
ou un nodule thyroïdien et une exophtalmie (saillie du globe oculaire hors de
l’orbite) en cas de maladie de Basedow.
Investigations
La T3 (et T4) sont augmentées avec une TSH effondrée. Les investigations
comprennent, en outre, une échographie, une scintigraphie a l’iode, le dosage
des anticorps anti récepteur de TSH (maladie de Basedow) et un
électrocardiogramme.
Evolution, complications et pronostic
Une régression spontanée est possible (thyroïdites, prise d’iode). L’évolution
s’effectue par poussées (maladie de Basedow) ou par aggravation progressive. La
principale complication est la crise aiguë thyrotoxique, qui associe
hyperthermie, déshydratation et défaillance cardiaque avec une évolution vers le
coma et la mort en l’absence de traitement. Des complications ophtalmiques
existent dans la maladie de Basedow.
Traitement
II est variable selon la cause et peut être, seul ou en association, médical
(repos, bétabloquants et antithyroïdiens de synthèse), chirurgical (toujours
après freinage thyroïdien) ou radio isotopique (iode radioactif).
Prévention
Une surveillance hématologique est nécessaire en cas d’utilisation
d’antithyroïdiens de synthèse.
1192. HYPERTRICHOSE LANUGINEUSE ACQUISE Affection très rare caractérisée par
l’apparition d’un duvet de poils doux et soyeux sur la peau glabre (sans poils)
de la face, des joues, du nez, des oreilles, des paupières, du cou, du tronc et
des extrémités. En revanche, les zones normalement pileuses ne semblent pas
modifiées. II n’y a pas de signes de virilisation. II s’agit du premier signe
d’un cancer (digestif, vésical, pulmonaire ou lymphome), qui n’est parfois
diagnostique que plusieurs années plus tard.
1193. HYPERTRIGLYCERIDEMIE EXOGENE ou (>) HYPERLIPIDEMIE DE TYPE I.
1194. HYPERTRIGLYCERIDEMIE DE TYPE IV ou HYPERLIPIDEMIE DE TYPE IV.
Hypertriglycéridémie pure qui est soit une surcharge pondérale, une consommation
d’alcool et/ou a une résistance a l’insuline, soit d’origine familiale, de
transmission autosomique dominante. Les taux de triglycérides sont très élevés
(> 10 g/L) La principale complication est la pancréatite. La diététique et le
sevrage d’alcool sont souvent suffisants, parfois les fibrates sont nécessaires.
.
1195. HYPERTRIGLYCERIDEMIE DE TYPE V ou HYPERLIPIDEMIE DE TYPE V. Forme très
rare d’hypertriglycéridémie qui regroupe les caractéristiques des
hyperlipidémies de type I et de type IV.
1196. HYPOCALCEMIE HYPERCALCIURIQUE FAMILIALE.
Image en miroir de l’hypercalcémie hypocalciurique familiale, qui est également
de transmission autosomique dominante. L’hypocalcémie est franche (entre 1,25 et
2 mmol/L, souvent découverte lors d’un bilan familial systématique). Le
traitement de l’hypocalcémie dépend de sa sévérité et de ses répercussions
cliniques éventuelles.
1197. HYPOCALCEMIE NEONATALE.
Définition et causes.
Calcémie inferieure à 1,9 mmol/L dans les premiers jours de vie. La forme
précoce débute dans les deux premiers jours de vie chez un prématuré, un enfant
de mère diététique ou en cas de souffrance fœtale. La forme tardive se déclare
chez le nouveau-né à terme à partir du cinquième jour et est le plus souvent du
à une carence en vitamine D chez la mère.
Épidémiologie.
L’incidence est plus faible chez les mères supplémentées en vitamine D (0,21 %
contre 0,55 %).
Signes et symptômes.
Association de trémulations (doigts et menton), de vomissements, d’une tachypnée
(accélération de la respiration) suivie de phases d’apnée et de cyanose, de
convulsions et d’une tachycardie voire d’une défaillance cardiaque.
Investigations.
Elles comprennent un bilan phosphocalcique ainsi qu’un dosage de la parathormone
(PTH) et de la vitamine D3 plasmatique.
Évolution, complications et pronostic.
Les apnées, les convulsions et les troubles cardiaques peuvent entrainer la
mort. L’évolution est favorable sous traitement.
Traitement.
II repose sur un apport oral ou intraveineux de calcium et de vitamine D.
Prévention.
La prévention implique une supplémentation en vitamine D de la femme enceinte au
cours du troisième trimestre de la grossesse.
1198. HYPOCONDRIE ou NEVROSE HYPOCONDRIAQUE
Définition et causes.
Trouble psychiatrique caractérisé par des préoccupations excessives vis-à-vis de
la santé et la crainte anormale d’une maladie grave. Un facteur favorisant est
une personnalité narcissique, caractérisée par un intérêt excessif pour soi-même
et un besoin de dépendance.
Epidémiologie.
Fréquent. Le début se situe vers la trentaine chez l’homme et vers la
quarantaine chez la femme.
Signes et symptômes.
Le patient se plaint de symptômes nombreux, le plus souvent au niveau de
l’abdomen, du thorax, de la tête et du cou. Les symptômes sont décrits avec
minutie, mais ne correspondent a aucune pathologie identifiable. II multiplie
les demandes d’avis et de soins. Parfois, toute son existence s’organise autour
de la maladie.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est chronique et l’hypochondrie est souvent résistante à toute forme
de traitement. L’association à une dépression est un facteur de mauvais
pronostic de la maladie dépressive.
Traitement.
Les seules mesures efficaces sont une relation compréhensive avec le médecin,
associée a une coopération avec la famille afin d’aménager un environnement
favorable évitant que le patient ne grossisse démesurément la signification de
ses sensations.
1199. HYPOGLYCEMIE
Définition et causes.
Baisse de la glycémie en dessous de 0,50 g/L (2,75 mmol/L). Les causes les plus fréquentes sont le diabète, l’alcool et les médicaments, ainsi que les hypoglycémies postprandiales fonctionnelles.
Epidémiologie.
C’est une affection très fréquente.
Signes et symptômes.
Tout signe ou symptôme neurologique et/ou psychiatrique brutal peut être dû a
une hypoglycémie. Des palpitations, des céphalées, des sueurs, une pâleur sont
fréquentes.
Investigations.
La glycémie capillaire donne une orientation mais elle devra être confirmée par
un prélèvement sanguin.
Evolution, complications et pronostic.
La répétition fréquente ou la durée prolongée des hypoglycémies peut entrainer
des séquelles neurologiques.
Traitement.
Il repose sur le resucrage per Os ou, en cas de troubles de la conscience, sur
l’injection de glucagon en IM et surtout de glucosea 30 % en IV. Au réveil, un
complément par des sucres lents (pain) est indispensable.
Prévention et éducation.
La prévention passe par une éducation appropriée du patient diabétique.
1200. HYPOGONADISME.
Définition et causes.
Déficit du fonctionnement des gonades, tant endocrine (hormone) qu’exocrine
(reproduction). Les causes les plus fréquentes sont liées à une anomalie
hypothalamo-hypophysaire (tumeur, problème nutritionnel chez la femme…), une
anomalie testiculaire chez l’homme et ovarienne chez la femme ou des anomalies
génétiques (syndrome de Turner, de Klinefelter, de KallmannMorsier…).
Epidémiologie.
La multiplicité des causes rend ce problème relativement fréquent.
Signes et symptômes.
Les motifs de découverte sont variables selon la cause: anomalie de la
différenciation sexuelle chez le garçon, anomalie du développement pubertaire
chez le garçon et la fille, apparition de troubles des règles chez la femme ou
d’une infertilité, plus rarement des signer d’hyperandrogénie chez l’homme
(diminution de la libido, diminution de la pilosité et de la taille des
testicules…).
Investigations.
Les différents examens utiles sont un bilan hormonal, un scanner et une IRM de
la selle turcique, un spermogramme, un caryotype.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic est plutôt favorable dans les formes liées à une cause
hypothalamo¬hypophysaire : les différents traitements permettent, en général, un
rétablissement de la fertilité.
Traitement.
S’il n’y a pas désir de procréation, le traitement est substitutif (testostérone
chez l’homme, œstrogènes chez la femme). Le traitement de l’infertilité
nécessite l’induction de la spermatogenèse et de l’ovulation. Les produits
utilises sont les gonadotrophines et, chez la femme, dans certaines indications,
la GnRH en injections pulsatiles a la pompe.
1201. HYPOPARATHYROIDIE.
Définition et causes.
Affection entrainant une insuffisance de sécrétion de parathormone (PTH) qui
intervient dans le métabolisme du calcium, entrainant une hypocalcémie. La cause
la plus fréquente est représentée par les séquelles de la chirurgie
thyroïdienne. Elle peut également être d’origine congénitale ou s’intégrer dans
la polyendocrinopathie de type I (>).
Epidémiologie.
Rare.
Signes et symptômes.
Les symptômes sont ceux de l’hypocalcémie avec un accès tétanique aigu:
sensation de picotements au niveau des extrémités, des lèvres, une contracture
des muscles de la main avec rapprochement des doigts en cône réalisant la
classique ‘main d’accoucheur’. Chez le nourrisson, un laryngospasme avec des
troubles respiratoires ou des convulsions sont possibles.
Investigations.
Les dosages biologiques montrent une hypocalcémie, une hyperphosphatémie, une
hypocalciurie et une parathormone abaissée ou normale. L’électrocardiographie
retrouve un allongement de l’espace QT et l’électromyogramme une
hyperexcitabilité neuromusculaire.
Evolution, complications et pronostic.
Les complications a long terme sont oculaires (cataracte) et cutanées (peau
sèche, ongles stries et cassants, cheveux fragiles).
Traitement.
Lors de l’accès aigu, l’injection intraveineuse de calcium (gluconate de
calcium) s’impose. Le traitement au long cours comprend l’association de calcium
et de vitamine D.
Prévention.
La prévention nécessite une chirurgie très précautionneuse de la thyroïde pour
préserver les glandes parathyroïdes
1202. HYPOPHOSPHATASIE INFANTILE ou SYNDROME DE RATHBUN.
Maladie métabolique héréditaire, de transmission autosomique récessive,
caractérisée par une décalcification diffuse du squelette. Elle se manifeste
chez le nourrisson par des malformations osseuses (crane, membres), une
maigreur, des troubles digestifs et des convulsions. Le bilan biologique montre
des taux de calcium et de phosphore normaux et une diminution des phosphatases
alcalines sanguines. L’évolution est, en général, rapidement mortelle.
1203. HYPOPHOSPHATEMIE FAMILIALE ou RACHITISME VITAMINORESISTANT.
Définition et causes.
Maladie héréditaire, de transmission dominante liée au chromosome X, qui
entraine un trouble de la minéralisation osseuse vitaminorésistant. Un trouble
rénal affectant la réabsorption du phosphore semble être à l’origine de la
maladie.
Epidémiologie.
Rare.
Signes et symptômes.
Le principal signe est une déformation des membres inferieurs qui apparait entre
1 et 2 ans. II existe, en outre, un retard de croissance.
Investigations.
Les radiographies montrent des anomalies caractéristiques. Le bilan biologique
retrouve une phosphorémie très basse, avec une fuite urinaire de phosphore.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement est efficace mais la taille est généralement inferieure a la
normale à l’âge adulte. La maladie devient, en général, asymptomatique vers
l’âge de 20 ans.
Traitement.
II associe de fortes doses de phosphore et de 1-alpha-cholecalciferol ou de
1,25-dihydroxycholecalciferol . Une surveillance étroite de la calcémie et de la
calciurie est indispensable (risque d’hypocalcémie et d’hyperparathyroïdie).
1204. HYPOPITUITARISME ou (>) INSUFFISANCE ANTEHYPOPHYSAIRE.
1205. HYPOPLASIE RENALE SEGMENTAIRE. Défaut de développement d’un rein qui se
traduit par une hypertension artérielle sévère. Un reflux vésicorénal avec une
dilatation des cavités associée. Le traitement médicamenteux de l’hypertension
est parfois suffisant, sinon une ablation du rein (néphrectomie) doit être
envisagée.
1206. HYPOSPADIAS.
Malformation de l’urètre très fréquente (touche 1 garçon sur 300) caractérisée
par une malposition de l’ouverture du méat urinaire, situe plus en arrière sur
le gland, dans les formes mineures, voire a la face inferieure de la verge ou au
niveau de la jonction pénis-scrotum. Une coudure de la verge est souvent
associée. Le traitement est chirurgical et donne d’excellents résultats.
1207. HYPOTENSION ARTERIELLE ORTHOSTATIQUE. Chute de la pression artérielle lors
du passage de la position couchée a la position debout. Elle peut s’accompagner
d’un malaise, avec vertiges, troubles visuels et, parfois, perte de
connaissance. Les principales causes sont l’effet secondaire d’un médicament, le
vieillissement et la période postprandiale. De nombreuses affections
(neurologiques, endocriniennes…) peuvent également être en cause. Le
traitement est essentiellement celui de la cause. II est conseille aux patients
de se lever par étapes
1208. HYPOTHERMIE.
Définition et causes.
Température inferieure à 35,5 °C. Les principales causes de survenue sont les
intoxications, des conditions d’isolement et de pathologies associées chez le
sujet âge, l’anesthésie générale prolongée et certaines perturbations hormonales
(hypothyroïdie…).
Epidémiologie.
C’est un problème rencontre fréquemment dans les services d’urgence.
Signes et symptômes.
La peau est froide et livide. Les frissons disparaissent en dessous de 34 °C et
font place à une rigidité progressive. En dessous de 32 °C apparaissent des
troubles de la conscience, qui s’aggravent jusqu’a un coma calme avec une
bradypnée (diminution des mouvements respiratoires), une bradycardie et une
hypotension vers 28 °C.
Investigations.
L’électrocardiogramme montre un élargissement des complexes et, parfois, l’onde
J d’Osborne (déflexion positive après le QRS), qui est caractéristique.
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement, l’évolution se fait vers un arrêt
cardiorespiratoire. Lors du réchauffement, le principal risque est la survenue
de troubles du rythme ventriculaire de mauvais pronostic; le choc électrique est
rarement efficace en dessous de 32 °C.
Traitement.
La remontée se fait au rythme de 0,5 à 1 °C par heure par un réchauffement
externe ou interne, actif ou passif. Le réchauffement actif interne utilise la
ventilation avec des gaz réchauffés, le lavage d’estomac ou péritonéal et la
circulation extracorporelle.
Prévention.
La principale prévention concerne les SDF et les personnels âgés (mesures
sociales).
1209. HYPOTHYROIDIE.
Définition et causes.
Insuffisance de sécrétion hormonale de la glande thyroïde entrainant un
ralentissement de l’ensemble du métabolisme. Les principales causes sons
l’atrophie liée à l’âge, les thyroïdites, la iatrogénie (amiodarone ou autres
médicaments, iode 131, thyroïdectomie, radiothérapie), la carence en iode, une
atteinte hypothalamo-hypophysaire et les formes congénitales.
Epidémiologie.
La forme frustre touche 3 % des hommes, 7,5 % des femmes et jusqu’a 10 % de la
population âgée. Elle se rencontre préférentiellement chez la femme de plus de
40 ans avec une augmentation nette après 75 ans.
Signes et symptômes
Association d’une bouffissure du visage, des mains et des pieds (myxœdème)
entrainant une prise de poids, d’une raréfaction des cheveux, d’ongles cassants,
d’un ralentissement psychique et moteur avec une asthénie physique,
intellectuelle et sexuelle, de crampes, d’une dyspnée d’effort, d’une anorexie
et d’une constipation, d’une frilosité et d’une hypothermie modérée.
Investigations.
Le diagnostic repose sur le dosage des hormones thyroïdiennes et de la TSH,
éventuellement complète par un test a la TRH.
Evolution, complications et pronostic.
La complication la plus grave, mais rare, est le coma myxœdémateux avec un taux
de mortalité de 50 %. Les autres complications sont cardiaques (insuffisance
coronaire, péricardite, insuffisance cardiaque). Sous traitement, le pronostic
est excellent.
Traitement.
Il est fonde sur l’apport d’hormones de synthèse de substitution.
Prévention et éducation.
Le traitement substitutif est a vie. Le patient doit être informe de l’intérêt
d’une bonne observance, ainsi que des signes de sous- ou de surdosage.
1210. HYPOTHYROIDIE DE L’ENFANT.
Définition et causes.
Insuffisance totale ou partielle de la glande thyroïde. Les principales causes
sont une absence totale de thyroïde, le développement d’une thyroïde en position
anormale (ectopique), en général au niveau de la base de la langue, ou un
trouble de la synthèse des hormones thyroïdiennes.
Epidémiologie.
C’est la plus fréquente des maladies endocriniennes congénitales: elle touche
1/3 000 a 4000 enfants. Le dépistage systématique a la naissance depuis la fin
des années soixante-dix a fait disparaitre les formes classiques de découverte
tardive: retard psychomoteur avec nanisme (‘cretinisme’ hypothyroïdien).
Signes et symptomes.
Aujourd’hui, les signes de découverte sont une petite taille avec un retard de
maturation osseuse, une obésité, un ralentissement des acquisitions, des
difficultés scolaires.
Investigations.
Le dosage des hormones thyroïdiennes affirme le diagnostic (TSH élevée et T4
basse). La recherche d’anticorps antithyroïdiens et la scintigraphie permettent
de rechercher la cause.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement est généralement efficace. Dans les formes à dépistage tardif, le
retard de croissance ne se comble pas totalement et des difficultés
psychologiques peuvent persister.
Traitement.
Le traitement utilise l’apport des hormones manquantes (L-Thyroxine ).
Prévention.
Le dépistage systématique se fait au troisième jour de vie pas dosage de la TSH
sur du sang sèche (papier buvard envoyé dans des laboratoires spécialisés). Des
faux négatifs (enfants déclarés normaux) restent possibles et imposent un dosage
des hormones thyroïdiennes chez tout enfant présentant une petite taille.
1211. HYPOTROPHIE FOETALE ou RETARD DE CROISSANCE INTRA-UTERIN.
Définition et causes.
Il s’agit d’un poids de naissance inferieur a la normale attendue pour l’âge
gestationnel. Les causes sont génétiques (anomalies chromosomiques, maladies
métaboliques …) toxiques (alcool, drogues, médicaments…), infectieuses
(toxoplasmose, placentaires, utérines ou socio¬économiques. Dans 20 % des cas,
la cause reste inconnue.
Epidémiologie.
Environ 5 % des enfants nés vivants ont un poids de naissance inferieur a 2 500
g. L’hypotrophie est plus fréquente en cas de prématurité.
Evolution, complications et pronostic.
Chez les enfants de moins de 1 000 g, la mortalité et les séquelles
neurologiques restent importantes.
Traitement.
Le transfert anténatal des femmes a risque dans des centres adaptes (disposant
d’une unité ou d’une réanimation néonatale) est indispensable. Une extraction
fœtale précoce de principe sera discutée dans certains cas avant que ne
survienne une souffrance fœtale aigue.
Prévention.
L’éviction des causes évitables, notamment toxiques, ainsi qu’une surveillance
accrue en présence de facteurs de risque sont les bases de la prévention.
1212. HYPOVENTILATION ALVEOLAIRE PRIMITIVE ou (—>) ONDINE (MALEDICTION D’).
1213. HYSTERIE ou NEVROSE HYSTERIQUE.
Définition et causes.
Névrose (trouble du fonctionnement du système nerveux sans altération
anatomique, ni trouble de la personnalité dans lequel le patient est conscient
des symptômes mais ne peut s’en débarrasser) caractérisée par un large éventail
de troubles corporels et/ou psychiques qui permettent l’expression de conflits
inconscients.
Epidémiologie
Elle commence en général durant l’adolescence ou chez l’adulte jeune avec une
nette prédominance féminine.
Signes et symptômes.
Les symptômes de conversion (reproduction de presque tous les signes de maladies
organiques) sont associés à des signes sensitifs ou moteurs (incapacité à se
tenir debout ou à marcher, paralysies et contractures qui ne respectent pas la
systématisation anatomique, mouvements anormaux, anesthésies, douleurs, troubles
visuels, auditifs ou de la phonation). On peut observer aussi des crises
d’agitation de type ‘crise de nerfs’ avec des évanouissements. Les troubles
psychiques regroupent des troubles de la mémoire (oublis sélectifs, fabulation),
une inhibition intellectuelle (incapacité à effectuer un effort intellectuel) et
des troubles de la vigilance (états somnambuliques, troubles de l’identité,
stupeur…).
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est conditionnée par le milieu. Lorsque le symptôme a perdu sa
raison d’être ou que les bénéfices secondaires sont devenus négligeables, des
stabilisations rapides sont possibles.
Traitement.
Les moyens utilises sont l’isolement du milieu socio familial, la narco-analyse,
l’hypnose et les thérapies comportementales.
1214. IBIDS SYNDROME. Syndrome congénital dû à une carence en protéines riches
en soufre, qui associe un trouble cutané (ichtyoses), une atteinte des cheveux
(brittle air = trichothiodystrophie), un retard mental (intellectual
impairment), une hypofertilité (decreased fertility) et un nanisme (short
stature). Le diagnostic est confirmé par l’examen des cheveux en lumière
polarisée et sur un dosage des acides aminés soufrés (cystéine, notamment) des
cheveux. En cas de photosensibilité, le syndrome prend le nom de PIBIDS.
1215. ICHTYOSE BULLEUSE DE SIEMENS. Forme d’ichtyose (>) héréditaire transmise
sur le mode autosomique dominant. Elle est caractérisée par un épaississement de
la peau (hyperkératose) diffus pouvant atteindre les paumes et les plantes, et
par des érosions superficielles. L’examen histologique confirme le diagnostic.
1216. ICHTYOSE LIÉE AU SEXE. Forme d’ichtyose (4) liée au chromosome X qui
touche environ 1 garçon sur 6000. Elle débute chez le nouveau-né ou le
nourrisson. Les squames sont noirâtres et touchent principalement le thorax. Un
prurit (démangeaisons) est fréquent. Elle a tendance à s’aggraver avec l’âge. Le
traitement est le même que pour l’ichtyose vulgaire (>).
1217. ICHTYOSE VULGAIRE.
Définition et causes.
Affection cutanée héréditaire, de transmission autosomique dominante, qui est
caractérisée par un épaississement de la couche cornée qui donne un aspect
d’écailles.
Epidémiologie.
Touche 1 personne sur 300.
Signes et symptômes.
La peau est normale à la naissance mais devient sèche et rugueuse, avec de fines
squames qui se détachent, à l’âge de 1 à 2 ans. Les zones principalement
atteintes sont le dos et la face d’extension des membres (les plis sont
respectés). Les follicules pileux sont souvent soulignés par un cône (kératose
pilaire).
Investigations.
Le diagnostic est clinique. En cas de doute, une biopsie avec un examen
histologique est utile.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est chronique sur toute la vie mais le pronostic est essentiellement
esthétique.
Traitement.
Dans les formes modérées, un simple lait hydratant est suffisant. Dans les
formes plus importantes, des produits kératolytiques locaux, vaseline
salicylée…) sont indiqués.
1218. ICTÈRE AU LAIT DE MÈRE
Définitions et causes..
Ictère néonatal survenant chez les enfants nourris au sein et dû à la présence
dans le lait de certaines mères d’une grande quantité de lipoprotéines-lipases
dont le métabolisme inhibe la conjugaison de la bilirubine. Le risque est plus
important en cas de montée laiteuse précoce.
Epidémiologie.
Il touche 1 à 3 % des enfants nourris au sein.
Signes et symptômes.
Ils se limitent à un ictère simple, modéré et isolé.
Investigations.
La bilirubine non conjuguée est < 340 pmol/L.
Evolution, complications et pronostic.
Il persiste plusieurs semaines en cas de poursuite de l’allaitement, mais
disparaît en quelques jours s’il est interrompu.
Traitement.
Le chauffage du lait maternel à 56 °C (destruction des lipoprotéines lipases)
pendant quelque temps est efficace, puis une reprise de l’allaitement est
normale.
Education.
Eduquer la mère à chauffer systématiquement lait après utilisation d’une
trayeuse.
1219. ICTÈRE NEONATAL.
Définition et causes.
Hyperbilirubinémie néonatale dont la principale forme est l’ictère simple dû à
un défaut de maturation enzymatique. Les autres causes sont la prématurité,
l’hémolyse par incompatibilité Rhésus ou ABO, une infection, un certain nombre
de maladies génétiques avec un déficit enzymatique ou une anomalie des voies
biliaires.
Epidémiologie.
L’ictère simple touche 30 à 50 % des nouveau-nés à terme normaux.
Signes et symptômes.
Apparition au deux ou troisième jour de vie d’un ictère isolé, sans autre
anomalie, d’intensité modérée. Tout ictère évoluant avant le premier jour de vie
est pathologique et risque de s’aggraver. Tout ictère associé à une décoloration
des selles complète et permanente depuis plus de 8 jours est, jusqu’à preuve du
contraire, une atrésie des voies biliaires qui constitue une urgence
chirurgicale.
Investigations.
Elles comprennent le dosage de la bilirubine totale et conjuguée, une numération
formule sanguine, un groupe sanguin et Rhésus, un test de Coombs direct et une
albuminémie.
Evolution, complications et pronostic.
L’ictère simple doit disparaître au quatrième ou cinquième jour, sinon il faut
rechercher une autre cause. La complication majeure est l’ictère nucléaire qui
correspond à la fixation de la bilirubine sur les cellules cérébrales.
Traitement.
Il utilise essentiellement la photothérapie dont le rayonnement dégrade la
bilirubine au niveau de la peau. L’exsanguino-transfusion est indiquée en cas de
taux de bilirubine dangereux.
Prévention.
La prévention implique le repérage, avant la naissance ou rapidement après, des
incompatibilités sanguines fœto-maternelles et des infections materno-fœtales.
1220. ICTUS AMNÉSIQUE. Déficit de la mémoire d’apparition brutale, de durée
limitée (en moyenne 6 heures), survenant en général chez des personnes de plus
de 50 ans. Il est caractérisé par une amnésie des faits récents et semi-récents,
une amnésie antérograde majeure avec oubli au fur et à mesure, à l’origine de
questions incessantes. Les fonctions intellectuelles sont conservées et l’examen
neurologique est normal. La récupération est progressive, avec une perte du
souvenir de ce qui s’est passé. L’épisode est généralement unique et le risque
d’accident vasculaire cérébral n’est pas augmenté.
1221. ICTUS LARYNGÉ. Perte de connaissance survenant au cours d’un accès de toux
violent et prolongé. La cause est une augmentation de la pression
intrathoracique gênant le retour veineux, ce qui entraîne une chute du débit
cardiaque et de la pression artérielle. L’ictus laryngé survient de préférence
chez des patients obèses, atteints d’une bronchopathie chronique.
1222. IDIOTIE AMAUROTIQUE FAMILIALE Groupe de maladies de la famille des
gangliosidoses (>), caractérisées par une cécité et une absence de développement
intellectuel.
1223. ILÉUS BILIAIRE.
Définition et causes.
Il s’agit d’un arrêt du transit dû au passage de calculs dans l’intestin par une
fistule avec les voies biliaires (le plus souvent cholécystoduodénale),
consécutive à l’accolement de la vésicule inflammatoire sur le tube digestif.
Epidémiologie.
Cette complication de la lithiase biliaire touche souvent les personnes âgées.
Signes et symptômes.
Le tableau est celui d’une occlusion intestinale du grêle (>), avec des
vomissements et des coliques.
Investigations.
La radiographie d’abdomen sans préparation montre des niveaux hydroaériques et
une aérobilie (présence d’air dans la vésicule et dans la voie biliaire
principale).
Evolution, complications et pronostic.
L’occlusion évolue par intermittence avec des périodes d’accalmie ou peut être
permanente.
Traitement.
Le traitement de l’occlusion intestinale associe une réanimation et la chirurgie
qui lève l’occlusion en évacuant le calcul. Elle est, si possible, complétée par
une cholécystectomie et une suppression de la fistule.
Prévention.
La cholécystectomie à froid en cas de lithiase biliaire symptomatique permet de
prévenir ce type de complication.
1224. ILÉUS PARALYTIQUE.
Définition et causes.
Arrêt temporaire du transit intestinal en réponse à une affection organique,
inflammatoire ou métabolique. La cause la plus fréquente est une péritonite. Une
ischémie mésentérique, une intervention chirurgicale abdominale, une affection
rénale ou thoracique, un trouble métabolique (hypokaliémie) ou une intoxication
peuvent également être en cause.
Signes et symptômes.
Il existe des douleurs, une distension abdominale, des vomissements et un arrêt
des matières et des gaz. A l’auscultation, l’abdomen est silencieux.
Investigations.
La radiographie d’abdomen sans préparation montre une dilatation gazeuse des
segments isolés de l’intestin grêle et du côlon.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est, en général, rapidement favorable sous traitement et élimination
de la cause déclenchante.
Traitement.
Il associe un traitement médical (antalgiques, antispasmodiques, rééquilibration
hydroŽlectrolytique et aspiration digestive) et la correction de la cause.
Certains patients peuvent être soulagés par une décompression côlonoscopique.
1225. IMERSLUND-GRASBECK (MALADIE DE). Maladie héréditaire, de transmission
autosomique récessive, caractérisée par une mauvaise absorption de la vitamine
B12 au niveau de l’iléon. Elle se manifeste cliniquement par une anémie
mégaloblastique (cellule précurseur du globule rouge de grande taille), qui
débute vers l’âge de 2 ans. L’injection intramusculaire de vitamine B12 corrige
l’anémie. La guérison est spontanée entre 20 et 30 ans.
1226. IMMUNISATION SANGUINE FOETO¬
MATERNELLE ou MALADIE HÉMOLYTIQUE
NÉONATALE.
Définition et causes.
Il s’agit d’une incompatibilité entre le sang maternel et le sang fœtal due au
passage d’anticorps maternels à travers le placenta, qui détruisent les globules
rouges du fœtus. La forme la plus fréquente est liée au passage d’une petite
quantité de sang, lors de l’accouchement, d’un fœtus Rhésus D positif vers la
mère Rhésus D négatif, ce qui entraîne la formation par la mère d’anticorps
anti-D qui poseront problème lors de la grossesse suivante. Des incompatibilités
pour d’autres facteurs sont possibles et sont liées à des transfusions
antérieures chez la mère.
Epidémiologie.
Rare. La généralisation de la prévention depuis plus de vingt ans ainsi que la
diminution du nombre de transfusions a fait baisser le nombre de cas.
Signes et symptômes.
L’atteinte fœtale grave se traduit, dans les formes sévères, par une abondance
anormale du liquide amniotique (hydramnios), une ascite, un gros foie et un
épanchement péricardiquechez le fœtus. À la naissance, la destruction des
globules rouges (hémolyse) se traduit par un ictère.
Investigations.
La présence d’agglutinines irrégulières et leur identification chez la femme
enceinte affirment le diagnostic. La surveillance de la grossesse utilise
l’échographie, le dosage de la bilirubine dans le liquide amniotique prélevé par
amniocentèse (indice de Liley) et l’étude du sang fœtal prélevé par ponction du
cordon.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement a amélioré le pronostic, avec une survie de la quasi-totalité des
enfants et une évolution à long terme strictement normale. Mais des formes
graves aboutissent à des décès in utero répétés. L’ictère néonatal (>) peut
avoir une évolution défavorable.
Traitement.
Pendant la grossesse, une transfusion in utero peut être indiquée. A la
naissance, le traitement de l’ictère utilise principalement la photothérapie
(transformation de la bilirubine non conjuguée au niveau de la peau en composés
non toxiques) et, dans certains cas graves, l’exsanguino-transfusion
(remplacement de tout le sang du fœtus).
Prévention et éducation.
La législation prévoit une surveillance particulière de toutes les femmes
enceintes, notamment les femmes Rhésus négatif. L’injection systématique de
gammaglobulines anti-D est indispensable chez toutes les femmes Rhésus négatif
après l’accouchement d’un enfant Rhésus positif, une interruption de grossesse
et, en cours de grossesse, lors de tout événement pouvant entraîner un passage
de sang de la mère vers le fœtus (traumatisme abdominal, amniocentèse,
métrorragies, cerclage…).
1227. IMPATIENCE DES MEMBRES INFÉRIEURS ou (>) JAMBES SANS REPOS (SYNDROME DES).
1228. IMPÉTIGO.
Définition et causes.
Infection de l’épiderme et du derme due à un streptocoque A β-hémolytique ou à
un staphylocoque doré qui est contagieuse et dont la transmission se fait par
contact direct ou auto-inoculation par grattage.
Epidémiologie.
C’est la plus fréquente des infections cutanées de l’enfant, qui est favorisée
par une hygiène défectueuse.
Signes et symptômes.
La lésion élémentaire est une vésicobulle flasque sur une peau inflammatoire qui
va se rompre et laisser place à une croûte jaunâtre. Plusieurs éléments d’âges
différents coexistent, apparaissant de proche en proche. L’impétigo croûteux est
péri-orificiel (autour de la bouche et du nez) chez l’enfant de moins de 10 ans.
L’impétigo bulleux existe chez le nouveau-né et le nourrisson.
L’impétiginisation est la surinfection d’une dermatose sous-jacente
prurigineuse, en général chez l’adulte.
Evolution, complications et pronostic.
Les lésions régressent en quelques jours sous traitement, sans laisser de
cicatrice. Les complications sont locales (abcès, pyodermite, lymphangite…) ou
générales (septicémie). Une glomérulonéphrite due au streptocoque devra
systématiquement recherchée (protéinurie à la bandelette).
Traitement.
Il consiste en une antibiothérapie par voie générale avec la pristinamycine (ou
pénicilline M ou macrolide), associée à un traitement local avec un antiseptique
et une pommade antibiotique.
Prévention et éducation.
Les mesures d’hygiène comprennent l’éviction scolaire pendant quelques jours, le
coupage des ongles, des douches pluriquotidiennes et des vêtements amples.
1229. INCLUSIONS CYTOMÉGALIQUES (MALADIES DES)ou INFECTION CONGÉNITALE À
CYTOMÉGALOVIRUS.
Définition et causes.
Malformation fœtale due à une infection à cytomégalovirus (>) de la mère pendant
la grossesse. Le risque pour l’enfant est maximum en début de grossesse. Près de
60 % des femmes sont séronégatives en début de grossesse (mais variation en
fonction des condition socio-économiques, taux plus faible dans les milieux
défavorisés), donc risquent de contracter l’infection.
Epidémiologie.
C’est la plus fréquente des infections transmissibles in utero (1500 enfants/an
en France), mais seul un enfant sur deux infectés présentera des manifestations
pathologiques, soit à la naissance, soit dans les premiers mois de vie.
Signes et symptômes.
L’infection chez la mère est le plus souvent asymptomatique ou peut se traduire
par un syndrome grippal ressemblant à une mononucléose (>). L’atteinte in utero
est suspectée sur un retard de croissance, une microcéphalie avec ou sans
calcifications intracrâniennes. Dans 9 cas sur 10, l’enfant est asymptomatique à
la naissance mais risque de développer une surdité à moyen terme. Dans les
formes néonatales symptomatiques, les signes sont une hépatosplénomégalie, une
anémie, un purpura thrombopénique, une pneumopathie interstitielle .
Investigations.
L’infection chez la mère peut être mise en évidence par l’élévation du taux
d’anticorps à la sérologie. Le diagnostic fœtal utilise la recherche du virus
sur le liquide amniotique et d’anticorps dans le sang fœtal prélevé sur le
cordon.
Evolution, complications et pronostic.
La mortalité atteint 20 % des enfants ayant une atteinte sévère à la naissance.
Chez les survivants, les séquelles sont constantes : retard psychomoteur,
surdité, atteinte oculaire.
Traitement.
Le dépistage systématique par sérologie maternelle n’est pas la règle. En
présence de signes échographiques et biologiques d’infection grave, une
interruption thérapeutique de grossesse sera proposée
1230. INCONTINENCE ANALE.
Définition et causes.
Perte du contrôle volontaire de l’évacuation des selles. Les principales causes
sont des maladies digestives (Crohn, rectocolite hémorragique), une atteinte du
sphincter (séquelles d’accouchement ou de chirurgie) et des troubles
neurologiques (lésions de la moelle, atteinte des fonctions supérieures).
Epidémiologie.
Ces troubles sont fréquents mais insuffisamment exposés par les patients qui en
souffrent et pris en compte par les médecins qui les soignent.
Signes et symptômes.
Il faut préciser si l’incontinence est totale ou limitée aux selles liquides et
aux gaz. L’examen apprécie la tonicité du sphincter.
Investigations.
Le bilan comporte un examen manométrique et un électromyogramme du sphincter
anal.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement peut apporter des résultats satisfaisants mais, parfois, il faut
se résoudre à une dérivation chirurgicale (colostomie).
Traitement.
Il consiste à établir un programme de rééducation et de régularisation de la
défécation (apports suffisants de résidus et de liquides, gymnastique périnéale,
biofeedback…). Le traitement chirurgical est difficile et s’adresse surtout
aux incontinences d’origine traumatique.
Prévention et éducation.
Le respect du sphincter lors de certains gestes médicaux et chirurgicaux, ainsi
que la prise en compte des risques au cours de l’accouchement, sont essentiels
en terme de prévention.
1231. INCONTINENCE URINAIRE
Définition et causes.
Perte involontaire d’urine. Elle est due, chez la femme, à une faiblesse des
muscles du plancher pelvien et survient surtout à l’effort (des fistules
urogénitale sont également possibles). Chez l’homme, il s’agit le plus souvent
d’affections prostatiques ou neurologiques.
Epidémiologie.
On estime à 10 % le nombre de femmes jeunes affectées. La prévalence augmente
avec l’âge pour devenir une des principales infirmités des personnes âgées des
deux sexes.
Signes et symptômes.
La fuite d’urine peut être constante en cas de fistule urogénitale, liée à un
effort ou à la toux ou s’effectuer par regorgement (vessie distendue du fait
d’un obstacle, prostatique le plus souvent, avec écoulement d’urine lorsque la
pression devient supérieure à la résistance du sphincter). Il existe souvent une
dysurie (difficulté pour uriner) et une pollakiurie (mictions très fréquentes).
Investigations.
Le diagnostic est essentiellement clinique. Un bilan urodynamique et des examens
radiologiques avec produit de contraste (urographie, urétrocystographie) sont
utiles dans certains cas.
ÉVOLUTION, COMPLICATIONS ET PRONOSTIC.
Les principales complications sont le retentissement sur la vie sociale et les
infections urinaires. Dans les deux tiers des cas, les patients peuvent être
guéris ou améliorés par le traitement.
Traitement.
Selon les cas, le traitement comprend la chirurgie et/ou la rééducation
périnéale.
Prévention et éducation.
Inciter les patients à parler de leurs troubles est essentiel car une prise en
charge précoce améliore les résultats du traitement. L’éducation (rééducation
périnéale) joue un rôle essentiel.
1232. INCONTINENTIA PIGMENTI . Affection cutanée, le plus souvent congénitale et
familiale, touchant les filles. Elle est caractérisée par des taches brunes, en
plaques ou en bandes (« en éclaboussures ») réparties sur le tronc. Ces
anomalies apparaissent souvent après une phase d’éruption faite de bulles et de
plaques rouges. Elle est fréquemment associée à des troubles neurologiques
(retard mental, convulsions) et à un retard de croissance.
1233. INFARCTUS MÉSENTÉRIQUE.
Définition et causes.
Défaut aigu de vascularisation (ischémie) d’un segment de l’intestin grêle. Les
lésions athéromateuses représentent la cause la plus fréquente. Les autres
mécanismes sont des embolies d’origine cardiaque, une chute du débit sanguin
(état de choc, médicaments vasoconstricteurs…) ou une occlusion veineuse
(compression de voisinage, polyglobulie…).
Epidémiologie.
C’est une affection relativement fréquente chez le sujet âgé.
Signes et symptômes.
Le tableau clinique comprend une douleur abdominale brutale, intense associée à
une hypotension et une tachycardie. L’abdomen est complètement silencieux à
l’auscultation. Puis apparaissent des signes d’occlusion: arrêt du transit,
vomissements…
Investigations.
Les différents examens utilisés sont le scanner, l’écho-doppler et,
éventuellement, l’angiographie.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait rapidement vers la péritonite. La mortalité est élevée car
le diagnostic est souvent tardif et l’affection survient souvent chez des
personnes âgées fragiles.
Traitement.
Le traitement est chirurgical : résection de la zone intestinale infarcie.
1234. INFARCTUS DU MYOCARDE.
Définition et causes.
Nécrose ischémique du muscle cardiaque, d’étendue et de topographie variables, due à une occlusion d’une artère coronaire par un thrombus (plus rarement, il peut s’agir d’un spasme, en général sur une artère athéromateuse (>) Athérosclérose)). Les antécédents et les facteurs de risque sont des éléments d’orientation essentiels : angine de poitrine, infarctus, pontage coronaire, tabagisme, hyperlipidémie, hypertension, diabète et obésité, sédentarité et stress, familiaux (infarctus et mort subite chez les parents).
Epidémiologie.
La France est un pays de faible incidence de la maladie coronarienne avec un
taux d’infarctus (110000/an) et de décès coronaires aux alentours de 230 pour
100 000 hommes âgés de 35 à 64 ans. En raison de la protection hormonale,
l’infarctus est beaucoup plus rare chez la femme avant 70 ans.
Signes et symptômes.
Les signes typiques comprennent une douleur thoracique rétrosternale,
constrictive (« qui serre »), irradiant dans le bras gauche. Elle est en général
angoissante et est apparue à l’effort. La douleur peut avoir des formes
trompeuses : épigastrique, irradiant dans le dos, accompagnée de vomissements,
pâleur, sueurs, éructations…
Investigations.
L’ECG montre des modifications du segment ST (sus-décalage). La biologie
objective l’élévation des enzymes cardiaques (CPK-MB) et des marqueurs plus
récents comme la troponine et la myoglobine.
Evolution, complications et pronostic.
La précocité du diagnostic est essentielle car elle conditionne la mise en œuvre
du traitement thrombolytiques qui doit être débuté dans les 6 premières heures
après le début de la douleur. La principale complication est la mort subite due
à un trouble du rythme ventriculaire (fibrillation ventriculaire). Une
insuffisance cardiaque gauche (œdème aigu du poumon), pouvant déboucher sur un
choc cardiogénique, peut également survenir.
Traitement.
Deux choix sont possibles à la phase aiguë (les 6 premières heures) :
thrombolyse (désobstruction médicamenteuse de la coronaire par dissolution du
thrombus par streptokinase, rt-PA, ténectéplase ou rétéplase) ou angioplastie
(désobstruction mécanique de la coronaire par montée d’un cathéter et dilatation
de la zone obstruée par le gonflage d’un ballonnet). Après la phase aiguë, un
traitement médicamenteux visant à prévenir les récidives sera institué, complété
selon les cas par une angioplastie ou un pontage coronaire.
Prévention et éducation.
La prévention secondaire des facteurs de risque est essentielle. L’éducation en
postinfarctus consiste en une adaptation de l’activité physique, une diminution
des facteurs de stress, une alimentation pauvre en graisses animales, l’arrêt
absolu du tabac, une reconnaissance des signes d’alerte pour éviter une
récidive.
1235. INFARCTUS RÉNAL.
Définition et causes.
Destruction plus ou moins étendue du tissu rénal due à une occlusion de l’artère
rénale ou d’une de ses branches, ou à une thrombose d’une veine rénale. Les
causes de l’occlusion artérielle sont soit une embolie (thrombus en provenance
du cœur en cas de fibrillation auriculaire), soit une thrombose (compliquant une
sténose athéromateuse). La thrombose de la veine rénale survient en cas de
déshydratation aiguë chez le nourrisson et, chez l’adulte, dans le cadre d’une
amylose ou d’une glomérulonéphrite extramembraneuse.
Epidémiologie.
Rare.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont une hypertension artérielle, des douleurs lombaires,
une hématurie.
Investigations.
Les examens utiles sont l’échographie, l’urographie intraveineuse et
l’angiographie.
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est la crise hypertensive qui peut entraîner le décès
du patient.
Traitement.
Le traitement initial a pour but de contrôler la pression artérielle. En cas
d’échec, une néphrectomie partielle ou totale peut s’imposer. Chez le
nourrisson, un traitement thrombolytiques est possible.
1236. INFECTION GÉNITALE À CHLAMYDIA.
Définition et causes.
Infection sexuellement transmissible (IST) due à Chlamydia trachomatis. Elle est
fréquemment associée à d’autres MST. Le principal facteur de risque est la
multiplicité des partenaires.
Epidémiologie.
C’est la plus fréquente des IST, avec une incidence entre 2 000 et 4 000 cas
pour 100 000 habitants par an. Elle touche principalement les jeunes de moins de
25 ans.
Signes et symptômes.
Dans la moitié des cas, l’infection est asymptomatique. Les signes les plus
fréquents sont des brûlures mictionnelles, des pertes non sanglantes
(leucorrhées), des douleurs pendant les rapports (dyspareunie) et des douleurs
pelviennes.
Investigations.
La recherche du germe se fait sur un prélèvement endocervical et urétral chez la
femme et sur un premier jet d’urine chez l’homme avec une analyse par la
technique de PCR (polymérase chain reaction).
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication chez la femme est la salpingite, qui évolue souvent
sur un mode chronique et qui est responsable de la moitié des stérilités
actuellement en France. Une transmission néonatale est possible au cours de
l’accouchement. Chez l’homme, le Chlamydia est responsable de 50 % des
orchiépididymites, qui peuvent entraîner une stérilité.
Traitement.
L’antibiothérapie utilise le traitement ‘minute’ avec l’azithromycine ou les
tétracyclines pendant 10 jours. Le traitement simultané du partenaire est
indispensable
Prévention et éducation.
Le principal moyen de prévention est le préservatif et un dépistage systématique
dans l’année qui suit un changement de partenaire.
1237. INFECTION URINAIRE.
Définition et causes
Présence de plus de 100000 germes par millilitre d’urine vésicale (les
souillures sont fréquentes car le prélèvement se fait par miction spontanée). La
principale cause est la contamination par voie ascendante avec des germes
intestinaux. Chez la femme, la brièveté de l’urètre est le principal facteur en
cause. En revanche, chez l’enfant et chez l’adulte, l’infection est le plus
souvent secondaire à une anomalie de l’appareil urinaire (malformation,
infection de la prostate). On distingue la cystite (4) chez la femme, la
prostatite (4) chez l’homme et la pyélonéphrite (>).
Epidémiologie.
Les infections urinaires représentent des millions de consultations annuelles.
Elles prédominent largement chez la femme.
Signes et symptômes.
Les signes communs aux différentes formes sont une fièvre > 38 °C, des douleurs
(vessie, prostate ou rein) et une altération de l’état général. Les symptômes
urinaires (brûlures, mictions fréquentes…) ne sont pas toujours présents.
Investigations.
L’identification du germe se fait sur l’examen cytobactériologique des urines
(ECBU) et sur les hémocultures dans les formes graves. Le bilan biologique
indique des signes d’inflammation (vitesse de sédimentation et protéine C
réactive élevées). L’échographie, le scanner et la scintigraphie sont utilisés
pour confirmer l’atteinte du tissu rénal et/ou prostatique. L’urographie
intraveineuse permet de détecter des malformations.
Evolution, complications et pronostic.
Les deux grands risques sont la généralisation de l’infection (septicémie) et le
retentissement sur la fonction rénale (destruction du rein).
Traitement.
Les schémas d’antibiothérapie sont variables en fonction de l’atteinte:
traitement court ou en dose unique dans la cystite, antibiothérapie double par
voie veineuse en cas de pyélonéphrite ou de prostatite. La cause éventuelle chez
l’enfant ou chez l’adulte sera également traitée.
1238. INSENSIBILITÉ AUX ANDROGÈNES (SYNDROME D’) .
Syndrome héréditaire, de transmission récessive liée à l’X, dû à un
dysfonctionnement du récepteur des androgènes entraînant un déficit d’action des
androgènes au niveau des tissus cibles. Ce syndrome constitue l’étiologie la
plus fréquente du pseudohermaphrodisme masculin (>). Les individus atteints ont
un caryotype 46 XY, des testicules normalement différenciés et développés, et un
phénotype féminin ou seulement partiellement masculinisé.
1239. INSOMNIE. Définition et causes. Perturbation du déclenchement ou du
maintien du sommeil. On distingue l’insomnie transitoire, dont la cause est
facile à identifier (environnement, stress, décalage horaire, séjour en
altitude…), l’insomnie chronique primaire sans cause retrouvée et l’insomnie
secondaire (maladie psychiatrique, médicaments ou substances excitantes,
douleurs chroniques, insuffisance cardiaque ou respiratoire…).
Epidémiologie.
On estime que 50 % de la population a souffert au moins une fois dans sa vie de
troubles du sommeil.
Signes et symptômes.
Dans la forme primaire, l’insomnie est souvent le seul signe. Il existe soit des
difficultés d’endormissement, soit un ou plusieurs réveils nocturnes après un
endormissement normal. La journée, le patient présente une inquiétude permanente
concernant son sommeil. Un cercle vicieux se crée : plus la nuit précédente a
été mauvaise, plus l’inquiétude vis-à-vis de la nuit suivante augmente.
Paradoxalement, le patient s’endort plus facilement dans son fauteuil en lisant
ou en regardant la télévision.
Investigations.
Le seul examen éventuellement utile dans les formes chroniques est
l’enregistrement polygraphique du sommeil.
Evolution, complications et pronostic.
La gravité de l’insomnie tient essentiellement aux conséquences physiques et
psychologiques ressenties dans la journée: difficulté au réveil, troubles de la
concentration et de l’humeur, atteinte des capacités physiques et
intellectuelles, somnolence.
Traitement.
Dans les formes transitoires et secondaires, le traitement est celui de la
cause. Dans les autres cas, les moyens utilisés sont la prise en charge
psychologique et éducative (contact social, activité physique en première partie
de journée, restriction du sommeil, relaxation…) et les médicaments
(benzodiazépines, essentiellement).
Prévention et éducation.
Dans les formes transitoires et secondaires, une bonne connaissance par le
patient des facteurs déclenchants permet de mettre en œuvre des mesures
préventives, notamment médicamenteuses, pour éviter l’apparition de l’insomnie.
1240. INSOMNIE FATALE FAMILIALE. Forme rare d’encéphalopathie spongiforme
subaiguë transmissible (>) liée à un prion, décrite pour la première fois en
1986. C’est une affection autosomique dominante due à la mutation d’un gène
codant la protéine prion. En 1998, 70 cas étaient répertoriés dans le monde avec
un âge moyen de début vers 50 ans. Elle est caractérisée par une insomnie
rebelle et divers troubles neurologiques qui évoluent vers le décès dans un
délai moyen d’un an.
1241. INSUFFISANCE ANTÉHYPOPHYSAIRE ou HYPOPITUITARISME.
Définition et causes.
Tableau clinique dû au déficit d’une ou plusieurs hormones produites par
l’hypophyse (GH, ACTH, prolactine, FSH, LH, TSH). Les causes sont variées:
tumeurs, radiothérapie ou chirurgie, nécrose ischémique (syndrome de Sheehan >),
inflammations (sarcoïdose, post¬partum…), malformations congénitales.
Epidémiologie.
Peu fréquent.
Signes et symptômes.
Chez l’enfant, il existe un nanisme et un impubérisme (absence de puberté). Chez
l’adulte, le tableau complet associe à des degrés variables: des troubles
sexuels (impuissance chez l’homme, disparition des règles chez la femme), une
atteinte cutanée (peau fine et sèche, disparition des poils), une hypothyroïdie
(>), une insuffisance surrénalienne (asthénie, troubles digestifs,
hypoglycémie…)
Investigations.
Elles comprennent un bilan hormonal complexe et des examens pour rechercher la
cause, principalement un scanner et une IRM de la région hypophysaire.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution dépend de la cause. La principale complication est la survenue d’un
coma dû à une aggravation du déficit hormonal, notamment thyroïdien et
surrénalien, déclenchée par le stress, une infection…
Traitement.
Le traitement de la cause est prioritaire. Le traitement symptomatique est fondé
sur la substitution hormonale.
Prévention et éducation.
L’éducation du patient est primordiale pour qu’il puisse adapter son traitement
en cas de stress, d’infection…
1242. INSUFFISANCE AORTIQUE.
Définitions et causes.
Défaillance de la valvule aortique caractérisée par un reflux anormal de sang de
l’aorte dans le ventricule gauche pendant la diastole. Dans près d’un cas sur
deux, la cause est une dégénérescence liée à l’âge. Les autres causes
comprennent l’endocardite infectieuse, le rhumatisme articulaire aigu, la
dissection aortique, un traumatisme thoracique ou une anomalie congénitale.
Epidémiologie.
Elle représente un peu plus de 10 % des valvulopathies opérées en France. La
forme dégénérative est en augmentation du fait du vieillissement de la
population.
Signes et symptômes.
La forme aiguë, en cas d’endocardite ou de dissection, est mal supportée avec
une insuffisance cardiaque gauche d’emblée. La forme chronique est longtemps
bien tolérée avec une dilatation progressive du ventricule gauche, un souffle
diastolique maximum le long du bord gauche du sternum, un élargissement de la
différentielle tensionnelle (baisse de la diastolique) et une hyperpulsatilité
artérielle avec pouls amples, bondissants.
Investigations.
La radiographie thoracique montre une dilatation ventriculaire gauche. L’ECG
présente des signes d’hypertrophie ventriculaire gauche. L’échographie-doppler
permet la quantification de la fuite.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution dépend de l’importance de la fuite et de la rapidité de sa
constitution. Les deux principales complications sont l’infection (endocardite)
et l’insuffisance ventriculaire gauche.
Traitement.
Lorsque la fuite est peu importante et bien tolérée, le traitement médical
suffit (diurétiques, digitaliques, vasodilatateurs). En cas de fuite importante,
le remplacement valvulaire s’impose.
Prévention.
Les mesures de prophylaxie systématique de l’endocardite sont indispensables.
1243. INSUFFISANCE CARDIAQUE GLOBALE.
Définition et causes.
Incapacité du cœur à adapter son débit aux besoins de l’organisme. Les
principales causes sont les atteintes ischémiques (infarctus), l’hypertension artérielle, les valvulopathies, les atteintes pulmonaires (bronchite chronique…) et certaines maladies endocriniennes (diabète…).
Epidémiologie.
C’est une des pathologies les plus fréquentes dans les pays développés. Elle
touche 500 000 patients en France avec 120 000 nouveaux cas par an. Deux tiers
des patients ont plus de 70 ans. Elle est à l’origine de 120 000
hospitalisations par an, de 32000 décès et représente 1 % des dépenses médicales
totales.
Signes et symptômes.
Association d’une dyspnée d’effort croissante, d’une distension de veines
jugulaires, d’une hépatomégalie avec un reflux hépatojugulaire et d’œdèmes des
membres inférieurs. L’auscultation pulmonaire retrouve des crépitants aux bases.
La classification de la New York Heart Association (NHYA) côte la sévérité de
l’insuffisance cardiaque:
• Stade I : dyspnée pour des efforts importants inhabituels, aucune gêne dans la
vie courante ; stade II : dyspnée à la marche rapide ou à la montée des
escaliers (plus de deux étages) ;
• Stade III: dyspnée à la marche normale ou pour des efforts minimes;
• Stade IV: dyspnée permanente de repos.
Investigations.
L’échographie cardiaque est l’examen clef qui permet d’évaluer l’état du cœur.
La radiographie pulmonaire, l’électrocardiogramme, les examens isotopiques et
hémodynamiques sont également utiles.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est émaillée de poussées aiguës ( > Œdème aigu du poumon) favorisées
par un écart du régime sans sel, une poussée hypertensive, l’arrêt des
médicaments, les troubles du rythme auriculaire, une embolie pulmonaire… La
mortalité est élevée due soit à une décompensation résistante au traitement,
soit à une mort subite le plus souvent par trouble du rythme.
Traitement.
Il repose sur les règles hygiéno-diététiques (régime sans sel, perte de poids)
et un traitement médicamenteux (dérivés nitrés, diurétiques, inhibiteurs de
l’enzyme de conversion, digitaliques). La transplantation cardiaque peut être
indiquée en cas d’insuffisance cardiaque très évoluée chez un sujet jeune.
Prévention et éducation.
La prévention est celle des pathologies cardio-vasculaires ischémiques et
hypertensives. L’éducation concerne le respect des règles hygiéno-diététiques
pour éviter les décompensations aiguës, la prise de poids quotidienne (œdèmes),
l’auto-évaluation du degré de dyspnée.
1244. INSUFFISANCE MÉDULLAIRE. Terme regroupant un ensemble d’affections
caractérisées par l’insuffisance de production des globules rouges, des globules
blancs et/ou des plaquettes par la moelle osseuse. Il s’agit des aplasies
médullaires (>), des érythroblastopénies (>), des syndromes myélodysplasiques
(>) et de l’envahissement médullaire (leucémies, métastases cancéreuses,
myélome…).
1245. INSUFFISANCE MITRALE.
Définition et causes.
Dysfonctionnement de la valvule mitrale entraînant un reflux de sang du
ventricule gauche vers l’oreillette gauche lors de la contraction cardiaque
(systole). Les principales causes sont une dégénérescence liée à l’âge, une
endocardite, un infarctus du myocarde, une maladie rhumatismale, une
cardiomyopathie dilatée ou obstructive. Des formes congénitales sont possibles,
souvent associées à d’autres malformations.
Epidémiologie.
Affection relativement fréquente.
Signes et symptômes.
Les signes les plus fréquents sont la fatigue et la dyspnée d’effort. Dans la
forme aiguë, le tableau est celui d’une insuffisance ventriculaire gauche avec
un œdème aigu du poumon (>). L’auscultation retrouve un souffle systolique,
maximum à l’apex et irradiant dans l’aisselle.
Investigations.
L’echodoppler cardiaque permet de quantifier la fuite et d’en analyser le
mécanisme.
Evolution, complications et pronostic.
Dans la forme aiguë, le pronostic vital peut être engagé en l’absence d’un
traitement rapide. Dans la forme chronique, la bonne tolérance peut être
prolongée puis apparaissent des signes d’insuffisance ventriculaire gauche, avec
parfois une arythmie par fibrillation auriculaire.
Traitement.
En cas de forme aiguë ou chronique mal tolérée, une indication chirurgicale à
court terme est posée. Dans la forme chronique bien tolérée, une surveillance
clinique et échographique régulière suffisent.
Prévention.
La diffusion du traitement antibiotique des infections ORL a fortement diminué
le nombre de cas d’atteinte valvulaire d’origine rhumatismale. En cas
d’insuffisance mitrale connue, une prophylaxie antibiotique contre l’endocardite
(>) est nécessaire lors de tout geste à risque
1246. INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË (IRA) .
Définition et causes.
Dégradation totale et brutale de la fonction rénale qui se traduit par l’absence
(ou la très faible quantité) d’urine dans la vessie. Dans certains cas, la
diurèse est conservée, mais le débit de filtration glomérulaire s’est abaissé
brutalement. Les trois principales formes sont: l’IRA fonctionnelle due à un
défaut de perfusion du rein (collapsus, par exemple), l’IRA par lésion rénale et
l’IRA par obstacle (lithiase, par exemple).
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente en postopératoire et en réanimation (état de choc,
infection sévère, hémolyse aiguë, brûlures étendues…).
Signes et symptômes.
Il existe une anurie (< 100 ml/j) ou une oligurie (< 400 ml/j) associée à des
signes de rétention hydrosodée (vomissements, asthénie, dyspnée, œdème aigu du
poumon, troubles de la conscience, troubles du rythme cardiaque).
Investigations.
On retrouve une créatinine et une urée sanguine élevées, une hyperkaliémie, une
acidose et une hyponatrémie. La radiographie d’abdomen sans préparation et
l’échographie explorent la morphologie ainsi que la taille des reins, et
recherchent la présence d’un obstacle sur la voie urinaire.
Evolution, complications et pronostic.
Le principal risque est un arrêt cardiocirculatoire par défaillance ou troubles
du rythme cardiaque. L’évolution est en général favorable en quelques jours ou
semaines mais le risque de lésions définitives est réel, avec passage à une
insuffisance rénale chronique.
Traitement.
Il associe réanimation hydroélectrolytique (diminution de la kaliémie et
correction de l’acidose) et hémofiltration en attendant la récupération
éventuelle de la fonction rénale. L’obstacle éventuel doit être levé.
Prévention et éducation.
Un certain nombre de toxiques ainsi que des médicaments (antibiotiques,
anticancéreux, produits de contraste, anti-inflammatoires…) peuvent entraîner
une IRA.
1247. INSUFFISANCE RÉNALE AIGUË (IRA).
Définition et causes.
Dégradation totale et brutale de la fonction rénale qui se traduit par l’absence
(ou la très faible quantité) d’urine dans la vessie. Dans certains cas, la
diurèse est conservée, mais le débit de filtration glomérulaire s’est abaissé
brutalement. Les trois principales formes sont: l’IRA fonctionnelle due à un
défaut de perfusion du rein (collapsus, par exemple), l’IRA par lésion rénale et
l’IRA par obstacle (lithiase, par exemple).
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente en postopératoire et en réanimation (état de choc,
infection sévère, hémolyse aiguë, brûlures étendues…).
Signes et symptômes.
Il existe une anurie (< 100 ml/j) ou une oligurie (< 400 ml/j) associée à des
signes de rétention hydrosodée (vomissements, asthénie, dyspnée, œdème aigu du
poumon, troubles de la conscience, troubles du rythme cardiaque).
Investigations.
On retrouve une créatinine et une urée sanguine élevées, une hyperkaliémie, une
acidose et une hyponatrémie. La radiographie d’abdomen sans préparation et
l’échographie explorent la morphologie ainsi que la taille des reins, et
recherchent la présence d’un obstacle sur la voie urinaire.
Evolution, complications et pronostic.
Le principal risque est un arrêt cardiocirculatoire par défaillance ou troubles
du rythme cardiaque. L’évolution est en général favorable en quelques jours ou
semaines mais le risque de lésions définitives est réel, avec passage à une
insuffisance rénale chronique.
Traitement.
Il associe réanimation hydroélectrolytique (diminution de la kaliémie et
correction de l’acidose) et hémofiltration en attendant la récupération
éventuelle de la fonction rénale. L’obstacle éventuel doit être levé.
Prévention et éducation.
Un certain nombre de toxiques ainsi que des médicaments (antibiotiques,
anticancéreux, produits de contraste, anti-inflammatoires…) peuvent entraîner
une IRA.
1248. INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE (IRC).
Définition et causes.
Aboutissement de toutes les néphropathies chroniques, et parfois aiguës, dû à
une destruction des néphrons entraînant une diminution progressive des capacités
de filtration du rein qui ne joue plus sa fonction d’épuration sanguine et
endocrinienne (vitamine D et érythropoïétine).
Epidémiologie.
Les patients en insuffisance rénale terminale sont estimés à 80 nouveaux
cas/million d’habitants par an.
Signes et symptômes.
Il existe une hypertension artérielle, des signes d’anémie, des troubles de
minéralisation osseuse (> Ostéomalacie), des signes neuromusculaires (crampes,
paresthésies) et des troubles digestifs (nausées et anorexie).
Investigations.
Les signes biologiques permettent le diagnostic (urée et créatinine élevées,
acidose métabolique, hypocalcémie par déficit en vitamine D). Le calcul de la
clairance de la créatinine quantifie le degré de l’atteinte (< 10 mL/min :
insuffisance rénale terminale).
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait à une vitesse variable vers le stade terminal qui nécessite
la dialyse ou une transplantation.
Traitement.
Le traitement médical repose sur un maintien de l’équilibre
hydro-électrolytique, de la pression artérielle, ainsi que sur l’apport de
calcium, de vitamine D et d’érythropoïétine de synthèse. Au stade terminal, on
aura recours à la dialyse péritonéale, l’hémodialyse ou la transplantation.
Prévention et éducation.
Une survie de longue durée de qualité est possible avec les traitements de
suppléance. L’autonomie repose sur une éducation permettant la dialyse à
domicile ou dans des unités d’auto-dialyse. La posologie des médicaments à
élimination rénale sera adaptée.
1249. INSUFFISANCE RÉNALE FONCTIONNELLE.
Définition et causes.
Forme d’insuffisance rénale aiguë due à une baisse de la perfusion du tissu
rénal sans atteinte organique du rein. Les principales causes sont une
hypotension artérielle (hémorragie, état de choc), des troubles
hydroélectrolytiques (déshydratation par pertes cutanées, digestives ou rénales,
occlusion intestinale, syndrome néphrotique…), une insuffisance cardiaque et
certains médicaments (inhibiteurs de l’enzyme de conversion, anti-inflammatoires
non stéroïdiens).
Epidémiologie.
C’est un problème fréquent, notamment chez les malades hospitalisés en
réanimation.
Signes et symptômes.
Le seul signe rénal est une oligurie (diminution du volume des urines). Les
autres symptômes sont en rapport avec la cause.
Investigations.
Différents indices biologiques sont en faveur d’une insuffisance rénale
fonctionnelle: Na urinaire < 20 mmol/L, urée urinaire/ urée sanguine > 8,
créatinine urinaire/créatinine sanguine > 40 et Na urinaire/K urinaire < 1.
Evolution, complications et pronostic.
Lorsque le traitement est suffisamment rapide, la régression est totale et
rapide. Dans le cas contraire, l’évolution se fait vers une néphropathie
tubulo-interstitielle aiguë (>) dont le pronostic est moins bon.
Traitement.
Il consiste à assurer une bonne perfusion rénale en corrigeant les troubles
hémodynamiques et hydroélectrolytiques.
Prévention
La détection et le traitement précoce des différentes causes sont les seuls
moyens de prévention efficace
1250. INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE.
Définition Et Causes.
Ensemble des affections à l’origine d’une perturbation chronique des gaz du
sang. On distingue:
• la forme obstructive dont les principales causes sont la bronchite chronique,
l’emphysème, l’asthme à dyspnée continue et la dilatation des bronches;
• la forme restrictive due à une déformation du thorax (scoliose, obésité…),
une atteinte pleurale (séquelles de pleurésie…), une atteinte du tissu
pulmonaire (séquelles de chirurgie ou de tuberculose, fibrose…).
•
Epidémiologie.
La forme obstructive est la plus fréquente. Elle est responsable de 20 000 décès
par an en France.
Signes et Symptômes.
Les signes communs à toutes les formes sont une dyspnée et une cyanose
d’importance variable. Au cours de l’évolution apparaissent des signes
d’insuffisance cardiaque droite: œdème des membres inférieurs, gros foie,
distension des jugulaires.
Investigations.
Les gaz du sang montrent une hypoxie (PaO2 < 60 mmHg) avec ou sans hypercapnie
(PaCO2 > 49 mmHg). Les anomalies à la radiographie thoracique dépendent de la
cause. Le diagnostic est affirmé par les épreuves fonctionnelles respiratoires :
dans le syndrome obstructif le rapport volume expiratoire maximum
seconde/capacité vitale (VEMS/CV) est inférieur à 75 %; dans le syndrome
restrictif, la capacité pulmonaire totale (CPT) est inférieure de plus de 20 %
aux valeurs théoriques.
Evolution, Complications Et Pronostic.
L’évolution se fait le plus souvent vers une aggravation progressive avec une
limitation de l’autonomie et une dépendance à l’oxygénothérapie. Les infections
constituent la principale complication. Elles sont à l’origine de
décompensations aiguës nécessitant le plus souvent une ventilation assistée.
Elles entraînent une mortalité élevée.
Traitement.
Le traitement comprend la suppression des facteurs d’aggravation (principalement
le tabac), la lutte contre l’infection (traitement précoce des infections
pulmonaires, suppression des foyers chroniques ORL ou dentaires), la
kinésithérapie respiratoire, des médicaments (fluidifiants bronchiques,
bronchodilatateurs…), l’oxygénothérapie (au minimum 15 heures/jour) et la
ventilation mécanique au long cours. Dans un nombre de cas limité, notamment
chez les sujets jeunes, une transplantation pulmonaire peut être envisagée.
Prévention Et Education.
La mesure de prévention essentielle est la suppression la plus précoce possible
de l’intoxication tabagique.
1251. INSUFFISANCE SURRÉNALE.
Définition et Causes.
Déficit de sécrétion des hormones corticosurrénales (cortisol, aldostérone et
androgènes) qui peut être primitif par lésion des deux surrénales ou secondaire
par atteinte hypoyhalamo¬hypophysaire. L’insuffisance surrénale primitive est la
forme la plus fréquente et s’appelle la maladie d’Addison.
Epidémiologie.
La prévalence de la maladie d’Addison est de 50 cas pour 10 millions
d’habitants.
Signes Et Symptômes.
La forme classique associe une mélanodermie (pigmentation acquise prédominant
sur les zones découvertes, les plis de flexion, les cicatrices), une asthénie
associée à une anorexie et une hypotension artérielle aggravée en position
debout. La forme aiguë qui peut être révélatrice de la maladie est beaucoup plus
sévère avec une hypotension, voire un collapsus.
Investigations.
Il existe une hyponatrémie, une hyperkaliémie, une acidose métabolique et une
hypoglycémie Les examens spécifiques retrouvent une cortisolémie basse, une ACTH
plasmatique élevée et comprennent le test au Synacthène et le test à la
Métopirone. Le scanner des surrénales est indiqué en cas d’atteinte primitive;
le scanner et/ou IRM hypophysaire, en cas de forme secondaire.
Evolution, Complications et Pronostic.
En Cas De Forme Aiguë, Le Traitement doit être immédiat, sinon le risque de
décès est réel. Sous traitement, l’évolution est favorable.
Traitement.
Dans la forme lente, un traitement de substitution à vie est nécessaire
(hydrocortisone et 9¬alpha-fludrocortisone), associé à un éventuel traitement de
la cause. La prise en charge de la forme aiguë est une urgence, associant
réhydratation par sérum salé, hydrocortisone et traitement spécifique du facteur
déclenchant
Prévention et éducation .
Le patient doit être éduqué à adapter son traitement en cas de grande chaleur,
d’infection, de stress. Il doit être muni en permanence d’une carte mentionnant
sa pathologie ainsi que d’une ampoule d’hydrocortisone à administrer en IM en
cas de vomissements.
1252. INSUFFISANCE TRICUSPIDE.
Définitions et causes.
Atteinte de la valvule tricuspide, entraînant un reflux de sang entre
l’oreillette et le ventricule droit lors de la contraction du ventricule. La
forme la plus fréquente, appelée fonctionnelle, est une insuffisance avec une
dilatation du ventricule droit, conséquence d’une atteinte du cœur gauche
(valvulopathies mitrales, myocardiopathies non obstructives…). Les causes
organiques sont des atteintes liées à un rhumatisme articulaire (dans ce cas,
d’autres valvules sont presque toujours atteintes) ou, plus rarement, à une
endocardite.
Epidémiologie.
Relativement rare par rapport aux autres valvulopathies.
Signes et symptômes.
Les principaux signes cliniques sont une distension des jugulaires qui peuvent
être pulsatiles pendant la systole, ainsi qu’un gros foie qui subit une
expansion lors de la contraction du coeur. L’auscultation retrouve un souffle
systolique maximum à la xiphoïde.
Investigations.
L’échographie cardiaque couplée au doppler est l’examen le plus performant pour
affirmer le diagnostic. L’électrocardiogramme peut retrouver une fibrillation
auriculaire qui est assez fréquente.
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement, l’évolution se fait vers une insuffisance cardiaque
droite puis globale, irréversible.
Traitement.
Dans les formes peu sévères, un traitement médical (régime sans sel,
diurétiques, digitaliques, inhibiteurs de l’enzyme de conversion) suffit. Dans
les autres cas, le traitement chirurgical s’impose (le plus souvent
valvuloplastie).
Prévention.
Dans la forme fonctionnelle, la prévention implique le traitement précoce des
valvulopathies mitrales
1253. INSUFFISANCE VENTRICULAIRE DROITE.
Définition et causes.
Incapacité du ventricule droit à adapter son débit au retour du sang veineux
périphérique. Les principales causes sont l’insuffisance respiratoire chronique,
l’embolie pulmonaire, la péricardite, l’hypertension artérielle primitive,
l’infarctus du ventricule droit et l’insuffisance ventriculaire gauche, dans le
cadre de l’insuffisance cardiaque globale.
Epidémiologie.
Isolée, elle est rare. Le plus souvent, elle s’intègre dans un tableau
d’insuffisance cardiaque globale.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont un reflux hépatojugulaire ou une turgescence
jugulaire (dilatation des veines jugulaires spontanée ou lorsque l’on comprime
le foie) avec un gros foie douloureux, ainsi que des œdèmes blancs et mous au
niveau des membres inférieurs. Il existe également une tachycardie et une
diminution du volume des urines (oligurie).
Investigations.
L’échographie est l’examen diagnostique de choix (identification de la cause,
mesure des pressions pulmonaires). L’électrocardiogramme montre des signes
d’hypertrophie ventriculaire et auriculaire droite, ainsi qu’un bloc de branche
droit. La radiographie pulmonaire complète le bilan.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est variable selon la cause. Elle est habituellement progressive,
émaillée de poussées, plus ou moins rapprochées selon l’efficacité du
traitement.
Traitement et éducation.
Le traitement symptomatique comprend le repos, un régime sans sel, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion, les diurétiques et les digitaliques. Une
cause éventuelle sera également traitée. L’éducation du patient est importante:
diététique, pesée quotidienne…
1254. INSUFFISANCE VENTRICULAIRE GAUCHE.
Définition et causes.
Incapacité du ventricule gauche à éjecter un volume de sang suffisant lors de la
systole, due, le plus souvent, à un défaut de contraction et, plus rarement, à
une hypertrophie du ventricule. Les principales causes sont l’hypertension, la
maladie coronaire, les valvulopathies et les cardiomyopathies.
Epidémiologie.
C’est une des pathologies les plus fréquentes dans les pays développés chez les
sujets d’âge mûr et les personnes âgées.
Signes et symptômes.
Les manifestations sont essentiellement respiratoires: dyspnée d’effort, dyspnée
de décubitus, accès de dyspnée paroxystique nocturne pouvant aller jusqu’à
l’œdème aigu du poumon (>). L’auscultation pulmonaire retrouve une tachycardie
et des râles crépitants d’intensité variable en fonction de la gravité du
tableau. La classification de la New York Heart Association (NHYA) côte la
sévérité de l’insuffisance cardiaque:
• stade I : dyspnée pour des efforts importants inhabituels, aucune gêne dans la
vie courante.
• stade II : dyspnée à la marche rapide ou à la montée des escaliers (plus de
deux étages)
• stade III: dyspnée à la marche normale ou pour des efforts minimes.
• stade IV : dyspnée permanente de repos.
Investigations.
L’échocardiographie permet une quantification de l’atteinte et renseigne sur son
mécanisme. L’électrocardiogramme retrouve des signes d’hypertrophie
ventriculaire gauche. La radiographie de poumon évalue les signes de surcharge
pulmonaire (infiltration des bases). Les examens isotopiques et hémodynamiques
sont également utiles.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est émaillée de poussées aiguës (œdème aigu du poumon), favorisées
par un écart du régime sans sel, une poussée hypertensive, l’arrêt des
médicaments, les troubles du rythme auriculaire, une embolie pulmonaire… La
mortalité est élevée, due soit à une décompensation résistante au traitement,
soit à une mort subite, le plus souvent par trouble du rythme.
Traitement.
Il associe les règles hygiéno-diététiques (régime sans sel, perte de poids) et
un traitement médicamenteux (dérivés nitrés, diurétiques, inhibiteurs de
l’enzyme de conversion, digitaliques). La transplantation cardiaque peut être
indiquée en cas d’insuffisance cardiaque très évoluée chez un sujet jeune.
Prévention et éducation.
La prévention est celles des pathologies cardio-vasculaires ischémiques et
hypertensives. L’éducation (respect des règles hygiéno-diététiques,
auto-évaluation de la dyspnée…) est indispensable pour éviter les
décompensations aiguës.
1255. INSUFFISANCE VERTEBROBASILAIRE. Déficit circulatoire dans le territoire
des artères vertébrales et du tronc basilaire, dû à des lésions athéromateuses.
Les manifestations sont transitoires et récidivantes, parfois déclenchées par
l’effort ou des changements de position : céphalées postérieures, perte
d’équilibre, dérobement des jambes, troubles visuels, épisodes de somnolence ou
d’amnésie… L’évolution peut se faire vers la chronicité. Un accident
ischémique par thrombose est possible.
1256. INSULINOME.
Définition et causes
Tumeur des cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas produisant de
l’insuline.
Epidémiologie
La prévalence est de 0,8 par million, avec un âge privilégié d’apparition entre
50 et 70 ans.
Signes et symptômes
La triade de Whipple associe malaise hypoglycémique, hypoglycémies à jeun
répétées et réversibilité des troubles avec des apports sucrés. Les malaises à
jeun ou à l’effort ont parfois une présentation d’allure neuropsychiatrique.
Investigations
Une épreuve de jeûne est indiquée. On retrouve une insulinémie à jeun élevée
avec une glycémie basse; la pro-insuline et le peptide C sanguins sont élevés.
L’échographie et le scanner essayent de localiser la tumeur.
Evolution, complications et pronostic.
Il existe un risque de séquelles neurologiques en cas d’hypoglycémies répétées.
Traitement.
Il consiste en l’exérèse chirurgicale de la tumeur. En cas d’échec ou de
métastases, on utilisera la chimiothérapie.
Prévention et éducation.
Des malaises hypoglycémiques répétés doivent déclencher un bilan à la recherche
d’une tumeur de ce type.
1257. INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE (IVG).
Définition et causes
Interruption d’une grossesse autorisée par la loi de 1975 avant la 10′ semaine
de grossesse (la 12′ semaine d’aménorrhée). Elle doit être effectuée par un
médecin dans un établissement agréé. Ces mesures ont permis de diminuer la
mortalité et la morbidité, autrefois très importantes, des avortements
clandestins.
Epidémiologie
Environ 200 000 IVG sont pratiquées en France chaque année, soit environ 25 pour
100 naissances.
Procédure légale
Une première consultation médicale orientera la femme vers un établissement
d’information et de conseil familial pour un entretien, puis une deuxième
consultation, après un délai légal d’au moins une semaine, permettra de prendre
une décision définitive. Pour les mineures, le consentement d’un des parents ou
du représentant légal est nécessaire.
Méthodes
L’aspiration sous anesthésie locale ou générale reste la plus employée. Avant 7
semaines d’aménorrhée (dans certains cas, ce délai peut être porté à 9 SA),
l’IVG médicamenteuse est possible avec la mifépristone (RU 486 ou Mifégyne),
sans hospitalisation systématique.
La mifépristone (RU 486) est considérée par certains spécialistes médicaux comme
un véritable poisson pour l’organisme. Sa pratique est d’ailleurs interdite dans
certains pays en raison du danger de son utilisation et des effets collatéraux
et secondaires.
Complications.
Immédiates, ce sont les accidents anesthésiques, les hémorragies, les
perforations utérines ; retardées, ce sont les échecs, la rétention placentaire,
les infections et la stérilité, ainsi qu’une dégradation de l’état
psychosomatique de la jeune mère qui peut porter des remords à vie d’avoir
pratiqué l’IVG. Risque de stérilité.
1258. INTERTRIGO DES ORTEILS ou (>) PIED D’ATHLÈTE.
1259. INTESTIN COURT (SYNDROME DE L’). Syndrome qui s’observe chez des enfants
ou des adultes ayant subi une résection intestinale massive. Les principaux
symptômes sont des diarrhées, un gain de poids insuffisant ou une perte de
poids, des ballonnements, un manque d’appétit, une fatigue et des vomissements.
Le traitement consiste à adapter le régime alimentaire. En général, l’intestin
s’adapte et est finalement capable de jouer son rôle. Dans certains cas, une
transplantation intestinale peut être envisagée.
1260. INTOLERANCE AU fructose.
Définition et causes.
Maladie héréditaire, de transmission autosomique récessive, due à au déficit
d’un enzyme (fructose-1-phosphate aldolase) intervenant dans le métabolisme du fructose.
Epidémiologie.
Rare.
Signes et symptômes.
Les enfants deviennent symptomatiques lors de la diversification de
l’alimentation (fructosedans les fruits, le miel ou certains légumes). Les
signes habituels sont des vomissements, une anorexie, une apathie, des malaises,
un retard staturo-pondéral et un gros foie.
Investigations.
Le diagnostic est assuré par le dosage enzymatique sur une biopsie hépatique. Le
bilan sanguin peut montrer une hypoglycémie après les repas, une
hypophosphatémie, une hyperlactacidémie, une hyperuricémie, des troubles de la
coagulation et des fonctions hépatiques.
Evolution, complications et pronostic.
L’ingestion forcée de fructosepeut entraîner une insuffisance hépatique sévère
avec un syndrome hémorragique et un ictère. Une atteinte rénale est également
possible.
Traitement et éducation.
L’éviction complète du fructose, du sorbitol et du saccharoseentraîne une disparition des signes en quelques jours. Ce régime doit être poursuivi à vie.
1261. INTOLERANCE AUX HYDRATES DE CARBONE ou MALABSORPTION DES glucideS.
Définition et causes.
Incapacité à digérer les glucides par suite de l’absence d’un ou plusieurs
enzymes. La plus fréquente est le déficit en lactase (les autres sont beaucoup
plus rares).
Epidémiologie.
Il existe une diminution normale de l’activité lactasique à partir du sevrage
chez toutes les populations (75 % des adultes), sauf chez les Blancs du Nord où
elle persiste chez 60 à 90 des individus du fait d’une mutation régulatrice de
caractère dominant.
Signes et symptômes.
Chez l’enfant, on constate une diarrhée et l’absence de prise de poids. Chez
l’adulte, la symptomatologie est mineure avec des flatulences, des nausées, une
diarrhée lors de l’absorption de lactose.
Investigations.
Les selles sont acides. On a recours au test de tolérance au lactoseet au test respiratoire à l’hydrogène.
Evolution, complications et pronostic.
Dans deux tiers des cas, le régime sans lactosedonne de bons résultats. Dans
les autres cas, on constate un syndrome de l’intestin irritable ou colopathie
fonctionnelle.
Traitement.
Il associe un régime sans ou appauvri en lactoseet une supplémentation
calcique.
1262. INTOLÉRANCE AU lactose(>) INTOLÉRANCE AUX HYDRATES DE CARBONE.
1263. INTOLÉRANCE AUX PROTÉINES DU LAIT DE VACHE.
Définition et causes.
Accidents allergiques survenant lors de l’introduction du lait de vache dans
l’alimentation. Le mécanisme n’est pas complètement élucidé: un facteur
génétique est sûrement en cause. Des intolérances à d’autres protéines (soja,
riz, blé, œuf, viande, poisson) sont souvent associées.
Epidémiologie.
Sa fréquence est d’environ 0,5 % des naissances.
Signes et symptômes.
Le tableau peut être aigu avec un état de choc. Dans la majorité des cas, il
existe un simple accès de pâleur avec tachycardie, vomissements et diarrhée. Une
forme subaiguë avec diarrhée et vomissements chroniques, associés à un syndrome
de malabsorption avec chute du poids, est également possible.
Investigations.
Les différents examens montrent des signes de malabsorption non spécifiques
(hypoprotidémie, atrophie villositaire à la biopsie de l’intestin grêle). Le
seul examen fiable est l’épreuve de réintroduction qui se fait en milieu
hospitalier.
Evolution, complications et pronostic.
La suppression du lait de vache entraîne la guérison. Le caractère de
l’intolérance est transitoire, avec une durée moyenne de 6 à 10 mois.
Traitement et éducation.
Outre la suppression du lait de vache, il est nécessaire d’éliminer les
protéines fortement antigéniques (soja, riz, viande de bœuf, œuf, poisson) et de
n’introduire le gluten (céréales) que vers l’âge d’un an. Le lait de femme et
les aliments de substitution seront utilisés initialement, puis l’alimentation
sera progressivement diversifiée, avec la réintroduction du lait de vache en
dernier, très progressivement et sous contrôle médical.
Prévention.
En cas d’antécédents familiaux, la meilleure prévention est l’allaitement
maternel pendant au moins 3 mois, avec un sevrage très progressif.
1264. INVAGINATION INTESTINALE AIGUË DU NOURRISSON.
Définition et causes.
Pénétration d’un segment intestinal d’amont dans la lumière du segment
intestinal d’aval (en doigt de gant), le plus souvent au niveau de l’iléon
terminal qui s’engage dans la lumière du côlon ascendant et dont la conséquence
est une occlusion. Dans 90 % des cas, aucune cause n’est retrouvée.
Epidémiologie.
Il s’agit d’un enfant de 3 mois à 3 ans dans 90 % des cas (dont 60 % avant 1
an), avec une très nette prédominance de garçons.
Signes et symptômes.
Association de douleurs abdominales, de vomissements et de rectorragies
(émission de sang par l’anus). La palpation recherche le boudin d’invagination
(masse constituée par les anses invaginées).
Investigations.
L’échographie montre l’image du boudin d’invagination.
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement s’installe un tableau d’occlusion grave, avec
déshydratation, nécrose intestinale et perforation avec péritonite. Le pronostic
est lié à la précocité du diagnostic.
Traitement.
Le lavement baryté refoule le boudin et entraîne la désinvagination (90 % de
succès). En cas de contre-indication ou d’échec, on aura recours à la chirurgie.
Prévention.
Il faut prévenir les parents du risque de récidive (10 à 15 % après lavement).
1265. IRITIS ET IRIDOCYCLITE.
Définition et causes.
Inflammation de l’iris (iritis) ou de l’iris et du corps ciliaire (iridocyclite)
qui forment l’uvée antérieure. Elles surviennent soit dans le cadre d’une
infection locale (dentaire ou ORL), soit dans le cadre d’une maladie systémique,
surtout rhumatismale; mais le plus souvent, aucune cause n’est retrouvée.
Epidémiologie.
C’est une affection assez fréquente.
Signes et symptômes.
L’oeil est rouge et douloureux, avec un flou ou une baisse de l’activité
visuelle, accompagnés d’une photophobie (sensation douloureuse à la lumière) et
d’un myosis.
Investigations.
L’examen à la lampe à fente permet le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement et de récidive, des séquelles sont possibles
(glaucome, cataracte…).
Traitement.
Il associe les anti-inflammatoires et la dilatation de la pupille
(mydriatiques), ainsi que le traitement de la cause éventuelle.
Prévention.
Tout œil rouge douloureux nécessite un examen ophtalmologique.
1266. IRVINE-GASS (SYNDROME D’). Complication postopératoire de la cataracte qui
se traduit par un œdème de la macula. Elle se manifeste une photophobie avec
baisse de l’acuité visuelle. L’évolution peut se faire vers la guérison sans
séquelles ou vers une perte plus ou moins importante de la vision.
1267. ISAACS-MERTENS (SYNDROME DE). Affection très rare, d’origine inconnue,
caractérisée par une hypertonie musculaire permanente, entrecoupée de paroxysmes
indolores. S’y associent des fasciculations et des myokimies (secousses
musculaires plus prolongées). Le patient devient de plus en plus lent à se
mouvoir. La phénytoïne et la carbamazépine sont efficaces et une guérison
clinique est parfois possible après plusieurs années de traitement.
1268. ISCHÉMIE AIGUË DES MEMBRES INFÉRIEURS.
Définition et causes.
Occlusion brutale d’une artère d’un membre entraînant un arrêt de sa
vascularisation. Les deux causes principales sont les embolies, le plus souvent
d’origine cardiaque (troubles du rythme, cardiopathie ischémique,
valvulopathies…), et les thromboses athéromateuses.
Epidémiologie.
C’est une affection assez fréquente, en particulier chez le sujet âgé.
Signes et symptômes.
Association d’une douleur brutale, d’une impotence fonctionnelle plus ou moins
marquée, d’une pâleur du membre avec disparition des pouls en aval de
l’occlusion.
Investigations.
Le doppler permet le diagnostic. L’artériographie est utilisée en cas de doute.
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement, le pronostic vital peut être engagé, ainsi que le
pronostic fonctionnel du fait du risque d’amputation. Le pronostic dépend de la
rapidité du traitement.
Traitement.
L’association d’héparine, d’antalgiques et, éventuellement, de vasodilatateurs
est indiquée en attendant la revascularisation qui est la base du traitement
(thrombolyse in situ, thrombo¬aspiration et angioplastie, embolectomie
chirurgicale, pontage).
Prévention.
La prévention est celle des facteurs de risque de l’athérosclérose et sur
l’anticoagulation dans les cardiopathies emboligènes.
1269. ISOSPOROSE. Complication infectieuse du sida due à un parasite digestif,
Isospora belli. Elle se manifeste par une diarrhée chronique. Le diagnostic est
confirmé par l’examen parasitologique des selles. Le traitement utilise
l’association triméthoprimesulfaméthoxazole qui doit être poursuivi à dose
réduite en prévention, après la guérison.
1270. IVEMARK (SYNDROME DE). Maladie génétique, le plus souvent de transmission
autosomique récessive, caractérisée par une inversion (droite/gauche) de
position des organes thoraciques et/ou abdominaux. La gravité dépend des
anomalies au niveau du coeur et des gros vaisseaux. Une dyskinésie ciliaire (4)
est souvent associée.
1271. IVRESSE IDIOSYNCRASIQUE. Ivresse caractérisée par des modifications
importantes du comportement (agressivité…), apparaissant dans les minutes qui
suivent l’ingestion d’une quantité d’alcool insuffisante pour induire une
intoxication chez la plupart des gens.
1272. IVRESSE PATHOLOGIQUE.
Définition et causes.
Intoxication éthylique aiguë accompagnée de troubles d’allure psychiatrique.
Epidémiologie.
Elle est relativement rare et touche des sujets alcoolo-dépendants.
Signes et symptômes.
On distingue classiquement trois variétés :
• L’ivresse excitomotrice avec une agitation extrême, une agressivité et des
troubles majeurs du comportement pouvant être à l’origine de délits, souvent
graves.
• L’ivresse hallucinatoire avec des hallucinations auditives et visuelles contre
lesquelles le sujet peut se défendre avec violence; l’ivresse délirante avec une
autodénonciation délirante (risque de suicide), une mégalomanie, une jalousie et
un sentiment de persécution (risque de geste agressif).
Investigations.
L’alcoolémie est élevée à la phase initiale.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est longue (plusieurs jours) et se termine par un coma et une
amnésie post-critique. Il existe une tendance à la récidive sur le même mode.
Les principales complications sont les actes auto- ou hétéro-agressifs.
Traitement.
L’hospitalisation est nécessaire, si besoin sous contrainte et en chambre
d’isolement. La sédation utilise les benzodiazépines ou les neuroleptiques .
Prévention.
Le sevrage peut être facilité par une prise en charge par des équipes
spécialisées (CCAA = centre de cure ambulatoire en alcoologie) et le soutien
d’associations d’anciens alcooliques
1273. JACKSON-LAWLER (SYNDROME DE). Maladie héréditaire, de transmission
autosomique dominante, faisant partie des pachyonychie congénitales. Elle est
caractérisée par des dents néonatales, des kystes épidermiques, un
épaississement des ongles (pachyonychie), un épaississement de la couche cornée
de la paume des mains et de la plante des pieds (kératodermie palmoplantaire),
des bulles lors des traumatismes et de l’exposition au soleil, une hypertrophie
cutanée autour des follicules pileux (kératose folliculaire) et une voix rauque.
Les différents traitements à visée cutanée sont décevants. Il existe un risque
important de cancer du côlon associé, qui impose une surveillance régulière.
1274. JACOBSEN (SYNDROME DE) . Ensemble de malformations congénitales dues à une
perte du bras long du chromosome 11. Le syndrome est caractérisé par des
difformités diffuses (notamment de la tête avec une trigonocéphale = aspect
triangulaire du crâne), un retard mental, des anomalies cardiaques, une sténose
du pylore et une thrombocytopénie (risque de saignements).
1275. JACOD (SYNDROME DE) . Syndrome dû à la compression de plusieurs nerfs
crâniens (II, III, IV, V, VI) par une tumeur locale (pharyngée, hypophysaire,
orbitaire). Les principaux signes sont une cécité et une paralysie oculaire
complète unilatérales, accompagnées de douleurs de la partie supérieure de la
face correspondante (névralgie du trijumeau).
1276. JADASSOHN -LEWANDOWSKY (SYNDROME DE) Maladie cutanée héréditaire, de
transmission autosomique dominante, faisant partie des pachyonychies
congénitales, qui apparaît chez le nouveau-né ou le jeune enfant. Elle est
caractérisée par un épaississement de la couche cornée de la paume des mains et
de la plante des pieds (kératodermie palmoplantaire) ainsi que des ongles
(pachyonychie), associée à une hypertrophie cutanée autour des follicules pileux
(kératose folliculaire) et à des lésions de la muqueuse buccale (leucokératose
orale). Les différents traitements sont décevants.
1277. JAFFÉ-LICHTENSTEIN (SYNDROME DE).
Affection osseuse congénitale caractérisée parla dégénérescence fibreuse de la
moelle (dysplasie fibreuse des os) avec la formation de kystesosseux. Elle
touche principalement les os longs (col du fémur, tibia) et se manifeste par des
douleurs, des déformations et des fractures. L’évolution est très longue. Le
traitement est symptomatique.
1278. JAMBES SANS REPOS (SYNDROME DES)ou IMPATIENCE DES MEMBRES INFÉRIEURS.
Syndrome assez fréquent, qui touche surtout les femmes, caractérisé par une
sensation désagréable, indéfinissable, exaspérante, au niveau des membres
inférieurs, qui crée un irrésistible besoin de bouger les jambes. Il peut
apparaître en position assise, mais il survient fréquemment au lit et peut être
une cause d’insomnie. Il s’agit d’une affection bénigne dont l’évolution se fait
souvent par poussées entrecoupées de rémission. Le traitement fait appel à des
mesures hygiénodiététiques (augmentation de l’activité physique et diminution
des excitants comme le café) et à certains médicaments comme le ropironole , les
antiépileptiques et des somnifères.
1279. JARCHO-LEVIN (SYNDROME DE) ou DYSOSTOSE SPONDYLOCOSTALE.
Maladie osseuse héréditaire de transmission autosomique récessive, touchant
principalement les vertèbres et les côtes. Le thorax est sévèrement déformé.
L’évolution est fréquemment mortelle à brève échéance par infection pulmonaire.
1280. JERVELL ET LANGE-NIELSEN (SYNDROME DE). Affection héréditaire rare, de
transmission autosomique récessive, caractérisée par une surdité et une mutité
associées à des syncopes survenant à l’effort. L’électrocardiogramme montre un
important allongement de l’espace QT (4 QT long congénital (syndrome du)). Le
décès survient dans les premières années de vie par une mort subite due à des
troubles du rythme ventriculaire.
1281. JET LAG.
Définition et causes.
Expression recouvrant l’ensemble des symptômes résultant de l’adaptation de
l’organisme à un nouvel horaire lors d’un voyage entraînant un décalage horaire
(surtout au-delà de 3 heures). La cause est une désynchronisation de rythmes
biologiques circadiens.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont des troubles du sommeil (difficultés
d’endormissement, réveils nocturnes avec difficultés de rendormissement, réveil
trop précoce le matin) et de l’humeur (irritabilité, malaise, troubles de la
mémorisation, baisse des capacités d’apprentissage). Après un décalage de 6
heures, il faut deux à trois jours pour réajuster le cycle veille/sommeil, sept
jours pour régulariser le rythme de la température et plusieurs semaines pour
adapter certains rythmes hormonaux. L’adaptation est plus facile lors d’un
voyage vers l’ouest (allongement de la journée) que vers l’est (réduction de la
journée).
Principaux conseils.
Pour ceux qui le peuvent et qui présentent une intolérance sévère au décalage,
s’ajuster durant les jours qui précèdent le départ en décalant progressivement
ses horaires de coucher et de lever d’une demi-heure par jour. Renforcer les
synchroniseurs sociaux en mettant sa montre à l’heure d’arrivée dès
l’embarquement et en adoptant les horaires locaux pour les repas Utiliser la
lumière: les écrans de lumière de haute intensité permettent une adaptation plus
rapide des rythmes circadiens aux nouveaux horaires (lors d’un voyage vers
l’ouest: exposition le soir et protection le matin; lors d’un voyage vers l’est:
exposition le matin et protection lesoir). Éviter les siestes pendant la
journée, prendre des repas riches en protéines durant la journée et riches en
glucides le soir. En cas de mauvaise tolérance, il est possible d’utiliser, à
faible dose et pendant une durée de trois jours, un hypnotique. La mélatonine
utilisée dans certains pays n’est pas commercialisée en France.
1282. JEUNE (SYNDROME DE). Maladie génétique, de transmission autosomique
récessive, caractérisée par une malformation asphyxiante du thorax, associée à
des anomalies du bassin et des doigts. Elle porte également le nom de dystrophie
thoracique asphyxiante.
1283. JOB-BUCKLEY (SYNDROME DE) . Affection caractérisée par un défaut des
défenses de l’organisme due à une anomalie de la fonction des polynucléaires
neutrophiles. Elle se manifeste chez l’enfant par des infections récidivantes
(suppurations froides multiples à staphylocoques au niveau de la peau, des
sinus, des poumons…) et un eczéma récidivant. Ces enfants ont généralement une
peau claire et des cheveux roux. Le bilan biologique retrouve un taux élevé
d’immunoglobulines E.
1284. JOHANSON-BLIZZARD (SYNDROME DE). Affection héréditaire très rare, de
transmission autosomique récessive, caractérisée par une insuffisance
pancréatique et une malformation du nez. Il peut s’y associer une imperforation
anale, une hypothyroïdie, une surdité et un nanisme.
1285. JONCTION PYÉLO-URÉTÉRALE (SYNDROME DE LA).
Définition et causes.
Malformation urinaire congénitale caractérisée par une anomalie de l’abouchement
des cavités rénales dans l’uretère, qui entraîne une mauvaise évacuation de
l’urine.
Epidémiologie.
Ce syndrome représente 40 % des malformations de l’appareil urinaire. Il est
bilatéral dans 15 % des cas.
Signes et symptômes.
L’échographie fœtale peut montrer dès la 30′ semaine des dilatations des cavités
pyélocalicielles. Chez le nourrisson, il peut être révélé par une masse
abdominale, une infection urinaire sévère. Chez l’adulte, la découverte est liée
à une douleur lombaire à type de colique néphrétique ou intermittente, ou bien à
une complication.
Investigations.
L’échographie montre une dilatation des cavités pyélocalicielles. L’urographie
intraveineuse permet le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont une infection (pyélonéphrite), un calcul qui
peut entraîner des coliques néphrétiques ou une hématurie, une destruction du
rein en amont en cas de retard au diagnostic et une insuffisance rénale en cas
d’obstacle bilatéral.
Traitement.
Le traitement est chirurgical par résection de la zone pathologique. Une
ablation du rein (néphrectomie) est nécessaire en cas de destruction rénale.
1286. JOUBERT-BOLTSHAUSER (SYNDROME DE) . Affection génétique, de transmission
autosomique récessive, associant un nystagmus, des mouvements rythmiques de la
langue, un défaut de développement du cervelet, un trouble de la coordination
des mouvements (ataxie) et un retard mental. L’évolution est mortelle en
quelques années.
1287. JUBERG-HAYWARD (SYNDROME DE).Également appelé syndrome oro-crânio-digital,
il s’agit d’une maladie génétique transmise sur le mode autosomique dominant.
Elle est caractérisée par l’association d’une fente labio-pala¬tine, d’une
microcéphalie et d’un développement insuffisant des pouces (hypoplasie).
1288. JUBERG-MARSIDI (SYNDROME DE). Syndrome génétique très rare, de
transmission récessive liée à l’X, caractérisé par un retard mental sévère, un
retard de croissance, une surdité, des organes génitaux de petite taille et une
mort précoce.
1289. JUMEAU TRANSFUSE (SYNDROME DU) ou (–}) TRANSFUSEUR TRANFUSE (SYNDROME).
1290. JUNG-VOGEL (SYNDROME DE). Association d’une érythrodermie ichtyosiforme
(4) congénitale non bulleuse et d’une dystrophie cornéenne.
1291. JONGLING (OSTÉITE POLYKYSTIQUE DE) ou (>}) PERTHES-JUNGLING (MALADIE DE).
Explorer :
A lire aussi:
- DICTIONNAIRE DES MALADIES T – U – V – W – X – Y – Z.S’informer de maladies comme par exemple la tachycardie, tendinite, thrombose, toxoplasmose, tuberculose, urticaire, varicelle, varices, vitiligo, zona. Consultez votre dictionaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES T – U – V – W – X – Y – Z. La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES Q – R – SDécouvrez des maladies comme reflux, rhinopharyngite, roséole, rougeole, sarcoïdose, scarlatine, schizophrénie, sciatique, sclérose en plaques, scoliose, septicémie, sida, sinusite, spina Bifida, syphilis. Consultez votre dictionaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES Q – R – S La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES N – O – PDécouvrez des maladies comme narcolepsie, orgelet, ostéoporose, paludisme, pancréatite, papillomavirus, pervers narcissique, pharyngite, phlébite, pneumonie, pneumothorax, polype, progéria, psoriasis, psychose. Consultez votre dictionaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES N – O – P La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des effets […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES K – L – MDécouvrez des maladies comme : leucémie, lumbago, lupus, maladie, maladie de Charcot, maladie de Crohn, maladie de Lyme, maladie de Verneuil, malaise vagal, méningite, migraine, mononucléose, mucoviscidose, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES K – L – M La […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES H – I – JDécouvrez des maladies comme : hallux valgus, hémorroïdes, hépatite B, hernie discale, hernie hiatale, hernie inguinale, herpès, hypertension, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, impétigo, infarctus, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES H – I – J La pathologie est l’étude des maladies, […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES F – Gdécouvrez des maladies comme : fibromyalgie, furoncle, gale, gangrène, gastro entérite, glaucome, grippe, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES F – G La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES BDécouvrez des maladies comme : boulimie, bouton de fièvre, BPCO, bronchite, burn-out, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES B La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES CDécouvrez des maladies comme : cancer, chlamydia, cholestérol, conjonctivite, constipation, coqueluche, cystite, cytomégalovirus. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES C La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des effets morbides qu’elle entraîne. C Bacchus C Définition et causes. Dilatations de […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES D – EDécouvrez des maladies comme dépression, diabète, diabète de type 2, diarrhée, diverticulite, ebola, eczéma, embolie pulmonaire, emphysème, endométriose, epicondylite, epilepsie, erysipèle, escarre. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES D – E La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des effets […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES ADécouvrez des maladies comme : acné, acouphènes, AIT, algodystrophie, allergies, anémie, angine, angine blanche, appendicite, arthrose, autisme, AVC, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES A La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble […]
