Découvrez des maladies comme narcolepsie, orgelet, ostéoporose, paludisme, pancréatite, papillomavirus, pervers narcissique, pharyngite, phlébite, pneumonie, pneumothorax, polype, progéria, psoriasis, psychose. Consultez votre dictionaire de maladies.
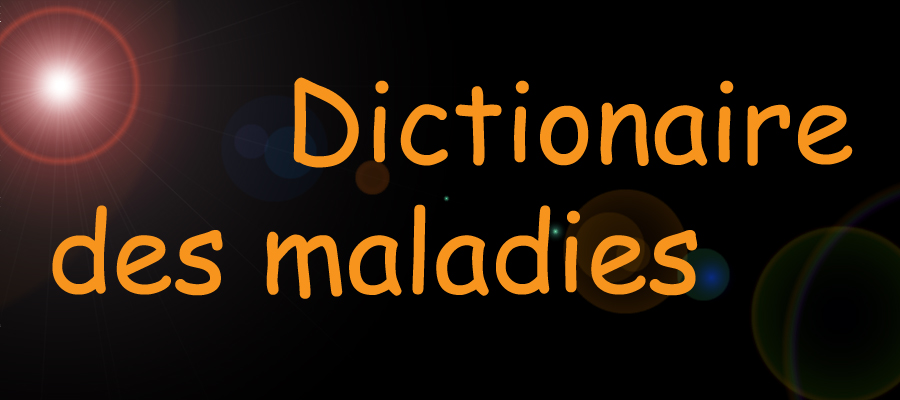
DICTIONNAIRE DES MALADIES N – O – P
La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des effets morbides qu’elle entraîne.
N – O – P
N
1689. NAEGELI-FRANCESCHETTI JADASSOHN (SYNDROME DE) Maladie cutanée héréditaire,
de transmission autosomique dominante, du groupe des kératodermies
palmoplantaires. Elle touche les mains et les pieds, et est caractérisée par un
épaississement (kératodermie) avec une disparition des stries de la peau (adermatoglyphie),
une pigmentation en mailles de filet, des défauts de l’émail dentaire et une
diminution de la sudation (hypohidrose). Le traitement est symptomatique.
1690. NÆVOMATOSE BASOCELLULAIRE.
Définition et causes.
Maladie héréditaire, de transmission autosomique dominante, qui touche la peau,
le squelette et le système nerveux.
Epidémiologie.
Rare.
Signes et symptômes.
L’atteinte cutanée comprend de petites plaques de couleur rose foncé,
apparaissant sur le visage avant la puberté. Au niveau du squelette, il s’agit
essentiellement de kystes de la mâchoire et de malformations costales.
L’atteinte du système nerveux se manifeste par des tumeurs.
Evolution, complications et pronostic.
La transformation maligne des lésions cutanées est fréquente à l’âge adulte
(cancer basocellulaire).
Traitement.
Le traitement se limite à l’exérèse, dès l’adolescence, des lésions cutanées
suspectes.
1691. NÆVUS.
Définition et causes.
Plaque ou excroissance cutanée pigmentée, constitué d’un amas de mélanocytes
(cellules qui fabriquent les pigments de la peau). L’origine peut être
congénitale ou acquise, durant l’enfance et l’adolescence.
Epidémiologie.
Concerne quasiment la totalité de la population.
Signes et symptômes.
Il s’agit des classiques «grains de beauté», dont la taille, la couleur et
l’aspect sont très variables. On distingue principalement: les nævus plans,
volontiers recouverts de poils ; les nævus en dôme, présents en particulier sur
le tronc et sur le visage; les nævus bleus; les nævus de Sutton, entouré d’un
halo décoloré; les nævus dysplasiques, polychromes, aux bords irréguliers.
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est la transformation maligne en mélanome. Les nævus
dysplasiques et les nævus congénitaux géants sont ceux qui présentent le plus
fort risque de dégénérescence.
Traitement.
Toute lésion suspecte doit bénéficier d’une exérèse et d’un examen histologique.
Ce doit être le cas notamment en cas de na:vus soumis à des irritations
multiples (au niveau des mains, de pieds, de la barbe, de la ceinture…).
Prévention et éducation.
La surveillance par le patient lui-même est essentielle. Toute modification de
la couleur, des contours ou de la taille, l’apparition d’une douleur ou de
démangeaisons doivent être signalées et conduire à l’exérèse du nævus.
1692. NÆVUS GÉANT. Nævus congénital qui touche surtout le sexe féminin. La
localisation est principalement dorsale, avec une ou plusieurs nappes de surface
plane (parfois verruqueuse), de teinte foncée avec des taches noires recouvertes
d’un nombre important de poils. Le plus souvent, il reste stable mais une
transformation maligne est possible, ce qui implique la nécessité d’une
surveillance régulière. L’ablation de la lésion est conseillée.
1693. NÆVUS DE ITO. Hyperpigmentation de certaines parties de l’oeil et du
moignon de l’épaule du même côté. La cause est une anomalie de migration des
cellules pigmentaires (mélanoblastes) chez le foetus. Ces lésions ne
disparaissent pas.
1694. NÆVUS MULTIPLES FAMILIAUX. Atteinte cutanée apparaissant dans l’enfance,
définie par la présence de 10 à 100 nævi sur le thorax et les membres, de taille
variable (5 à 15 mm), de contours irréguliers, avec une pigmentation plus ou
moins variée. Le risque de cancérisation (mélanome >) est inférieur à 10% à 70
ans.
1695. NÆVUS DE OTA Hyperpigmentation du visage, de certaines parties de l’oeil
et des muqueuses aérodigestives supérieures. La cause est une anomalie de
migration des cellules pigmentaires (mélanoblastes) chez le foetus. Ces lésions
ne disparaissent pas.
1696. NÆVUS SÉBACÉ DE JADASSOHN . Nævus apparaissant dès les premières semaines
de vie, localisé au niveau du cuir chevelu, du front, des tempes ou des
pommettes. Il est formé d’une plaque bien délimitée, légèrement surélevée, de
couleur rose-janunâtre, constituée de petits éléments séparés de fins sillons.
Elle est souvent recouverte de squames et provoque une alopécie. Il existe un
risque important de transformation en cancer basocellulaire.
1697. NÆVUS DE SUTTON. Nævus entouré d’un halo dépigmenté (achromique) et bien
limité. Il est fréquent chez l’adolescent et évolue généralement vers la
disparition en quelques mois.
1698. NAGER (MALADIE DE) ou DYSOSTOSE ACROFACIALE.
Maladie génétique rare, également appelée dysostose acrofaciale. Elle comprend
des anomalies de la face (paupières obliques, absence ou développement
insuffisant des mandibules, malformations de l’oreille, fente palatine, absence
de cils sur la paupière inférieure et implantation des cheveux descendant sur la
joue), des anomalies des membres supérieurs (absence de pouce et parfois de
radius). Des anomalies digestives, rénales ou cardiaques sont également
possibles.
1699. NAIL-PATELLA SYNDROME ou ONYCHO-OSTEODYSPLASIE.
Maladie héréditaire rare, de transmission autosomique dominante. Elle est
caractérisée par des anomalies osseuses (absence ou insuffisance de
développement de la rotule uni-ou bilatérale, subluxation des têtes radiales,
déformation du bassin) et une absence ou une insuffisance de développement des
ongles. Une atteinte rénale est associée dans la moitié des cas qui peut évoluer
dans 30 % des cas vers une insuffisance rénale.
1700. NAME SYNDROME. Syndrome associant des nævus (petites tumeurs cutanées
pigmentées), un myxome de l’oreillette (myxome cardiaque >), un neurofibrome
myxoïde (tumeur des nerfs périphériques) et des éphélides (taches de rousseur).
Cette ancienne appellation est aujourd’hui intégrée dans la maladie appelée
complexe ou syndrome de Carney (>).
1701. NANCE-HORAN (SYNDROME DE). Maladie génétique, de transmission liée au
chromosome X, associant des anomalies dentaires et crâniofaciales, ainsi qu’une
cataracte.
1702. NANISME CAMPOMÉLIQUE ou DYSPLASIE CAMPOMÉLIQUE.
Maladie génétique, de transmission autosomique dominante, caractérisée par un
nanisme avec une incurvation des os longs des membres, une détresse respiratoire
sévère et des anomalies génitales dans les deux sexes, avec une réversion de
sexe chez les patients de sexe masculin. La mort survient généralement en
période néonatale du fait de l’insuffisance respiratoire, mais l’espérance de
vie peut varier en fonction de la sévérité de l’atteinte.
1703. NANISME THANATOPHORE Variété de nanisme incompatible avec la vie,
caractérisé essentiellement par des membres très courts et un thorax très étroit.
1704. NARCOLEPSIE ou MALADIE DE GÉLINEAU
Définition et causes.
Maladie caractérisée par une somnolence anormale avec des accès irrépressibles
de sommeil. La cause est inconnue, mais un typage HLA particulier est associé
dans 100 % des cas.
Epidémiologie.
La fréquence est de 60 cas pour 100000 habitants. Le début se situe vers l’âge
de 20 ans et l’homme est plus souvent touché que la femme.
Signes et symptômes.
Cataplexie, terme désignant l’association d’accès irrépressibles de sommeil et
d’accès paroxystique d’atonie musculaire, favorisée par les émotions, le stress
et survenant en pleine conscience. Des épisodes de paralysie du sommeil et
d’hallucinations lors de l’endormissement sont présents chez un tiers des
patients.
Investigations.
Enregistrement polysomnographique du sommeil (EEG, ECG et EMG).
Evolution, complications et pronostic.
Il peut exister un retentissement social et professionnel avec des risques
d’accidents, notamment de la circulation.
Traitement.
Le modafinil permet de stimuler l’éveil. Un nouveau médicament, l’oxybate de
sodium , apporte une amélioration aux patients atteints d’épisodes de cataplexie
gênants.
1705. NARES Acronyme pour non allergic rhinitis with eosinophilia syndrome. Il
s’agit d’une atteinte sévère survenant à l’âge adulte, caractérisée par des
épisodes sporadiques de rhinorrhée (écoulement de nez), d’éternuements et,
parfois, de perte de l’odorat, d’irritation pharyngée et oculaire. Le nombre
d’éosinophiles dans les sécrétions est très important. Le traitement est
symptomatique.
1706. NARP SYNDROME. Syndrome génétique, à hérédité maternelle, associant une
neuropathie (atteinte neurologique sensorielle), une ataxie (troubles de la
coordination des mouvements) et une rétinite pigmentaire. Il existe, en outre,
des crises d’épilepsie et une détérioration intellectuelle progressive. Il
débute après l’âge de 5 ans.
1707. NASH.
Définition et causes.
Acronyme anglais pour non alcoholic steato-hepatitis (stéatose hépatique non alcoolique). Il s’agit d’une atteinte hépatique caractérisée à la ponction-biopsie hépatique par l’existence d’une stéatose plus ou moins associée à une fibrose, en l’absence d’alcoolisme ou d’autres maladies du foie chez le patient. Les principales causes sont le surpoids, le diabète de type II, les hyperlipidémies, certains médicaments (Cordarone®, Tildiem®, Nolvadex , Dépakine®) ou toxiques industriels; parfois, aucune cause n’est retrouvée.
Epidémiologie.
Affection relativement fréquente.
Signes, symptômes et investigations.
Il s’agit souvent d’une découverte fortuite lors d’un bilan hépatique montrant
une augmentation modérée des transaminases (< 10 fois la normale) et/ou des γ
-GT, souvent associée à une hyperférritinémie. Seule la ponction-biopsie
hépatique permet d’affirmer le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait vers une fibrose ou une cirrhose du foie dans 15 à 50 % des
cas.
Traitement.
C’est celui de la cause. Une réduction progressive du surpoids et des mesures
hygiénodiététiques sont également indispensables.
1708. NÉCROBIOSE LIPOÏDIQUE ou (>) OPPENHEIM-URBACH (MALADIE D’).
1709. NÉCROLYSE ÉPIDERMIQUE TOXIQUE ou (>) LYELL (SYNDROME DE).
1710. NÉCROSE CORTICALE RÉNALE.
Définition et causes
Atteinte rénale caractérisée par une nécrose du cortex rénal due à l’obstruction
des vaisseaux irriguant ces zones. Les principales causes sont une complication
d’une grossesse pathologique (décollement placentaire, placenta praevia,
hémorragie utérine, éclampsie…) et le choc septique.
Epidémiologie.
Rare.
Signes et symptômes.
Apparition brutale de douleurs de la fosse lombaire, d’une hématurie (sang dans
les urines) et d’une oligurie ou d’une anurie (diminution ou absence d’urine).
Investigations.
L’examen des urines montre une protéinurie et une hématurie. Le bilan biologique
retrouve une insuffisance rénale.
Evolution, complications et pronostic.
L’insuffisance rénale peut être définitive.
Traitement.
La dialyse est le seul traitement.
1711. NÉCROSE PAPILLAIRE RÉNALE.
Définition et causes.
Nécrose ischémique des papilles liée à une atteinte de la vascularisation rénale. Les principales causes sont les pyélonéphrites (>) avec ou sans obstruction, le diabète, la drépanocytose, l’abus prolongé d’analgésiques.
Epidémiologie.
Peu fréquent.
Signes et symptômes.
Les manifestations les plus fréquentes sont des douleurs lombaires, une
hématurie (sang dans les urines), de la fièvre et des frissons.
Investigations.
Les examens biologiques retrouvent une insuffisance rénale. L’urographie
intraveineuse peut montrer des images caractéristiques.
Evolution, complications et pronostic.
Le syndrome infectieux peut se transformer en septicémie et entraîner un décès.
Traitement.
Le traitement de l’infection s’impose, éventuellement associé à une épuration
extra-rénale si nécessaire.
1712. NÉCROSE RÉTINIENNE AIGUË. Affection rare due à un virus du groupe herpès.
Elle survient à n’importe quel âge et est, le plus souvent, unilatérale (deux
tiers des cas). Trois à quatre semaines après un syndrome grippal apparaissent
des troubles de la vision qui s’aggravent progressivement. L’examen
ophtalmologique montre une nécrose rétinienne d’abord périphérique, puis qui
progresse vers le pôle postérieur. La principale complication est un décollement
de la rétine, de très mauvais pronostic. L’atteinte du deuxième oeil se produit
en général dans les semaines ou mois qui suivent celle du premier oeil. Le
traitement associe la chirurgie, les antiviraux, les anti¬inflammatoires et les
anticoagulants.
1713. NELSON (SYNDROME DE) . Tumeur glandulaire (adénome) de l’hypophyse
survenant après une ablation des deux surrénales dans le cadre d’un syndrome de
Cushing.
1714. NÉOPLASIES ENDOCRINES MULTIPLES (NEM). Groupe de maladies héréditaires, de
transmission autosomique dominante et à expression variable, caractérisées par
des tumeurs malignes au niveau de plusieurs glandes endocrines. Une surveillance
régulière des membres d’une famille touchée est nécessaire pour identifier
précocement les sujets atteints. Il existe trois formes distinctes : le syndrome
de Wermer ou NEM de type 1 (>), le syndrome de Sipple ou NEM de type 2 A (>) et
la NEM de type 2 B (>).
1715. NÉOPLASIE ENDOCRINE MULTIPLE DE TYPE 2 B (NEM 2 B) ou SYNDROME DE GORLIN.
Maladie héréditaire rare, de transmission autosomique dominante et à expression
variable, atteignant le sujet jeune, qui associe un cancer médullaire de la
thyroïde, un phéochromocytome, des signes cliniques particuliers cutanés et
muqueux, ainsi que des signes digestifs. Le pronostic est très sombre.
1716. NÉPHROANGIOSCLÉROSE BÉNIGNE.
Définitions et causes.
Lésions des artères rénales de petit calibre, attribuées à une hypertension
artérielle ancienne non ou insuffisamment traitée. Les principaux facteurs de
risque sont une hypertension artérielle sévère, un tabagisme important,
l’origine ethnique (Afrique noire) et le diabète.
Epidémiologie.
Affection fréquente du fait du nombre important de patients souffrant
d’hypertension artérielle.
Signes et symptômes.
Association d’une hypertension artérielle et d’une micro-albuminurie.
Investigations.
Les examens biologiques retrouvent une créatininémie élevée et une protéinurie.
À l’échographie, les reins sont de petite taille et la biopsie rénale montre des
lésions non spécifiques qui peuvent être observées au cours de diverses maladies
vasculaires rénales avec ou sans hypertension.
Evolution, complications et pronostic.
Un traitement rigoureux permet d’arrêter ou, au minimum, de ralentir l’évolution
de la néphroangiosclérose. En l’absence de traitement, évolution vers une
insuffisance rénale terminale. En cas de créatininémie > 250 µmol/L, le risque
de mortalité cardiovasculaire est multiplié par 8 par rapport aux personnes avec
une créatininémie normale.
Thérapeutique.
Il associe des règles hygiénodiététiques (régime pauvre en sel, exercice
physique régulier, réduction pondérale…) et un traitement médicamenteux
antihypertenseur (objectif: pression artérielle systolique < 130 mmHg et
pression artérielle diastolique < 80 mmHg).
1717. NÉPHROANGIOSCLÉROSE MALIGNE.
Définitions et causes.
Association d’une hypertension artérielle maligne et d’une insuffisance rénale
rapidement progressive.
Signes et symptômes.
La pression artérielle systolique (PAS) se situe entre 150 et 290 mmHg et la
diastolique (PAD) entre 100 et 180 mmHg. Il s’agit, le plus souvent, d’une
hypertension préexistante ancienne non contrôlée, avec une interruption
fréquente du traitement parle patient. En quelques jours ou semaines
apparaissent des signes neurologiques à type d’encéphalopathie hypertensive en
rapport avec un oedème cérébral (céphalée progressivement croissante, nausées et
vomissements, agitation, confusion et à un stade plus évolué, convulsions et
coma), une insuffisance cardiaque avec un oedème pulmonaire et une baisse de
l’acuité visuelle liée à une rétinopathie hypertensive, avec un oedème
papillaire et des hémorragies rétiniennes.
Investigations.
La biologie retrouve une créatinine et une urée élevées, ainsi qu’une
protéinurie et une hématurie. La biopsie rénale montre des lésions
caractéristiques des artères rénales qui se thrombosent.
Évolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement, l’évolution est fatale en quelques semaines ou mois.
Le pronostic est favorable en cas de traitement bien conduit. Cependant, il peut
exister une aggravation initiale de la fonction rénale nécessitant une dialyse
avant une récupération progressive de cette dernière.
Thérapeutique
Une hospitalisation en urgence dans un service de soins intensifs est
indispensable pour normaliser la pression artérielle et traiter les défaillances
cardiaques et rénales éventuelles.
1718. NÉPHROBLASTOME ou TUMEUR DE WILMS.
Définition et causes.
Tumeur maligne du rein d’origine embryonnaire touchant l’enfant entre 1 et 5
ans.
Épidémiologie.
Il représente plus de 90 % des tumeurs du rein de l’enfant avec 100 nouveaux cas
par an en France.
Signes et symptômes.
Il s’agit le plus souvent de la découverte fortuite d’une masse abdominale. Il
peut exister une fièvre, une altération de l’état général, des signes urinaires,
une hématurie ou un syndrome abdominal aigu par hémorragie intratumorale ou
rupture.
Investigations.
L’échographie complétée par l’urographie, le scanner et l’IRM visualisent la
tumeur.
Évolution, complications et pronostic.
Des métastases, pulmonaires le plus souvent, sont possibles. La survie dépend de
l’extension et de l’existence de métastases : elle est proche de 100 % dans les
formes locales sans métastases.
Traitement
Il associe la chirurgie à une chimiothérapie pré-et postopératoire.
1719. NÉPHROCALCINOSE
Définition et causes
Présence de calcifications multiples au sein du parenchyme rénal, notamment dans
la zone médullaire dont la cause la plus fréquente est la maladie de Cacchi et
Ricci (4). Les autres causes sont les acidoses tubulaires distales et toutes les
causes d’hypercalcémie.
Épidémiologie.
Fréquence élevée.
Signes et symptômes.
La découverte se produit au cours du bilan d’une polyurie, d’une lithiase, d’une
insuffisance rénale ou d’une hypercalcémie.
Investigations.
L’urographie intraveineuse montre des calcifications bilatérales.
Évolution, complications et pronostic.
La néphrocalcinose est irréversible, avec une évolution vers l’insuffisance
rénale en l’absence de traitement.
Traitement.
C’est le traitement de la cause, en particulier de l’hypercalcémie.
1720. NÉPHRONOPHTISE . Maladie génétique à transmission autosomique récessive,
caractérisée par la présence de kystes dans la médullaire rénale et par une
fibrose tubulo interstitielle diffuse. Vers l’âge de 4 à 5 ans apparaît un
syndrome polyuro-polydispsique (soif excessive et urines très abondantes), avec
un syndrome tubulaire évoluant vers l’insuffisance rénale terminale vers l’âge
de 10-12 ans. Dans 10 à 15 % des cas, il existe une cécité précoce par
dégénérescence rétinienne.
1721. NÉPHROPATHIE DES ANALGÉSIQUES . Néphropathie tubulo-interstitielle
chronique (>) due à l’abus d’analgésiques. Autrefois très fréquente et due à la
prise régulière pendant des années, en général pour des céphalées chroniques, de
phénacétine qui a été retirée du marché en France. Aujourd’hui, les médicaments
en cause sont les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Elle peut être à
l’origine d’une insuffisance rénale dont l’évolution peut être ralentie, voire
stoppée, par l’arrêt de l’intoxication.
1722. NÉPHROPATHIE diabétique.
Définition et causes.
Altération de la fonction rénale due aux lésions vasculaires liées au diabète (microangiopathie diabétique).
Epidémiologie.
35 à 50 % des patients atteints de diabète insulinodépendant sont touchés et 25 à 30 % de ceux souffrant d’un diabète non insulinodépendant.
Signes et symptômes.
Les signes cliniques n’apparaissent qu’au stade de l’insuffisance rénale
terminale.
Investigations.
Il existe initialement une augmentation de l’excrétion urinaire d’albumine. La
créatininémie reflète le degré d’insuffisance rénale. Le calcul de la clairance
de la créatinine est un meilleur reflet de la fonction rénale chez le sujet âgé.
Evolution, complications et pronostic.
Le principal risque est l’évolution, plus ou moins rapide, vers une insuffisance
rénale terminale. La vitesse de la dégradation de la fonction rénale sera
d’autant plus rapide que la pression artérielle est élevée.
Traitement.
Le seul traitement est préventif par l’équilibration optimale du diabète et le contrôle de la pression artérielle.
Prévention et éducation.
Dès que l’insuffisance rénale est patente, il faut proscrire les médicaments et
les associations médicamenteuses potentiellement néphrotoxiques. Les biguanides
(Glucophagé , Metformine, Glucinan®, Sragid®) ne doivent pas être utilisés du
fait du risque d’acidose lactique.
1723. NÉPHROPATHIE ENDÉMIQUE DES BALKANS Affection rénale due à une intoxication
par une toxine produite par des moisissures développées sur des grains de
céréale lors de leur stockage. Elle sévit dans certaines localités situées le
long du Danube, entre les Carpathes et les Balkans. Elle évolue lentement vers
une insuffisance rénale.
1724. NÉPHROPATHIE A IGA ou (-) BERGER (MALADIE DE)
1725. NÉPHROPATHIE À LÉSIONS GLOMÉRULAIRES MINIMES ou (>’) NÉPHROSE LIPOÏDIQUE.
1726. NÉPHROPATHIE TUBULO-INTERSTITIELLE AIGUË.
Définition et causes.
Atteinte rénale caractérisée par une insuffisance rénale aiguë et des lésions de
l’interstitium et des tubules rénaux. Les différentes causes sont un état de
choc, une pyélonéphrite aiguë, un médicament ou un toxique (antibiotiques,
anticancéreux…), une rhabdomyolyse (destruction musculaire, le plus souvent
par compression prolongée), une hémolyse (destruction des globules rouges).
Epidémiologie.
Les néphropathies tubulo-interstitielles aiguës représentent une des principales
causes d’insuffisance rénale aiguë.
Signes et symptômes.
Le tableau clinique est très variable en fonction de la cause et aucun signe
d’est spécifique.
Investigations.
Les examens biologiques mettent en évidence une insuffisance rénale aiguë. Les
différents examens dépendent de la cause suspectée: examen cytobactériologique
des urines, échographie, biopsie rénale…
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait en général vers une récupération d’une fonction rénale
satisfaisante en quelques semaines. Dans certains cas, une insuffisance rénale
chronique peut s’installer.
Traitement.
Le traitement associe celui de la cause à une épuration rénale extracorporelle
transitoire.
Prévention.
La prévention nécessite notamment une prise en charge précoce des états de choc
et une utilisation adaptée des médicaments toxiques pour le rein.
1727. NÉPHROPATHIE TUBULO-INTERSTITIELLE CHRONIQUE.
Définition et causes.
Appellation qui regroupe toutes les maladies rénales qui atteignent de façon
prédominante le tissu interstitiel et les tubules rénaux. Les causes peuvent
être séparées en deux groupes: les pyélonéphrites chroniques conséquence d’une
obstruction chroniques des voies urinaires, et les atteintes non obstructives :
abus d’analgésiques, affection métabolique entraînant des dépôts au niveau du
rein (oxalose, goutte, hypercalcémies et hyper-calciuries de causes
diverses…), origine toxique (chimiothérapie, sels de lithium…), origine
immunohématologique (sarcoïdose, leucémie, myélome multiple…).
Signes et symptômes.
Il n’existe le plus souvent aucun symptôme spécifique.
Investigations.
La protéinurie est faible et il existe une leucocyturie et un défaut de
concentration des urines. L’échographie est l’examen fondamental, révèle des
reins de petite taille et permet surtout de détecter une éventuelle dilatation
des cavités rénales. L’urographie intraveineuse et le scanner complètent le
bilan.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait vers une insuffisance rénale chronique avec une polyurie
(augmentation de la quantité d’urine).
Traitement.
Le traitement de la cause peut entraîner une stabilisation de l’insuffisance
rénale. En revanche, une infection ou l’hypertension artérielle peuvent
détériorer la fonction rénale.
1728. NÉPHROSE LIPOÏDIQUE .
Définition et causes.
Maladie rénale caractérisé par un syndrome néphrotique (4) primitif. Elle est
due à une augmentation de la perméabilité glomérulaire aux protéines dont la
cause est inconnue. Elle porte aussi le nom de néphropathie à lésions
glomérulaires minimes du fait de la pauvreté des atteintes décelables sur le
tissu prélevé par biopsie.
Epidémiologie.
Il s’agit de la forme la plus fréquente du syndrome néphrotique de l’enfant qui
s’observe entre 1 an et demi et 4 ans (90 % des cas). En revanche, la néphrose
lipoïdique ne représente que 15 % des cas des syndromes néphrotiques de
l’adulte.
Signes et symptômes.
Le signe principal est l’apparition d’œdèmes – blancs, mous, infiltrant les
tissus, en particulier les paupières au réveil – se traduisant par une prise de
poids significative. Des épanchements pleuraux, une ascite peuvent également
êtres présents.
Investigations.
Le diagnostic est obtenu en évaluant la protidémie (avec une électrophorèse et
un dosage de l’albuminémie) et la protéinurie des 24 heures. Une hyperlipidémie
est également fréquente. La biopsie rénale (qui n’est pas systématique chez
l’enfant) identifie les lésions rénales responsables.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic est bon sous traitement chez l’enfant (moins de 1 % d’évolution
vers l’insuffisance rénale). Des rechutes sont possibles avec la possibilité
d’apparition d’une corticorésistance. Les principales complications sont des
crises douloureuses abdominales, des thromboses veineuses ou artérielles et une
sensibilité accrue aux infections.
Traitement.
La corticothérapie est le traitement de choix. En cas d’échec, le
cyclophosphamide et la ciclosporine A peuvent être utilisés. Les mesures
complémentaires comprennent le repos au lit, un régime désodé, éventuellement
des anticoagulants et parfois la perfusion d’albumine associée à des
diurétiques.
Prévention
Les vaccins non inactivés ne sont autorisés qu’après une rémission complète de 3
à 6 mois.
1729. NEPHROSIALIDOSE Maladie héréditaire, de transmission autosomique
récessive, du groupe des mucolipidoses (>). Elle est due au déficit d’un enzyme
intervenant dans le métabolisme des oligosaccharides qui se traduit par
l’accumulation de produits dans les tissus, à l’origine de la symptomatologie
clinique. Elle se manifeste chez l’enfant par une insuffisance rénale
progressive. Les autres signes sont des malformations faciales, un retard
psychomoteur, des anomalies oculaires, une hépatosplénomégalie et des lésions
squelettiques. Le déficit enzymatique est mis en évidence sur les leucocytes et
les fibroblastes. Le décès survient en général avant 5 ans.
1730. NERDS SYNDROME Acronyme anglais pour nodes, eosinophilia, rheumatism,
dermatitis, swelling. Il s’agit d’un syndrome associant des nodules
articulaires, une hyperéosinophilie, des rhumatismes, une dermatite et des
oedèmes sous-cutanés.
1731. NÉSIDIOBLASTOME Tumeur du pancréas sécrétant de l’insuline. Il s’agit
d’une forme particulière d’insulinome (4) qui est responsable d’une hypoglycémie
sévère dans la période néonatale. Le traitement utilise des perfusions de glucose, le diazoxide (Diamox®) et, en cas d’échec, une résection partielle du pancréas.
1732. NÉTHERTON-COMEL (SYNDROME DE) Maladie héréditaire, de transmission
autosomique récessive, associant une anomalie des cheveux et des poils (cheveux
en bambou ou trichorrhexis invaginata) avec des troubles sévères de leur
croissance, une sécheresse de la peau recouverte de squames comme des écailles
de poisson (ichtyose) et une allergie à certains aliments.
1733. NEURINOME DE L’ACOUSTIQUE
Définition et causes.
Tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann (cellules produisant la
myéline autour du nerf) entourant le nerf auditif. Elle peut siéger soit dans le
conduit auditif interne, soit s’étendre de ce dernier vers l’angle ponto
cérébelleux.
Epidémiologie.
Fréquente (représente 7 % des tumeurs intracrâniennes). Elle survient à tout
âge, mais surtout entre 40 et 60 ans.
Signes et symptômes.
Les premiers signes sont une surdité unilatérale et des acouphènes
(bourdonnements, sifflements…). Le patient se plaint également
d’étourdissements et d’instabilité, plutôt que de vertiges vrais.
Investigations.
Le bilan audiologique comprend les épreuves vestibulaires et les potentiels
évoqués auditifs. L’IRM au gadolinium est l’examen de choix pour assurer le
diagnostic, même précoce.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont des séquelles au niveau de l’audition et des
atteintes du nerf facial.
Traitement.
Les techniques d’exérèse chirurgicale utilisent des monitorings auditifs et du
nerf facial pour limiter au maximum les séquelles.
1734. NEUROBLASTOME ou SYMPATHOBLASTOME.
Définition et causes.
Tumeur d’origine embryonnaire, se développant principalement au niveau de la
glande surrénale mais qui peut se situer à n’importe quel niveau de la chaîne
sympathique latérovertébrale (abdomen et thorax).
Epidémiologie.
Près des trois quarts des tumeurs sont diagnostiquées chez des enfants de moins
de 5 ans.
Signes et symptômes.
Les signes dépendent de la localisation initiale et du stade de la maladie. Le
tableau initial peut être une masse abdominale palpable ou des signes de lésion
métastatique du foie, des poumons ou des os.
Investigations.
L’échographie et le scanner permettent de repérer la tumeur. Le taux d’acide
vanylmandélique (VMA) urinaire est élevé chez la majorité des patients.
Evolution, complications et pronostic.
Les métastases sont fréquentes et souvent à l’origine de la découverte de la
tumeur. L’atteinte des os et de la moelle peut entraîner une anémie, une
thrombopénie et une leucopénie. La mortalité est importante. Plus l’enfant est
jeune, meilleur semble être le pronostic (en partie, car la maladie est moins
disséminée).
Traitement .
Suivant le stade, on utilise, seule ou en association, la chirurgie, la
chimiothérapie et la radiothérapie.
1735. NEUROFIBROMATOSE DE TYPE 1 ou MALADIE DE VON RECKLINGHAUSEN.
Définition et causes.
Maladie génétique du groupe des phacomatoses (>), de transmission autosomique
dominante, à forte pénétrance et à expression clinique extrêmement variable.
Epidémiologie.
L’incidence est de 1/3 000 avec un taux de mutation très élevé (30 à 50 % des
personnes sont atteintes par une nouvelle mutation).
Signes et symptômes.
Un tiers des patients sont asymptomatiques. Un tiers des patients présentent des
taches «café au lait» avec des tumeurs cutanées multiples pouvant donner des
déformations grotesques, une atteinte ophtalmologique et des anomalies osseuses.
Enfin, chez un tiers des patients, l’atteinte neurologique prédomine avec des
neurofibromes touchant les racines rachidiennes, les nerfs périphériques et les
nerfs crâniens associés à des tumeurs intracérébrales.
Investigations.
IRM cérébrale.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic est lié à la gravité des atteintes neurologiques.
Traitement.
L’exérèse chirurgicale et l’irradiation des tumeurs sont indiquées lorsqu’elles
sont sévèrement symptomatiques, mais au prix de séquelles dues au sacrifice de
la fonction du nerf atteint.
Prévention.
Le conseil génétique est recommandé.
1736. NEUROFIBROMATOSE DE TYPE 2 ou NEUROFIBROMATOSE ACOUSTIQUE BILATÉRALE.
Définition et causes.
Maladie génétique du groupe des phacomatoses (>), de transmission autosomique
dominante, caractérisée par le développement de neurinomes de l’acoustique,
souvent de manière bilatérale.
Epidémiologie.
L’incidence est de 1/50000 avec de nombreux cas sporadiques. L’âge de survenue
est de 20 à 30 ans.
Signes et symptômes.
Association d’une hypoacousie, d’un syndrome de l’angle ponto cérébelleux
(bourdonnements d’oreille, troubles de l’équilibre) et d’une hypertension
intracrânienne, soit bilatérale d’emblée, soit d’un côté puis de l’autre.
Investigations.
Elles comprennent le scanner et l’IRM.
Evolution, complications et pronostic.
Il existe un risque de surdité bilatérale et de tumeurs intracérébrales
associées (méningiomes ou astrocytomes).
Traitement.
L’exérèse chirurgicale est indiquée si les neurinomes sont invalidants et
évolutifs.
Prévention
Le conseil génétique est recommandé.
1737. NEUROLEPTIQUES (SYNDROME MALIN DES) (>) SYNDROME MALIN DES NEUROLEPTIQUES.
1738. NEUROPATHIE diabétique.
Définition et causes.
Atteinte soit du système nerveux végétatif, soit du système nerveux périphérique (polynévrite) dans le cadre du diabète sucré. Les causes restent discutées : atteinte de la vascularisation des nerfs du fait des lésions vasculaires liées
au diabète et/ou atteinte toxique (accumulation de métabolites toxiques).
Epidémiologie.
L’atteinte périphérique des membres inférieurs est la plus fréquente.
Signes et symptômes.
Les signes de début sont des fourmillements, des engourdissements au niveau des
pieds puis apparaissent des troubles de la sensibilité qui évoluent vers une
anesthésie « en botte ». L’atteinte végétative survient chez un patient ayant
une atteinte périphérique et est responsable de troubles digestifs, une
hypotension orthostatique (au passage à la position debout), des troubles de
l’érection et une atteinte cardiaque (tachycardie plus ou moins permanente).
Investigations.
Le diagnostic est clinique.
Evolution, complications et pronostic.
La neuropathie périphérique fait le lit des maux perforants plantaires et des
lésions ischémiques ou infectieuses des orteils, qui peuvent conduire à des
amputations répétées.
Traitement.
L’essentiel du traitement repose sur la prévention des complications. En cas de
douleur, on utilisera largement les antalgiques.
Prévention et éducation.
La neuropathie périphérique doit être dépistée au moins une fois par an avec une
étude soigneuse de la sensibilité. Le patient, informé du risque des
complications des atteintes des pieds, apprend les règles spécifiques des soins
de pied et de leur surveillance.
1739. NEUROPATHIE TOMACULAIRE. Neuropathie héréditaire, de transmission
autosomique dominante, également appelée neuropathie héréditaire
d’hypersensibilité à la pression. La maladie se déclare en général après l’âge
de 20 ans, sous la forme d’accès de paralysies et de paresthésies dans les
territoires de troncs nerveux bien définis. Les signes régressent le plus
souvent, mais les rechutes sont fréquentes. La biopsie nerveuse montre un
épaississement caractéristique de la myéline en forme de saucisse (tomaculum =
saucisson).
1740. NEUTROPÉNIE CYCLIQUE. Maladie hématologique de survenue sporadique ou
familiale (dans ce cas de transmission souvent autosomique dominante)
caractérisée par des poussées fébriles périodiques (cycle de 21 jours) associées
à une neutropénie. On observe également des aphtes multiples, au niveau de la
bouche et du pharynx, qui sont souvent douloureux. Les principales complications
sont des infections cutanées et pulmonaires. Le pronostic d’ensemble reste
habituellement bénin. Le traitement fait appel aux corticoïdes lors des épisodes
de neutropénie, voire aux facteurs de croissance des granulocytes dans les cas
plus sévères ou en cas de rechutes rapprochées.
1741. NÉVRALGIE CERVICOBRACHIALE
Définitions et causes.
Syndrome douloureux dû à la souffrance d’une racine nerveuse intéressant le cou
et le membre supérieur. Les principales causes sont l’arthrose cervicale, le
syndrome du défilé thoracique (>), une tumeur (vertébrale, du sommet du poumon,
d’une racine nerveuse = neurinome), une infection (spondylodiscite).
Epidémiologie.
Très fréquente. Les formes dues à l’arthrose cervicale touchent les adultes à
partir de la quarantaine avec une prédominance féminine. ^
Signes et symptômes.
Il existe une douleur cervicale qui irradie vers le bras et qui est souvent
augmentée la nuit. Le trajet sur le bras permet d’identifier la racine en cause.
Des troubles sensitifs et des réflexes peuvent être associés. Le rachis cervical
est raide, douloureux.
Investigations.
La radiographie du rachis cervical est l’examen de base (elle peut être
complétée par un scanner ou une IRM). Puis le bilan est orienté en fonction de
l’origine supposée.
Evolution, complications et pronostic.
Dans la forme arthrosique, l’évolution est cyclique et la guérison le plus
souvent spontanée. Dans l’autre cas, le pronostic dépend de la cause.
Traitement.
En cas d’arthrose, le traitement comprend des antalgiques, des
anti-inflammatoires non stéroïdiens et de corticoïdes avec, souvent, le port
d’un collier cervical. Dans les rares cas où le traitement médical est
inefficace, la chirurgie peut permettre de libérer la racine nerveuse qui
souffre.
1742. NÉVRALGIE FACIALE ESSENTIELLE (>) NÉVRALGIE DU TRIJUMEAU.
1743. NÉVRALGIE FÉMOROCUTANÉE ou (>) MÉRALGIE PARESTHÉSIQUE.
1744. NÉVRALGIE DU GLOSSOPHARYNGIEN.
Définition et causes.
Crises récidivantes de douleurs siégeant dans le territoire du nerf
glossopharyngien (partie postérieure du pharynx, amygdale, dos de la langue et
oreille moyenne). La cause est inconnue.
Epidémiologie.
Rare. Touche principalement les hommes après 40 ans.
Signes et symptômes.
Il s’agit de crises brèves (de quelques secondes à quelques minutes) de douleurs
intenses, déchirantes qui surviennent spontanément ou à l’occasion d’un
mouvement (mastication, déglutition, éternuement…). La douleur est
unilatérale, débute en général à la base de la langue ou au niveau de l’amygdale
et peut irradier à l’oreille.
Investigations.
Le diagnostic est essentiellement clinique.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont une hypotension, une bradycardie et une
syncope dues à une augmentation de l’activité du nerf pneumogastrique.
Traitement.
La carbamazépine ou la phénytoïne sont les médicaments de choix. En cas d’échec,
la section du nerf constitue le traitement définitif.
Névralgie intercostale.
Douleur qui part du dos et suit un trajet costal en allant jusqu’à la poitrine.
Les principales causes sont des séquelles de fracture de côtes ou de pleurésie,
un tassement vertébral, un zona, une tumeur thoracique ou rachidienne, un
myélome…
1745. NÉVRALGIE DU TRIJUMEAU ou NÉVRALGIE FACIALE ESSENTIELLE.
Définition et causes.
Douleurs paroxystiques siégeant dans le territoire d’une ou de plusieurs
branches du nerf trijumeau. La névralgie est soit essentielle, sans cause
décelable, soit symptomatique d’une autre affection neurologique ou d’une
maladie de système.
Epidémiologie.
C’est une affection rare avec 5 nouveaux cas par an pour 100000 habitants et une
légère prédominance féminine. La maladie apparaît le plus souvent après 65 ans.
Signes et symptômes.
Dans la forme essentielle, la douleur est très violente à type de décharge
électrique survenant par accès entrecoupés de rémissions complètes. La douleur
apparaît après stimulation d’une zone cutanée bien précise chez chaque patient:
la « zone gâchette». Le territoire le plus fréquemment touché est celui du
maxillaire supérieur. L’examen neurologique est normal. La forme symptomatique
s’oppose point par point à la forme essentielle: la douleur est durable sans
zone gâchette et est associée à un déficit sensitif ou moteur.
Investigations.
Elles ne sont utiles que dans la forme symptomatique.
Evolution, complications et pronostic.
Dans la forme essentielle, les douleurs peuvent être très invalidantes.
Traitement.
Dans la forme essentielle, la cabamazépine ou, en cas d’échec, le clonazépam ou
le baclofene donnent de bons résultats. En cas d’échec, la thermocoagulation du
ganglion de Gasser est indiquée. Dans la forme symptomatique, il faut traiter la
cause. L’amélioration sous carbamazépine est un test quasi diagnostique de la
névralgie essentielle.
1746. NÉVRITE HYPERTROPHIQUE PROGRESSIVE FAMILIALE.
Affection neurologique héréditaire, de transmission autosomique dominante,
caractérisée par une inflammation des nerfs périphériques et des racines de ces
nerfs avec une hypertrophie de la gaine de Schwann. Elle débute dans l’enfance
et se manifeste par une paralysie avec une amyotrophie des membres inférieurs.
L’aggravation est très lente.
1747. NÉVRITE OPTIQUE RÉTROBULBAIRE.
Définition Et Causes
Inflammation, habituellement unilatérale, de la portion orbitaire du nerf
optique. La sclérose en plaques et les causes toxiques (alcoolisme, éthambutol =
antituberculeux…) sont au premier plan. On peut également retrouver une
origine infectieuse virale ou bactérienne, ou une maladie inflammatoire
(sarcoïdose, lupus…).
Epidémiologie.
Elle touche principalement les femmes entre 18 et 45 ans.
Signes Et Symptômes.
Les principaux symptômes sont l’apparition rapide d’un déficit visuel et de
douleurs lors des mouvements de l’œil.
Investigations.
Outre les examens ophtalmologiques, le bilan comprend une IRM et une ponction
lombaire pour rechercher des signes en faveur d’une sclérose en plaques.
Evolution, Complications Et Pronostic.
L’évolution se fait vers une récupération du déficit visuel en quelques
semaines. Des rechutes peuvent survenir, surtout au cours de la sclérose en
plaques, qui augmentent à chaque fois le risque de séquelles (au stade ultime,
cécité définitive).
Traitement.
Il comprend un traitement corticoïde qui accélère la récupération visuelle et la
suppression de la cause éventuelle (toxique, infection…).
1748. NÉVRITE VESTIBULAIRE.
Définition Et Causes.
Atteinte inflammatoire aiguë du vestibule qui se manifeste par un grand vertige
d’installation brutale. Une cause est virale est supposée mais non prouvée.
Epidémiologie.
Cause rare de vertige (1 à 2 %). Touche tous les âges avec une prédominance
entre 30 et 40 ans.
Signes Et Symptômes.
La forme classique se manifeste par un grand vertige périphérique (4)
d’apparition brutale, accompagné de nausées et de vomissements, imposant en
général la position couchée stricte. Il existe un nystagmus (oscillation
involontaire des yeux en deux secousses, une lente et une rapide qui définit la
direction du nystagmus) franc battant du côté lésé.
Investigations.
Le bilan comprend des épreuves caloriques vestibulaires, un audiogramme, un
enregistrement des potentiels évoqués auditifs et une IRM, principalement pour
éliminer une autre cause.
Evolution, Complications Et Pronostic.
L’évolution est favorable en quelques jours à quelques semaines (au bout de
quelques jours, le malade peut se lever). Le pronostic est bénin bien qu’il
persiste assez souvent des troubles modérés à type de vertige positionnel ou
d’un trouble de l’équilibre lors de mouvements brusques. Des récidives sont
possibles dans 10 % des cas.
Traitement.
La prise en en charge de la crise associe repos au lit, antivertigineux et
antiémétiques par voie intraveineuse. Le lever précoce est fondamental pour
favoriser une récupération rapide.
1749. NÉVROSE HYSTÉRIQUE ou (>) HYSTÉRIE.
(obsessions) et d’impulsions avec des actes répétitifs (compulsions), qui
s’imposent au patient et sont vécus comme absurdes, inacceptables et non
désirés.
Epidémiologie.
Il s’agit d’un trouble relativement fréquent, avec une prévalence sur la vie
entière estimée entre 2 et 3 % de la population générale.
Signes et symptômes.
La plupart du temps, le début est progressif et le trouble se constitue sur
plusieurs années. Les obsessions peuvent être idéatives (folie du doute),
phobiques (craintes obsédantes), impulsives (acte ridicule, immoral ou
répréhensible que le sujet craint d’être amené à réaliser contre sa volonté) et
entraînent une lutte anxieuse importante. Les thèmes les plus fréquents sont
religieux, philosophiques, de propreté, de contamination, d’agression,
d’exactitude, d’ordre, sexuels, de crainte des maladies, de mort. Les
compulsions et les rites suivent des règles très strictes et, parfois, très
stéréotypées (vérifications, lavage des mains, comptage, collectionnisme, besoin
de symétrie, de mettre de l’ordre…).
Evolution, complications et pronostic.
Elle débute habituellement vers la puberté. L’évolution se fait par poussées
avec soit une exacerbation des obsessions, soit l’apparition de symptômes
dépressifs. Les formes graves sont socialement invalidantes.
Traitement.
Le traitement utilise les antidépresseurs (effet « anti-obsessionnel ») et les
anxiolytiques associés à une psychanalyse ou à des thérapies comportementales,
surtout lorsque les rituels sont prépondérants.
1751. NÉVROSE PHOBIQUE.
Définition et causes.
Crainte soudaine, irrationnelle, liée à la menace du surgissement d’un objet ou
d’une situation affectivement chargée d’angoisse. Les plus fréquentes sont
l’agoraphobie (peur des espaces : transport en commun, lieux publics…), les
phobies sociales (parler en public, manger face à quelqu’un, être incapable de
répondre à des questions…) et les phobies simples (vue du sang, dentiste,
ascenseur…).
Epidémiologie.
Elles sont très fréquentes (5 à 10 % de la population), avec une nette
prédominance féminine.
Signes et symptômes.
Il existe des crises d’attaque de panique, une anxiété anticipatrice (peur
d’être exposé à la situation), une diminution de l’estime de soi et une peur de
la critique. Le caractère est dominé par l’inhibition et la passivité.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont le handicap social, un syndrome dépressif
avec des conduites suicidaires et l’abus d’alcool et de médicaments.
Traitement.
Il associe la psychothérapie, les antidépresseurs et les anxiolytiques.
1752. NÉVROSE POST-TRAUMATIQUE.
Définition et causes.
Troubles présentés par des victimes de traumatismes psychologiques graves
(guerre, catastrophe naturelle, attentat…) qui apparaissent après un temps de
latence variable, de quelques heures à plusieurs mois. Une blessure augmente la
fréquence de la névrose post-traumatique.
Epidémiologie.
Très fréquente.
Signes et symptômes.
Les signes spécifiques sont un débordement émotionnel (accès de tremblements,
crises de larmes, d’agitation, voire décharges agressives), une apathie et une
asthénie (désintérêt pouvant aller jusqu’à l’apathie), des phénomènes de
répétition (ruminations, crises de colère, cauchemars à répétition…). Le plus
souvent ces symptômes s’atténuent et sont remplacés par des troubles
fonctionnels variés (douleur, oppression thoracique, signes digestifs…) qui
sont, en fait, une expression de l’anxiété du patient.
Evolution, complications et pronostic.
Lorsque le traitement est mis en œuvre rapidement, la guérison est la règle. En
l’absence ou en cas de retard de traitement, l’évolution se fait vers la
chronicité, avec une association fréquente à un alcoolisme et à des dépressions
majeures.
Traitement.
Il associe une prise en charge psychologique précoce, permettant notamment de
verbaliser ce qui s’est passé, et un traitement médicamenteux psychologique. Une
fois les troubles constitués, une psychothérapie est nécessaire.
Prévention.
La mise en place d’unités médico-psychologiques intervenant sur les lieux mêmes
de l’événement a permis d’assurer un accompagnement efficace immédiat.
1753. NÉZELOF (SYNDROME DE). Déficit congénital, souvent héréditaire, de
l’immunité cellulaire. Le taux de lymphocytes est très diminué et le thymus est
absent ou atrophié. Dès les premiers mois, les nourrissons présentent des
infections multiples avec une évolution vers la mort avant l’âge de 2 ans en
l’absence de traitement. La greffe de moelle osseuse permet la guérison.
1754. NICOLAS-FAVRE (MALADIE DE)ou LYMPHOGRANULOMATOSE VÉNÉRIENNE.
Définition et causes.
Maladie sexuellement transmissible due à certains types de Clamydia trachomatis.
Elle est caractérisée par une lésion initiale transitoire suivie d’une
lymphangite suppurée et de graves complications locales. L’incubation varie de 3
jours à 3 semaines.
Epidémiologie.
Elle est ubiquitaire mais particulièrement fréquente dans les zones tropicales.
Signes et symptômes.
La lésion primaire se présente comme une petite ulcération indolore et
transitoire du gland ou des parois vaginales qui passe très souvent inaperçue.
La lésion secondaire est une adénite inguinale unilatérale (bubon), douloureuse
qui se fistulise à la peau.
Investigations.
L’isolement de Chlamydia s’effectue à partir du pus d’aspiration d’un bubon.
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement, l’évolution se fait vers des anorectites végétantes
ou sténosantes, des fistules rectovaginales et un éléphantiasis génital.
Traitement.
Les cyclines (ou l’érythromycine) sont efficaces. Les bubons fluctuants seront
ponctionnés et les abcès et fistules bénéficieront de la chirurgie.
Prévention et éducation
L’examen des partenaires sexuels et la surveillance du patient pendant 6 mois
après un succès thérapeutique apparent sont indispensables.
1755. NIEMANN-PICK (MALADIE DE) .
Définition et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique récessive, faisant partie du
groupe des mucolipidoses (>). Elle est caractérisée par une accumulation de
sphingomyéline dans les cellules réticulo-endothéliales du fait d’un déficit
enzymatique.
Epidémiologie.
Les formes infantiles et juvéniles sont plus fréquentes dans les familles
d’origine du Moyen Orient.
Signes et symptômes.
On décrit plusieurs types (A, B, C) dont l’âge de début varie de la naissance à
l’âge adulte. Les signes les plus fréquents sont un gros ventre, une
hépatosplénomégalie, une pneumopathie interstitielle et des atteintes
neurologiques avec un retard mental (sauf dans le type B).
Investigations.
La biopsie tissulaire et le dosage enzymatique en sphingomyélinase permettent le
diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic est sévère dans les types A et B avec un décès dans l’enfance ou à
l’adolescence. Dans le type B, l’évolution est plus lente.
Traitement.
Il est uniquement symptomatique.
Prévention.
Le diagnostic prénatal est possible sur un prélèvement d’amniocytes ou de
villosités choriales.
1756. NISHIMOTO (MALADIE DE) ou (>) MOYA-MOYA NOACK (SYNDROME DE). Syndrome
malformatif héréditaire, de transmission autosomique dominante, associant une
malformation de la tête (aplatie d’avant en arrière et très développée en
hauteur), des anomalies de la face et une soudure des doigts et des orteils
(syndactylie).
1757. NOCARDIOSE.
Définition et causes.
Maladie infectieuse due à un germe, Nocardia asteroides, que l’on retrouve
communément dans le sol. La contamination se fait habituellement par voie
pulmonaire, plus rarement par voie digestive ou cutanée.
Epidémiologie.
Elle est rare et se rencontre plus particulièrement chez les adultes de sexe
masculin. Les sujets affaiblis ou immunodéprimés sont plus exposés mais la
moitié des patients n’ont pas d’affection préexistante.
Signes et symptômes.
La première atteinte est l’infection pulmonaire. Elle a tendance à se propager
par voie sanguine avec principalement la formation d’abcès cérébraux. Des abcès
cutanés surviennent également dans un tiers des cas.
Investigations.
Le germe peut être mis en évidence dans les crachats ou dans les prélèvements
bronchiques (brosse ou lavage bronchoalvéolaire).
Evolution, complications et pronostic.
La mortalité est élevée malgré le traitement. Les patients ayant une atteinte
pulmonaire isolée ont le meilleur pronostic.
Traitement.
L’antibiothérapie doit être prolongée (6 à 12 mois) et utilise le
triméthoprime¬sulaméthoxazole.
1758. NODULE THYROÏDIEN.
Définition et causes.
Tuméfaction localisée et arrondie du corps de la thyroïde, soit solitaire, soit
multiple, dont près de 95 % sont bénins.
Epidémiologie.
Les nodules palpables (> 8 mm) sont présents chez 3 à 4 % des individus et on
retrouve des nodules > 2 mm chez 30 à 50 % de la population.
Signes et symptômes.
La découverte est, le plus souvent, fortuite. Parfois, il existe des signes de
compression (troubles respiratoires, digestifs ou de la parole) ou des signes
évocateurs d’un cancer (flush à l’ingestion d’alcool, diarrhée…).
Investigations.
Elles comprennent un bilan thyroïdien et le dosage de la calcitonine.
L’échographie, la ponction à l’aiguille sont les examens clefs (parfois
complétés par une scintigraphie).
Evolution, complications et pronostic.
Le principal risque est celui de cancer, plus fréquent chez les hommes, les
sujets âgés et les enfants, ainsi que les patients irradiés au niveau cervical
dans leur enfance. Les complications sont l’hyperthyroïdie (nodule toxique et
goitre multinodulaire toxique) et la compression.
Traitement.
Parfois, une simple surveillance suffit. En cas de nodule unique, la ponction
évacuatrice peut être tentée, sinon le traitement repose sur la chirurgie (ou
sur l’iode radioactif en cas de nodule toxique chez le sujet âgé).
Prévention et éducation.
La prévention des complications nécessite une surveillance clinique et
échographique régulière.
1759. NODULE DE WINCKLER. Lésion inflammatoire douloureuse, siégeant le plus
souvent au niveau du bord libre du pavillon de l’oreille. En quelque mois
apparaît un nodule de 1 à 2 cm, dur, adhérant au cartilage, bordé d’un érythème
(rougeur) inflammatoire et centré par une croûte. Le traitement initial utilise
les corticoïdes locaux (crème ou injection). En cas d’échec, la cryothérapie,
voire la chirurgie, est nécessaire.
1760. NOONAN (SYNDROME DE) . Syndrome ressemblant au syndrome de Turner (>),
avec des chromosomes sexuels normaux. La plupart des cas sont sporadiques, mais
il existe des cas familiaux. Les principaux signes sont une petite taille, un
retard mental, des anomalies de la face et du cou (plissage du cou, écartement
excessif des yeux, oreilles bas implantées), ainsi qu’une malformation cardiaque
(sténose pulmonaire).
1761. NORMAN-ROBERTS (SYNDROME DE) . Maladie génétique de transmission
autosomique récessive caractérisée par une lissencéphalie (anomalie cérébrale
caractérisée par une absence de circonvolutions) associée à des malformations du
crâne et de la face. Le retard mental est sévère avec des difficultés
d’alimentation et une activité spontanée diminuée.
1762. NORRIE (MALADIE DE) . Maladie neurologique héréditaire, de transmission
récessive liée au chromosome X, comprenant une cécité congénitale par atrophie
des globes oculaires liée à une pseudotumeur bilatérale de la rétine.
1763. NORUM (MALADIE DE) . Maladie génétique due à la déficience d’un enzyme
(LCAT = lécithine-cholestérol¬acyltransférase) intervenant dans le métabolisme
du cholestérol. Elle se manifeste par un dépôt de cholestérol dans la cornée
(signe des « yeux de poisson ») et au niveau du rein, à l’origine d’une
insuffisance rénale qui conditionne le pronostic. Une greffe de cornée peut être
nécessaire.
O
1764. OBÉSITÉ.
Définition et causes.
Accumulation excessive de masse grasse. La définition médicale arbitraire est un
dépassement de plus de 20 % de l’indice de masse corporelle (IMC ou BMI, body
mass index) ou indice de Quetelet (rapport du poids sur la taille au carré
exprimé en kg/m2), dont la normale est de 21 pour les femmes et de 23 pour les
hommes. Les causes sont multiples et intriquées: facteurs génétiques,
environnementaux, psychologiques, endocriniens, médicamenteux…
Epidémiologie.
En France, la prévalence de l’obésité est d’environ 20 %. Les femmes sont plus
touchées que les hommes. L’âge (multiplication par 2 ou plus entre 20 et 55 ans)
et les facteurs socio¬économiques (plus d’obèses chez les pauvres, à bas niveau
d’études) ont également une influence.
Signes et symptômes.
Le poids est augmenté et la surcharge graisseuse est visible, chez la femme,
surtout au niveau de la moitié inférieure du corps (répartition gynoïde), alors
que, chez les hommes, elle touche la partie supérieure du corps (répartition
androïde).
Investigations.
Le bilan biologique recherche des troubles métaboliques associés (diabète, hyperlipidémie, hyperuricémie). Les autres examens ont pour but d’apprécier le retentissement cardiovasculaire, respiratoire et rhumatologique de l’obésité.
Evolution, complications et pronostic.
L’obésité entraîne une surmortalité chez les sujets jeunes et jusqu’à 50-60 ans. Les principales complications sont cardiovasculaires (insuffisance coronaire, insuffisance cardiaque, hypertension artérielle, accidents vasculaires cérébraux, problèmes veineux), respiratoires (syndrome d’apnées du sommeil), rhumatologiques (arthrose des genoux et des hanches, lombalgies…) et métaboliques (diabète, hyperlipidémie, hyperuricémie). Les troubles psychologiques et la dépression doivent être également pris en compte, notamment
lors des traitements.
Traitement.
Le traitement est difficile et doit être individualisé. Les moyens utilisés sont
la diététique, l’exercice physique, les médicaments et la prise en charge
psychologique. Il est également possible de poser chirurgicalement des anneaux
gastriques (IMC > 40 depuis plus de 5 ans et prise en charge psychologique
obligatoire).
Prévention et éducation.
L’origine multifactorielle de l’obésité rend la prévention et l’éducation des
patients difficiles. La détection et la prise en charge des comportements
alimentaires inadaptés dès le plus jeune âge semblent être un axe de recherche
intéressant.
1765. OCCLUSION DE L’ARTÈRE CENTRALE DE LA RÉTINE.
Définition et causes.
Arrêt brutal de la circulation rétinienne due à une embolie (plaque d’athérome
carotidien, origine cardiaque) ou à une thrombose (athérosclérose, artérite
inflammatoire: Horton…), ce qui entraîne une ischémie des cellules
rétiniennes.
Epidémiologie.
C’est une affection relativement fréquente.
Signes et symptômes.
Elle se traduit par une perte brutale et le plus souvent totale de la vision
d’un œil (amaurose). La pupille est en mydriase et le réflexe photo-moteur est
aboli.
Investigations.
Le fond d’œil et l’angiographie confirment le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Elle peut être transitoire et totalement réversible. Le traitement est urgent
mais décevant: au delà de 20 minutes, les lésions des cellules rétiniennes sont
irréversibles, avec une cécité.
Traitement.
On utilise les anticoagulants (voire les thrombolytiques), les vasodilatateurs,
l’acétazolamide , voire une ponction de la chambre antérieure.
Prévention et éducation.
Un accident fugace et réversible nécessite un bilan précis afin, éventuellement,
d’éviter une récidive plus grave.
1766. OCCLUSION INTESTINALE DU CÔLON.
Définition et causes.
Arrêt plus ou moins complet du transit intestinal. Les causes les plus fréquents
sont mécaniques, soit par obstruction (cancer dans 80 % des cas, sigmoïdite,
fécalome), soit par strangulation (volvulus ou torsion du côlon pelvien). Les
causes fonctionnelles sont plus rares (maladie de Crohn, rectocolite
hémorragique, médicaments).
Epidémiologie.
Il s’agit d’une des principales urgences abdominales. Les occlusions coliques
représentent 20 % de l’ensemble des occlusions.
Signes et symptômes.
Les signes sont d’apparition plus lente que dans l’occlusion du grêle. Il existe
une constipation croissante, aboutissant à un arrêt des matières et des gaz, des
douleurs, avec une distension abdominale, et, parfois, des vomissements, qui
peuvent cependant manquer. Une masse abdominale peut être palpable.
Investigations.
La radiographie d’abdomen sans préparation (de face et debout) montre des
niveaux hydroaétiques, plus hauts que larges, en cadre et périphériques. Le
lavement aux hydrosolubles permet de préciser le siège de la sténose colique.
Evolution, complications et pronostic.
La stase liquidienne dans le tube digestif est à l’origine d’une déshydratation
et d’une pullulation microbienne. Il existe un risque d’ischémie, de perforation
et de choc septique en cas de retard au traitement.
Traitement.
En l’absence de signes de gravité, un traitement médical est commencé, avec une
aspiration digestive, une correction des troubles hydroélectrolytiques, une
antibiothérapie et des antalgiques. Lorsque la distension colique est majeure,
l’intervention chirurgicale s’impose d’emblée (résection-anastomose ou
colostomie).
1767. OCCLUSION INTESTINALE DU GRÊLE.
Définition et causes.
Arrêt plus ou moins complet du transit intestinal. On distingue l’occlusion
mécanique et l’occlusion fonctionnelle ou iléus paralytique (4). Les causes de
l’obstruction mécanique sont une obstruction – due à des brides, des adhérences
ou à une tumeur – ou une strangulation par étranglement d’une hernie, volvulus
(torsion sur elle-même) d’une anse intestinale ou à une invagination
(principalement chez l’enfant de 8 à 12 mois).
Epidémiologie.
Il s’agit d’une des principales urgences abdominales. Les occlusions du grêle
représentent 70 à 80 % de l’ensemble des occlusions.
Signes et symptômes.
Les trois symptômes qui signent le diagnostic sont les crampes abdominales, les
vomissements et l’arrêt des matières et des gaz. En cas d’étranglement,
l’abdomen et douloureux et une masse peut être palpable. L’existence d’une
cicatrice abdominale oriente vers une obstruction par brides ou adhérences.
Investigations.
La radiographie d’abdomen sans préparation de face, debout et centrée sur les
coupoles (ou en décubitus latéral) qui met en évidence des opacités surmontée
d’une clarté (niveaux hydroaériques) fait le diagnostic. Le scanner peut être un
complément utile.
Evolution, complications et pronostic .
La principale complication est l’ischémie du grêle (arrêt de la vascularisation
par torsion des vaisseaux) avec, de manière secondaire, une perforation, une
péritonite et un choc septique. La stase liquidienne dans le tube digestif est à
l’origine d’une déshydratation et d’une pullulation microbienne.
Traitement.
Le traitement médical initial associe des antalgiques antispasmodiques, une
rééquilibration hydroélectrolytique, une aspiration digestive et une éventuelle
antibiothérapie. Le traitement chirurgical ne doit pas être retardé, notamment
en cas de strangulation.
1768. OCCLUSION DE LA VEINE CENTRALE DE LA RÉTINE.
Définition et causes.
Arrêt du retour veineux de la rétine survenant chez des patients présentant des
facteurs de risque de l’athérosclérose, une hyperviscosité sanguine ou une
maladie systémique (sarcoïdose, Behçet…).
Epidémiologie.
C’est une affection relativement fréquente, survenant entre 50 et 70 ans.
Signes et symptômes.
La baisse de l’acuité visuelle est, en général, modérée et progressive, avec un
brouillard visuel (impression de pluie de suie).
Investigations.
Le fond d’oeil et l’angiographie permettent le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement est souvent décevant, avec des séquelles importantes pouvant aller
jusqu’à la cécité.
Traitement.
On utilise les anticoagulants, les fibrinolytiques, les antiagrégants
plaquettaires et l’hémodilution.
Prévention.
Après un premier épisode partiel, le laser est utile sur les zones atteintes
pour éviter l’installation d’un glaucome par développement de néovaisseaux.
1769. OCHRONOSE ou (>) ALCAPTONURIE.
1770. OCKELKO (MALADIE D’) . Maladie due au virus Sindbis du groupe des
arboviroses, transmise par un moustique, que l’on appelle maladie d’Obelko en
Suède, fièvre de Carélie en Russie et maladie de Pogosta en Finlande. Elle
associe une fièvre peu élevée, des douleurs musculaires et articulaires, une
éruption maculopapuleuse sur le tronc et les extrémités. Le traitement est
symptomatique. Des douleurs articulaires résiduelles peuvent persister pendant
deux ans.
1771. OEDÈME AIGU DU POUMON .
Définition et causes.
Insuffisance cardiaque gauche aiguë caractérisée par une inondation des alvéoles
pulmonaires par le plasma en excès qui ne peut revenir assez rapidement vers le
coeur du fait de son incapacité à pomper suffisamment. Les principaux facteurs
déclenchants sont: un écart du régime sans sel, une poussée hypertensive, un
trouble du rythme, un infarctus, un arrêt du traitement ou une pathologie aiguë
associée. Remarque : l’œdème peut également être lésionnel par lésion de la
membrane alvéolocapillaire par un toxique (oxyde de carbone, héroïne, gaz
irritants), une infection, une noyade, ou une inhalation de liquide gastrique.
Epidémiologie.
Sa fréquence est en relation avec celle de l’insuffisance cardiaque chronique,
en particulier chez le sujet âgé.
Signes et symptômes. Détresse respiratoire avec polypnée, cyanose, sueurs,
grésillement laryngé et crachats
mousseux, rosés chez un malade assis qui ne peut supporter la position allongée.
L’auscultation pulmonaire retrouve des râles crépitants dans les deux poumons.
Investigations.
Elles comprennent une radiographie pulmonaire, un électrocardiogramme, le dosage
des enzymes cardiaques et des gaz du sang, mais elles ne doivent pas retarder la
mise en route du traitement.
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement, le décès par asphyxie est rapide. Un traitement
énergique permet, en général, une évolution favorable rapide.
Traitement.
Il repose sur l’oxygène à fort débit, les diurétiques, les dérivés nitrés et le
traitement du facteur déclenchant. La ventilation spontanée en pression positive
(VS-PEEP ou CPAP) est également efficace. En cas d’aggravation, on utilise les
agents isotropes positifs (dobutamine, dopamine) et, éventuellement, la
ventilation assistée.
Prévention et éducation.
L’éducation du patient insiste sur le respect des règles hygiénodiététiques, le
bon suivi du traitement médicamenteux cardio-vasculaire, l’évaluation de la
dyspnée.
1772. ŒDÈME ANGIONEUROTIQUE HÉRÉDITAIRE.
Définition et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique dominante (des mutations sont
également possibles). Elle est due à un déficit en une enzyme hépatique qui
intervient dans le système du complément et de la coagulation, ce qui entraîne
un œdème touchant différents tissus. Des traumatismes divers sont les facteurs
déclenchants des manifestations diniques.
Epidémiologie.
La prévalence est de 1/50000, avec un début d’expression clinique le plus
souvent dans l’enfance.
Signes et symptômes.
Association d’œdèmes touchant les extrémités, le visage, les tissus sous-cutanés
et les viscères, progressivement croissants en 24 à 36 heures puis régressant en
un à trois jours. L’atteinte digestive se manifeste par des douleurs
abdominales, de la diarrhée et des vomissements. L’atteinte pulmonaire se
caractérise par un œdème laryngé, l’atteinte neurologique par des céphalées, des
troubles moteurs et des crises convulsives.
Investigations.
Le diagnostic repose sur l’étude du profil du complément.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement préventif a fait disparaître la mortalité. L’évolution se fait
sous la forme de crises d’intensité, de fréquence et de topographie variables.
Les principales complications sont la détresse respiratoire et l’état de choc
(hypovolémie due à la diarrhée).
Traitement.
Le traitement préventif est fondé sur les stéroïdes anabolisants et celui de la
crise sur l’acide tranexamique et les concentrés plasmatiques d’inhibiteur de
C1.
1773. OEDÈME CEREBRAL DE HAUTE ALTITUDE.. Complication d’un mal aigu des
montagnes (>) qui s’aggrave rapidement. Le tableau clinique associe, au début,
des troubles des fonctions supérieures (jugement, appréciation de la situation,
prise de décision), des céphalées insoutenables, des nausées et des
vomissements. Puis la marche devient titubante et les hallucinations fréquentes.
Un oedème pulmonaire (4) peut être associé. La seule mesure efficace et urgente
est la descente en dessous de 2 500 m, associée à l’administration d’oxygène
lorsque cela est possible. Le pronostic dépend de sa rapidité de mise en oeuvre.
1774. ŒDÈME DE CALABAR (->) LOASE.
1775. ŒDÈME DE QUINCKE(>) QUINCKE (OEDÈME DE).
1776. OEDÈME PULMONAIRE DE HAUTE ALTITUDE.
Définition et causes.
Œdème pulmonaire survenant lors d’une montée trop rapide en altitude, suivie
d’un séjour prolongé. La cause est une mauvaise réponse pulmonaire à la
diminution de la concentration en oxygène dans l’air inspiré. Il existe une
grande variation de la susceptibilité individuelle.
Epidémiologie.
Il touche souvent le sujet jeune, indemne de toute maladie pulmonaire ou
cardiaque, de 6 heures à 4 jours après son arrivée au-dessus de 4 000 m. La
plupart des cas surviennent entre 3 000 et 4 500 m, surtout dans les Andes et
dans l’Himalaya. Dans les Alpes, ils sont plus rares car les montées sont
rapides et les séjours de courte durée.
Signes et symptômes.
Le début des troubles est souvent nocturne et progressif. Ce sont d’abord les
signes du mal aigu des montagnes (céphalées, insomnie, nausées, toux sèche,
dyspnée), puis l’aggravation est rapide avec une grande détresse respiratoire
(dyspnée, cyanose, crachats rosés). L’auscultation retrouve des râles
crépitants.
Investigations.
Le diagnostic est clinique.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement permet, en général, une évolution rapidement favorable. Dans les
tableaux asphyxiques d’emblée ou en cas d’association à un œdème cérébral (>),
la mort peut survenir rapidement.
Traitement.
La conduite à tenir associe repos, oxygénothérapie et descente à basse altitude
(en dessous de 2 500 m). Les diurétiques peuvent être employés, mais en veillant
à ne pas aggraver une déshydratation préexistante.
Prévention et éducation.
Le meilleur conseil est: ne pas monter trop vite trop haut. Un gain de dénivelé
de 300 m par 24 heures au-dessus de 3 000 m permet, à la plupart des personnes,
de s’acclimater sans problème. La présence de signes de mal aigu des montagnes
impose au minimum l’arrêt de la progression et, si possible, la redescente.
1777. OESOPHAGITE.
Définition et causes.
Inflammation de la muqueuse œsophagienne. La cause la plus fréquente est le
reflux gastrocesophagien sur une hernie hiatale (>). Plus rarement, une
infection, notamment en cas d’immunodépression, des séquelles de la
radiothérapie ou un toxique (médicament, ingestion volontaire ou accidentelle
d’un caustique) peuvent être en cause.
Epidémiologie.
Très fréquent, notamment chez les jeunes enfants et chez les femmes enceintes.
Signes et symptômes.
Le signe majeur est une dysphagie (difficulté pour avaler) douloureuse, le plus
souvent associée à des signes de reflux (brûlures remontant le long de
l’œsophage, régurgitations acides).
Investigations.
La fibroscopie localise et apprécie la gravité des lésions.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont l’ulcération, l’hémorragie et, dans les cas
les plus graves, la perforation. En l’absence de traitement, une sténose peut
s’installer et le risque de cancérisation est élevé.
Traitement.
Le traitement médical de l’œsophagite sur reflux utilise les antisécrétoires
(anti-H2 ou inhibiteurs de la pompe à protons), les stimulants de la motricité
œsophagienne et les protecteurs de la muqueuse œsophagienne. Le traitement
chirurgical est indiqué en cas d’œsophagite récidivante et dans les formes
graves ou compliquées (caustiques, sténose).
Prévention et éducation.
La prévention de l’œsophagite sur reflux nécessite le respect de certaines
règles hygiénodiététiques: amaigrissement en cas d’obésité, évitement des
postures déclenchantes, des vêtements comprimant l’abdomen, suppression des
aliments irritants, repas léger le soir, buste surélevé pendant la nuit…
1778. OFUGI (MALADIE D’).
Définition et causes.
Affection cutanée rare du groupe des dermatoses éosinophiliques, caractérisée
par une éruption papulo-pustuleuse prédominant au niveau des poils. La cause est
inconnue.
Epidémiologie.
Elle atteint des sujets d’environ 30 ans, plutôt masculins. Elle a été décrite
initialement au Japon. Des cas analogues sont rencontrés de plus en plus
fréquemment en Occident.
Signes et symptômes.
La maladie débute par des placards bien limités, prédominants sur le visage et
le tronc, qui ont tendance à s’étendre en quelques jours.
Investigations.
Il existe une hyperéosinophilie sanguine. La biopsie cutanée assure le
diagnostic en montrant des infiltrations à éosinophiles de la glande sébacée et
du derme.
Evolution, complications et pronostic.
L’éruption évolue par poussées interrompues par des intervalles libres de
plusieurs semaines à plusieurs années. L’évolution à long terme se fait vers la
guérison spontanée en laissant une cicatrice pigmentée.
Traitement.
Le traitement des poussées utilise les corticoïdes ou la dapsone .
1779. OGILVIE (SYNDROME D’).
Définition et causes.
Pseudo-obstruction avec dilatation aiguë du côlon due, dans la grande majorité
des cas, à un stress chirurgical ou médical important (intervention majeure,
infarctus du myocarde, sepsis ou insuffisance respiratoire).
Epidémiologie.
Il est fréquent chez les patients sous ventilation assistée.
Signes et symptômes.
Association d’un météorisme abdominal majeur et diffus avec des douleurs, des
nausées, des vomissements, un arrêt du transit et un retentissement sur la
fonction ventilatoire.
Investigations.
La coloscopie est l’examen diagnostique et thérapeutique.
Evolution, complications et pronostic.
Le principal risque est la perforation avec péritonite.
Traitement.
La coloscopie permet la décompression du côlon et la mise en place d’une sonde
colique ou rectale. En cas d’échec ou de récidive, la chirurgie est parfois
nécessaire.
1780. OGUCHI (MALADIE D’) . Maladie héréditaire, de transmission autosomique
récessive, caractérisée par un affaiblissement important de la vision dès que la
lumière baisse (héméralopie).
1781. OLIGODENDROGLIOME.
Définition et causes.
Tumeur cérébrale développée à partir des oligodendrocytes. Il existe des formes
« bénignes » et des formes «malignes» avec, globalement, une tendance au
saignement. Les lobes frontaux et les ventricules sont la localisation la plus
fréquente.
Epidémiologie.
C’est une tumeur rare, qui survient dans la troisième ou quatrième décennie.
Signes et symptômes.
Le mode de révélation de la tumeur peut être une crise convulsive, des signes
d’hypertension intracrânienne (céphalées, vomissements, atteinte visuelle) ou
des signes neurologiques focaux (paralysies).
Investigations.
Le scanner et l’IRM montrent des images typiques.
Evolution, complications et pronostic .
La médiane de survie varie de un à trois ans selon le type de la tumeur.
Traitement.
Selon les cas, on associe, de manière variable, la chirurgie, la radiothérapie
et la chimiothérapie. Le traitement symptomatique utilise les corticoïdes
(contre l’œdème) et les antiépileptiques.
1782. OLLIER (MALADIE D’) ou ENCHONDROMATOSE. Maladie héréditaire caractérisée
par des anomalies de l’ossification entraînant des troubles de la croissance
avec des incurvations ou des raccourcissements des os longs.
1783. OLMSTED (SYNDROME DE). Maladie cutanée génétique, probablement transmise
sur le mode autosomique dominant, du groupe des kératodermies palmoplantaires.
Elle comprend une atteinte mutilante des doigts et des lésions autour de la
bouche. Un traitement par l’acitrétine peut être utile.
1784. OMENN (SYNDROME D’) ou (–>) RÉTICULOENDOTHÉLIOSE AVEC HYPERÉOSINOPHILIE.
1785. OMPHALOCÈLE.
Définition et causes.
Anomalie du développement embryologique de la paroi abdominale qui entraîne la
saillie de viscères abdominaux hors de la cavité abdominale.
Epidémiologie.
Elle survient dans 1 sur 5 000 naissances et, dans un tiers des cas, est
associée à d’autres anomalies, notamment chromosomiques (trisomie 21, 13,
18…).
Signes et symptômes.
La hernie est un gros sac entouré d’une membrane translucide contenant des anses
intestinales et, parfois, le foie.
Investigations.
Dans la majeure partie des cas, le diagnostic est fait, aujourd’hui, en prénatal
(échographie), ce qui permet de faire accoucher la mère dans un centre
spécialisé.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic dépend des anomalies associées et de la taille de l’omphalocèle
(petit ou moyen: 80 % des survies sans séquelles).
Traitement.
Dans la salle de naissance, il faut éviter le dessèchement et l’hypothermie
(pansement humide occlusif, incubateur). La fermeture chirurgicale doit être
effectuée dès que possible. Lorsque la cavité abdominale est trop petite:
couverture par une poche ou une cheminée dont la taille est progressivement
réduite à mesure que la capacité abdominale augmente.
1786. OMSK (FIÈVRE D’)(>) FIÈVRE D’OMSK.
1787. ONCHOCERCOSE ou «CÉCITÉ DES RIVIÈRES».
Définition et causes.
Parasitose due à un ver rond de la famille des filaires, Onchocerca volvulus,
transmise par la piqûre d’une mouche noire.
Epidémiologie.
Elle touche plusieurs millions de personne en Afrique, en Amérique centrale et
du Sud, ainsi qu’au Moyen-Orient. La mouche noire est principalement présente
autour des cours d’eau à débit rapide.
Signes et symptômes.
Association de signes cutanés avec des nodules durs, un prurit chronique avec
lichenification (« peau de crocodile ») ou des lésions de grattage avec des
taches dépigmentées (« peau de léopard »), d’adénopathies inflammatoires et de
signes oculaires, avec une kératite évoluant par poussées, une iridocyclite et
une choriorétinite.
Investigations.
Les microfilaires sont visibles à la biopsie cutanée exsangue.
Evolution, complications et pronostic.
La cécité une fois installée est définitive.
Traitement
Il est fondé sur l’ivermectine et l’ablation chirurgicale des nodules cutanés.
Prévention.
Le programme de l’OMS associe épandage de larvicides et d’insecticides, ainsi
qu’un traitement de masse par l’ivermectine.
1788. ONCOCYTOME. Tumeur rénale rare, bénigne, constitué par des cellules
particulières, les oncocytes (cytoplasme abondant, très riche en mitochondries).
Dans la plupart des cas, elle n’entraîne aucun symptôme; parfois, elle est à
l’origine de douleurs et de signes urinaires (hématurie). La tumeur est souvent
de grande taille (plus de 10 cm) et perçue à la palpation. Les examens
d’imagerie mettent en évidence une masse solide et dense, sans spécificité. Le
traitement consiste en une exérèse chirurgicale.
1789. ONDINE (MALÉDICTION D’) ou HYPOVENTILATION ALVÉOLAIRE PRIMITIVE.
Définition et causes.
Anomalie de la réponse ventilatoire à l’hypoxie et à l’hypercapnie, entraînant
des épisodes hypoxiques pouvant être à l’origine d’un décès.
Epidémiologie.
Elle s’observe en général chez l’homme entre 20 et 50 ans.
Signes et symptômes.
Elle se manifeste pour la première fois par une dépression respiratoire sévère
lors de l’administration de sédatifs ou d’anesthésiques. Ensuite, il existe une
léthargie, une somnolence diurne et des troubles du sommeil.
Investigations.
Les critères de diagnostic sont la présence d’une hypoventilation, d’une hypoxie
et d’une hypercapnie pendant le sommeil (enregistrement polygraphiques) en
l’absence d’anomalie cardiaque, pulmonaire, neuromusculaire,
électroencéphalographique ou cérébrale à l’IRM.
Evolution, complications et pronostic.
Les complications sont une hyperglobulie, une hypertension artérielle pulmonaire
et une insuffisance cardiaque.
Traitement.
Les moyens utilisés sont les stimulants respiratoires, l’oxygénothérapie, la
stimulation phrénique du diaphragme et la ventilation en pression positive.
1790. ONGLES JAUNES (SYNDROME DES) ou YELLOW NAIL SYNDROME.
Syndrome exceptionnel, de cause inconnue, associant un lymphoedème (>), des
épanchements pleuraux et une coloration jaune des ongles. Les femmes sont plus
fréquemment touchées. L’évolution s’étend sur des années avec des régressions
spontanées dans 30 % des cas. Le traitement de l’atteinte unguéale utilise la
vitamine E en administration prolongée et l’injection de corticoïdes dans la
matrice.
1791. ONYCHO-OSTÉODYSPLASIE. ou (>) NAIL-PATELLA SYNDROME.
1792. ONYCHOMYCOSE. Atteinte des ongles par un champignon, le plus souvent un
dermatophyte, souvent associé à un intertrigo lorsqu’elle touche les orteils.
Les ongles deviennent épais, ternes et friables (une destruction totale de
l’ongle est possible). La recherche du champignon est indispensable pour faire
le diagnostic. Le traitement est très long et utilise des antifongiques sous
forme de vernis ou par voie générale si la matrice de l’ongle est atteinte.
1793. OPISTORCH IASE.
Parasitose hépatobiliaire due à une douve de la famille des Opistorchidae.
1794. OPPENHEIM-URBACH (MALADIE DE)ou NÉCROBIOSE LIPOÏDIQUE. Affection cutanée touchant, le plus souvent, des diabétiques (0,3 % des diabétiques), plutôt du sexe féminin. Il s’agit de lésions nodulaires bilatérales au niveau prétibial qui confluent en plaques ovalaires allongées, de couleur rouge-jaunâtre.
L’évolution est chronique. Seuls les corticoïdes par voie locale et générale ont une certaine efficacité.
1795. ORCHITE. Inflammation du testicule, le plus souvent complication des
oreillons. Elle se traduit par une grosse bourse douloureuse. Le traitement est
le repos strict au lit et la principale complication est l’atrophie
testiculaire, source de stérilité si elle est bilatérale. Dans d’autres cas,
elle est associée à une épididymite (>).
1796. OREILLETTE (MALADIE DE L’) ou MALADIE RYTHMIQUE AURICULAIRE. Trouble du
rythme cardiaque dû à un dysfonctionnement du système d’excitation et de
conduction cardiaque. Un certain nombre de cardiopathies (infarctus du myocarde,
dysfonctionnement des valves…) peuvent en être à l’origine. La maladie se
manifeste, en général, chez des personnes de plus de 50 ans, pas des
palpitations, une dyspnée, des lipothymies. Le diagnostic est confirmé par
l’enregistrement Holter sur 24 heures qui permet de détecter des troubles du
rythme et de la conduction variés: fibrillation/flutter atrial, bradycardie
sinusale, jonctionnelle ou par bloc sino-atrial. Les crises se répètent plus ou
moins souvent. Les formes sévères sont traitées par des antiarythmiques associés
à la pose d’un stimulateur cardiaque (pacemaker).
1797. OREILLONS.
Définition et causes.
Maladie infectieuse contagieuse due à un virus, Myxovirus parotides, dont la
transmission est aérienne. La contagiosité dure environ pendant 15 jours, avec
un maximum la semaine précédant le début clinique de la maladie. L’incubation
est de 3 semaines.
Épidémiologie.
12000 cas en 2001 avec une couverture vaccinale d’un peu plus de 80 %. La
maladie touche essentiellement les enfants entre 5 et 10 ans.
Signes et symptômes.
Le début est marqué par un syndrome infectieux modéré avec, parfois, des
otalgies. Puis apparaît une tuméfaction parotidienne se bilatéralisant de
manière asymétrique en 2 à 3 jours. Les céphalées, fréquentes, sont le signe
d’une irritation méningée.
Investigations.
Elles sont inutiles dans la forme bénigne.
Évolution, complications et pronostic.
Dans la forme bénigne, les signes régressent en 10 jours. La principale
complication est l’orchite (tuméfaction douloureuse du testicule), qui est très
fréquente entre 15 et 30 ans et qui peut entraîner une atrophie testiculaire,
cause de stérilité si elle est bilatérale. Une pancréatite et une
méningo-encéphalite avec atteinte du nerf auditif (surdité séquellaire) sont
également possibles.
Traitement.
Il est symptomatique.
Prévention.
L’éviction scolaire est de 21 jours. La vaccination devrait permettre
l’éradication de la maladie dans les pays industrialisés, mais il faut pour cela
atteindre un taux de couverture vaccinale de plus de 95 %.
1798. ORF Affection cutanée virale due à un parapox-virus transmis par des
animaux malades (ovins, caprins). Après une incubation de 3 à 13 jours apparaît,
au site d’inoculation, le plus souvent la main, une macule érythémateuse
(rouge). Elle est suivie par un nodule parfois suintant qui se couvre d’une
croûte qui tombe en quelques jours, sans laisser de cicatrice. Les lésions sont
au nombre de 1 à 10. Le risque de surinfection est important. Le traitement est
symptomatique. L’animal peut être vacciné.
1799. ORGELET Infection de la bordure ciliaire, le plus souvent due à un
staphylocoque, caractérisée par une petite tuméfaction centrée par un cil, qui
peut être isolée ou associée à une inflammation de la paupière (blépharite). Il
peut s’abcéder, entraînant un oedème local puis régional. Le traitement consiste
en l’application d’une pommade antibiotique ou en une incision en cas d’abcès.
1800. ORMOND (MALADIE D’)
Forme idiopathique de la fibrose rétropéritonéale (>).
1801. ORNITHOSE ou (—>) PSITTACOSE.
1802. ORTHOPDXVIROSES Maladies dues à des virus du genre Orthopoxvirus. On
compte, parmi elles, la variole (>), maladie strictement humaine, et d’autres
maladies voisines particulières aux animaux — monkeypox (singes), whitepox
(singes et rongeurs), cowpox (bovins)… — qui n’infectent l’homme
qu’accidentellement. Ces maladies font l’objet d’une déclaration obligatoire
auprès des autorités sanitaires.
1803. ORTNER (SYNDROME D’) Paralysie de la corde vocale gauche qui peut se
manifester par une altération de la voix (dysphonie) due à une compression du
nerf récurrent gauche entre l’oreillette gauche et l’artère pulmonaire dilatées.
Ce syndrome s’observe dans le cadre d’un rétrécissement mitral (>).
1804. OS DE MARBRE (MALADIE DES) ou (>) ALBERS-SCHÔNBERG (MALADIE D’) .
1805. OS DE VERRE (MALADIE DES) ou (>) LOBSTEIN (MALADIE DE).
1806. OSGOOD-SCHLATTER (MALADIE D’).
Définition et causes.
Tendinite d’insertion du ligament rotulien sur la tubérosité tibiale, également
appelée apophysite tibiale antérieure. Elle semble due à la traction excessive
du tendon sur un os immature.
Épidémiologie.
Elle survient surtout chez le garçon de 1015 ans à la suite de traumatismes ou
d’activités sportives.
Signes et symptômes.
Elle se manifeste par des douleurs à la marche et à la course et par un
gonflement.
Investigations.
La radiographie montre une irrégularité de la tubérosité tibiale antérieure.
Évolution, complications et pronostic.
La douleur disparait en général en quelques mois à deux années, mais des formes
rebelles existent. Il peut persister une petite hypertrophie de la tubérosité.
Traitement.
L’arrêt du sport et des activités sollicitant trop fortement le genou suffit en
général. En cas d’échec, on aura recours à l’immobilisation plâtrée.
1807. OSTÉITE. Infection osseuse le plus souvent par une bactérie, plus rarement
par un champignon, une mycobactérie ou un parasite. Les formes les plus
fréquentes sont l’ostéomyélite (>) et la spondylodiscite (>).
1808. OSTÉOARTROPATHIE HYPERTROPHIANTE PNEUMIQUE ou SYNDROME DE PIERRE-MARIE
BAMBERGER .
Définition et causes.
Atteinte osseuse et articulaire, soit d’origine familiale (transmission
autosomique dominante à pénétrance variable), soit, plus fréquemment, en
association avec des cancers intrathoraciques, en général bronchiques (syndrome
paranéoplasique).
Épidémiologie.
Elle survient chez 5 à 10 % des patients ayant un cancer intrathoracique. Dans
près de 3 cas sur 4, elle précède la révélation de la tumeur.
Signes et symptômes.
Association d’un hippocratisme digital (élargissement de l’extrémité des doigts)
et d’une hypertrophie des mains et des pieds, avec des douleurs et des atteintes
articulaires avec des épanchements.
Investigations.
Les radiographies montrent une prolifération périostée (formation d’os nouveau
sous le périoste), au niveau des mains en particulier.
Évolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait par poussée. Le traitement de la cause entraîne une
guérison.
Traitement.
Il associe traitement symptomatique et traitement de la cause.
1809. OSTÉOBLASTOME BÉNIN ou FIBROME OSTÉOGÉNIQUE.
Définition et causes.
Tumeur osseuse bénigne composée de tissu conjonctif vascularisé et de travées
osseuses avec, parfois, des cellules géantes. Ses localisations sont, par ordre
de fréquence, la colonne vertébrale, le sacrum et les membres.
Epidémiologie.
Rare, elle ne représente que 3 % des tumeurs bénignes des os. Elle s’observe
surtout avant 30 ans, avec une prédominance masculine.
Signes et symptômes.
Le principal signe est la douleur.
Investigations.
La radiographie retrouve une zone transparente bien limitée, mouchetée
d’opacités.
Évolution, complications et pronostic.
Au niveau du rachis, une compression d’une racine nerveuse ou de la moelle
épinière est possible.
Traitement .
La tumeur doit être enlevée chirurgicalement.
1810. OSTÉOCHONDRITE DÉFORMANTE JUVÉNILE DE LA HANCHE ou (>) COXA PLANA.
1811. OSTÉOCHONDRITE DISSÉQUANTE DE GENOU ou MALADIE DE KONIG
Définition et causes.
Isolement d’un fragment osseux du condyle interne du genou, qui peut ensuite se
libérer dans l’articulation. La cause semble être une nécrose localisée due à
des microtraumatismes répétés.
Épidémiologie.
Elle s’observe surtout chez les adolescents de sexe masculin.
Signes et symptômes.
Au stade initial, il existe des douleurs et des épanchements à répétition, puis
apparaissent des épisodes de blocage.
A investigations.
La radiographie permet le diagnostic.
Évolution, complications et pronostic.
La principale complication est le développement d’une arthrose secondaire.
Traitement
Il consiste en l’ablation arthroscopique ou chirurgicale du fragment osseux.
1812. OSTÉOCHONDROMATOSE SYNOVIALE.
Définition et causes.
Atteinte articulaire caractérisée par le développement intrasynovial de noyaux
de tissu cartilagineux qui, en général, se calcifient et se détachent dans la
cavité articulaire. La cause est inconnue.
Épidémiologie.
C’est une affection rare qui s’observe surtout entre 20 et 40 ans, avec une
prédominance masculine.
Signes et symptômes.
Crises de douleurs avec épanchements et épisodes de blocage. L’articulation la
plus souvent touchée est le genou, puis viennent le coude et la hanche.
Investigations.
Ce sont la radiographie et l’arthroscopie.
Évolution, complications et pronostic .
La principale complication est la survenue d’une arthrose secondaire.
Traitement.
Il est chirurgical par synovectomie et ablation des corps étrangers.
1813. OSTÉOCHONDROSES DE CROISSANCE. Ensemble de lésions osseuses survenant dans
l’enfance ou l’adolescence, au cours de la croissance, et siégeant au niveau de
certaines régions ostéocartilagineuses (épiphyses = têtes osseuses, apophyses =
protubérances osseuses, corps vertébraux…). Les principales formes sont les
maladies de Scheuermann (vertèbres), de LeggPerthes-Calvé (hanche), de Köhler
(scaphoïde tarsien), d’Osgood-Schlatter (tibia), de Sinding Larsen-Johansson
(rotule), la maladie de Sever (calcanéum), de Panner (coude) et de Van
NeckOdelberg (bassin).
1814. OSTÉOCHONDROSE VERTÉBRALE DE CROISSANCE ou (>) SCHEUERMANN.
1815. (MALADIE DE)OSTÉODYSTROPHIE HÉRÉDITAIRE D’ALBRIGHT. Maladie héréditaire,
de transmission autosomique dominante, avec une pénétrance et une expressivité
variables au sein d’une même famille. Elle associe une malformation des mains et
des pieds, un faciès lunaire, une obésité, un retard de croissance, des
calcifications extrasquelettiques et, parfois, un retard mental. Les examens
biologiques montrent une hypocalcémie, une hyperphosphatémie et une élévation de
la PTH.
1816. OSTÉOGENÈSE IMPARFAITE. Trouble de la formation osseuse touchant la
matrice protidique de l’os. La forme congénitale est la plus grave, avec des
mort-nés ou des nourrissons atteints de multiples fractures qui décèdent en
quelques jours ou semaines. Une autre forme se manifeste dans l’enfance : on
l’appelle la maladie de Lobstein (>) ou maladie des os de verre.
1817. OSTÉOMALACIE.
Définition et causes
Maladie de l’adulte caractérisée par un défaut de minéralisation de l’os
(correspond au rachitisme chez l’enfant). La principale cause est une carence en
vitamine D (défaut d’apport, malabsorption, exposition solaire insuffisante).
Les autres causes plus rares sont une pathologie rénale, notamment
l’insuffisance rénale, ou une résistance à la vitamine D.
Épidémiologie
L’ostéomalacie s’observe surtout chez la femme âgée et est souvent associée à
une ostéoporose (déficit conjugué en vitamine D et en calcium du fait d’une
alimentation inadaptée).
Signes et symptômes
Les principales manifestations sont des douleurs osseuses débutant au niveau du
bassin (région du pli de l’aine), qui sont aggravées en position debout et par
la marche. Elles sont très intenses et limitent la mobilité (marche à petits
pas, très lente). Plus tardivement, le thorax et les épaules sont atteints.
Investigations
Les signes radiologiques sont caractéristiques: augmentation de la transparence
osseuse, aspect flou de l’os, fissures, stries de Looser-Milkman. Les examens
biologiques montrent en général une diminution de la calcémie, de la
phosphorémie et de la calciurie, associée à un effondrement du taux de vitamine
D.
Évolution, complications et pronostic.
La principale complication est représentée par les fractures qui peuvent
survenir pour un traumatisme minime. Plus tardivement, des déformations du
bassin et du thorax sont possibles. Le traitement permet une guérison en
quelques mois.
Traitement
La vitamine D, associée à un apport calcique suffisant (laitages, fromages…),
représente l’essentiel du traitement.
Prévention et éducation
La surveillance du mode de vie (exposition solaire satisfaisante) et de
l’équilibre alimentaire des personnes âgées, notamment des femmes, constituent
les meilleures mesures de prévention.
1818. OSTÉOME. Tumeur bénigne rare, composée d’os condensé. Elle siège
essentiellement au niveau de la voûte du crâne et des cavités de la face. Elle
ne se manifeste qu’exceptionnellement par des douleurs frontales ou par des
signes de compression de voisinage. La découverte est souvent fortuite, lors
d’un examen radiologique du crâne ou des sinus. L’abstention thérapeutique est
recommandée. Un traitement chirurgical n’est indiqué qu’en cas de douleurs
persistantes ou de comblement empêchant la ventilation du sinus.
1819. OSTÉOME OSTÉOÏDE.
Définition et causes.
Tumeur osseuse bénigne constituée de tissu conjonctif très vascularisé et de
travées osseuses. Elle est petite (moins d’un centimètre de diamètre) et siège
surtout sur les os longs des membres.
Epidémiologie.
Représente environ 10 % des tumeurs osseuses bénignes. Cette tumeur s’observe
surtout entre 5 et 25 ans, avec une nette prédominance masculine.
Signes et symptômes.
Il existe une douleur vive et tenace avec une recrudescence nocturne. Lorsque la
tumeur est superficielle, elle peut se manifester par un gonflement et une
douleur à la pression.
Investigations.
L’image radiologique est une petite zone transparente, arrondie, bien limitée et
entourée d’une zone plus dense. La scintigraphie osseuse et le scanner peuvent
également être utiles pour repérer la tumeur.
Evolution, complications et pronostic.
Le traitement chirurgical assure la guérison.
Traitement.
L’aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens soulagent le patient. Le
traitement est l’exérèse chirurgicale de la tumeur.
1820. OSTÉOMYÉLITE.
Définition et causes.
Infection de l’os et de la moelle osseuse, le plus souvent par des bactéries
(staphylocoque doré, streptocoque, Haemophilus infiuenzae, Enterobacter,
Pseudomonas…). La porte d’entrée est généralement une infection cutanée.
Certaines affections, notamment la drépanocytose, sont des facteurs favorisants.
Epidémiologie.
C’est une affection qui touche surtout l’enfant, avec un âge moyen de survenue
autour de 6 ans et une prédominance masculine. Les sièges les plus fréquents
sont le fémur et le tibia près du genou (70 %) chez l’enfant, la hanche chez le
nouveau-né et le nourrisson.
Signes et symptômes.
La fièvre est élevée et l’état général souvent altéré. La douleur est de
survenue parfois brutale, aiguë et insomniante. Chez le tout-petit, le tableau
peut se résumer à une attitude pseudoparalytique. L’augmentation de la chaleur
locale, le gonflement et la rougeur apparaissent tardivement.
Investigations.
Les signes radiologiques sont en retard par rapport à la clinique.
L’échographie, la scintigraphie, le scanner et l’IRM permettent de rechercher
notamment des abcès sous¬périostés. Les prélèvements bactériologiques multiples
(hémocultures, ECBU, prélèvement cutané, ponction articulaire…) recherchent le
germe en cause.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est favorable en cas de traitement précoce. Les principales
complications sont la constitution d’un abcès, l’extension de l’infection avec
une septicémie, le passage à une forme chronique avec destruction osseuse. Un
retentissement sur la croissance est possible, notamment en cas d’atteinte du
cartilage de croissance ou de destruction de la tête fémorale, chez le
nourrisson.
Traitement.
Le traitement antibiotique par voie veineuse, initialement dirigée contre le
staphylocoque puis adaptée aux résultats des prélèvements, est une urgence. Il
est associé à une immobilisation plâtrée. La chirurgie est indiquée pour drainer
un éventuel abcès.
1821. OSTÉONÉCROSE ASEPTIQUEDE LA TÊTE FÉMORALE.
Définition et causes.
Nécrose de la tête fémorale due à une ischémie d’origine vasculaire. Les
principales causes sont l’alcoolisme chronique, la drépanocytose et la
corticothérapie au long cours.
Epidémiologie.
Elle est relativement fréquente, se déclarant vers 30-45 ans et touche deux fois
plus souvent l’homme que la femme.
Signes et symptômes.
Le début est le plus souvent insidieux avec des douleurs peu intenses,
réveillant le patient en deuxième partie de nuit et déclenchées par le mouvement
de flexion, mais avec une amplitude articulaire normale. Une forme brutale
mimant une fracture est possible.
Investigations.
Les signes sur les radiographies classiques sont en retard sur la clinique de 1
à 2 mois. L’IRM permet le diagnostic très précoce.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution vers l’arthrose est inéluctable, avec une bilatéralité très
fréquente.
Traitement.
Au stade initial, on utilise les antalgiques, la mise au repos de l’articulation
(marche avec appui contact) et le forage de décompression. La prothèse de hanche
est indiquée au stade arthrosique.
Prévention.
La prévention des facteurs de risque est essentielle. Un diagnostic précoce
permet la mise en route d’un traitement retardant l’évolution de la maladie.
1822. OSTÉOPÉTROSE ou (>) ALBERS-SCHÜNBERG (MALADIE D’).
1823. OSTÉOPÉTROSE RÉCESSIVE MALIGNE. Maladie osseuse héréditaire, de
transmission autosomique récessive, caractérisée par une condensation osseuse
généralisée due à un trouble de la résorption osseuse. L’incidence est de
1/200000. Elle se manifeste dans la petite enfance par une insuffisance sévère
de la moelle osseuse (cavités médullaires remplacées par de l’os), des
paralysies des nerfs crâniens et des fractures. Le traitement est une greffe de
moelle.
1824. OSTÉOPOROSE.
Définition et causes.
Décalcification diffuse du squelette qui prédomine chez la femme après la
ménopause, dont la cause est un déséquilibre entre la résorption et la formation
osseuse qui conduit à un amincissement puis à la disparition des travées. La
forme primitive prédomine. Elle peut également être secondaire à une
corticothérapie ou à un alcoolisme chronique.
Epidémiologie.
Elle représente un problème majeur de santé publique du fait de la fréquence des
fractures conséquences de l’ostéoporose (50 000 nouveaux cas/an d’ostéoporose
vertébrale et 40 000 fractures non traumatiques du col du fémur).
Signes et symptômes.
La plupart du temps, il n’existe aucun signe fonctionnel et la découverte est
fortuite sur un examen radiologique. Les principaux signes sont les douleurs
vertébrales chroniques ou aiguës en cas de tassement vertébral, immobilisant le
malade 3 à 4 semaines, en général sans atteinte neurologique.
Investigations.
Les radiographies montrent une augmentation de la transparence osseuse (au
niveau des vertèbres en particulier). La sensitométrie osseuse est également
utile.
Evolution, complications et pronostic.
Il existe un risque majeur de fractures en l’absence de traitement.
Traitement et éducation.
Le traitement préventif de la perte osseuse comprend l’hormonothérapie
substitutive de la ménopause, des apports calciques, une activité physique et la
prévention des chutes. Le traitement curatif de la perte osseuse repose sur les
sels de fluor, les biphosphonates et la calcitonine.
1825. OSTÉOPOROSE IDIOPATHIQUE DE L’ADOLESCENT.
Affection rare, de cause inconnue, débutant vers l’âge de 10 ans et évoluant
vers l’amélioration spontanée après la puberté. Les principaux signes sont un
ralentissement de la croissance, des douleurs osseuses et des fractures (os
longs et rachis). La seule anomalie biologique est une hypercalciurie. Aucun
traitement ne semble efficace.
1826. OSTÉOPSATHYROSE ou (>) LOBSTEIN (MALADIE DE).
1827. OSTÉOSARCOME.
Définition et causes.
Tumeur maligne des os. La forme la plus fréquente est l’ostéome ostéoïde,
constitué de tissu conjonctif. Les autres formes plus rares sont le
chondrosarcome, le fibrosarcome, le sarcome d’Ewing et le réticulosarcome.
Epidémiologie.
Ces tumeurs s’observent surtout dans la seconde enfance et l’adolescence, avec
une légère prédominance masculine.
Signes et symptômes.
La douleur est en général le premier symptôme. Elle est, en général, profonde,
bien localisée et réveillée parla pression osseuse. La tumeur n’est, en général,
visible qu’au bout de quelques mois, mais elle peut être le premier signe. Une
fracture spontanée peut être révélatrice.
Investigations.
La radiographie, complétée par le scanner et l’IRM, montre une image claire, mal
limitée, avec une rupture de la corticale et une extension aux parties molles.
Seule la ponction biopsie permet le diagnostic (elle est souvent réalisée en
peropératoire).
Evolution, complications et pronostic.
Les nouvelles chimiothérapies ont amélioré le pronostic, qui reste souvent
mauvais avec un décès en un à deux ans. Des métastases pulmonaires sont
fréquentes.
Traitement.
Les nouveaux traitements utilisent des polychimiothérapies agressives qui
limitent les amputations. La chirurgie essaye d’enlever la tumeur en bloc et de
remplacer l’os par des prothèses ou des greffes. Une radiothérapie
complémentaire est parfois indiquée.
1828. OSTÉOSE CONDENSANTE ILIAQUE BÉNIGNE ou (>) BARSONYPOLGAR (MALADIE DE).
1829. OTHELLO (SYNDROME D’).
État délirant de jalousie morbide supposant l’infidélité du conjoint.
1830. OTITE BAROTRAUMATIQUE.
Définition et causes.
Lésion de l’oreille moyenne le plus souvent, mais l’oreille interne peut
également être touchée, lors d’une brusque variation de la pression ambiante.
Les deux principales causes sont la plongée (descente trop rapide et/ou
obstruction de la trompe d’Eustache par une infection) et les explosions.
Epidémiologie.
Représente trois quarts des accidents de plongée. Fréquent lors des explosions.
Signes et symptômes.
Lors de la descente en plongée apparaît une douleur violente, éventuellement
accompagnée de bourdonnements, d’une surdité, de vertiges, voire d’une
otorragie.
Investigations.
L’examen du tympan à l’otoscope permet d’évaluer l’ampleur des lésions (de la
simple rougeur du tympan jusqu’à la perforation).
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est l’atteinte concomitante de l’oreille interne avec
des vertiges importants, des troubles de l’équilibre et de la marche, qui peut
mettre la vie du plongeur en danger. La lésion du tympan lors d’une explosion
doit faire hospitaliser le patient pour surveillance, car le souffle a pu
également entraîner des lésions pulmonaires (> Blast).
Traitement.
Le traitement utilise les anti-inflammatoires et, éventuellement, les
antibiotiques pour prévenir la surinfection.
Prévention et éducation.
La prévention implique l’interdiction de plonger en cas d’inflammation ORL. Il
est également nécessaire d’équilibrer les oreilles dès le début de la plongée et
de remonter en cas d’échec et d’apparition d’une douleur.
1831. OTITE CHRONIQUE CHOLESTEATOMATEUSE ou CHOLESTEATOME.
Définition et causes.
Le cholestéatome correspond à de l’épithélium malpighien kératinisé envahissant
les cavités de l’oreille moyenne et détruisant la chaîne des osselets et les
parois osseuses.
Signes et symptômes.
Association d’une hypoacousie et d’une otorrhée (écoulement de l’oreille)
purulente plus ou moins abondante, volontiers fétide.
Investigations. L’otoscopie sous microscope binoculaire montre la perforation et
l’audiométrie une hypoacousie de transmission. Le scanner permet un bilan
d’extension.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution naturelle se fait vers l’extension avec aggravation des destructions
osseuses. Les complications sont en rapport avec une extension de voisinage
(paralysie faciale, atteinte labyrinthique, méningite, abcès du cerveau,
thrombophlébite du sinus latéral).
Traitement.
Il est chirurgical, avec une résection de tout l’épithélium ayant envahi
l’oreille moyenne.
1832. OTITE CHRONIQUE MUQUEUSE À TYMPAN OUVERT.
Définition et causes.
Inflammation chronique de la muqueuse de l’oreille moyenne, accompagnée d’une
perforation tympanique non marginale.
Signes et symptômes.
Association d’une otorrhée (léger suintement ou abondante, purulente ou
mucopurulente), d’une perforation tympanique et d’une hypoacousie.
Investigations.
L’otoscopie montre la perforation et l’audiométrie une hypoacousie de
transmission.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est lentement favorable, spontanément ou sous traitement. Les
complications sont exceptionnelles.
Traitement.
Il consiste en un assèchement de l’oreille médicalement ou chirurgicalement
complété par une tympanoplastie.
1833. OTITE EXTERNE.
Définition et causes.
Infection du conduit auditif externe. Les principales causes sont des
traumatismes par grattage, une infection virale, une réaction allergique
(médicament ou produit capillaire), la macération (baignades, utilisation de
bouchons…).
Epidémiologie.
Affection fréquente, en particulier chez les nageurs.
Signes et symptômes.
La forme localisée se limite à un furoncle isolé au niveau du conduit qui se
traduit par une douleur aiguë, aggravée par la pression. Dans la forme
généralisée ou diffuse, il existe des douleurs, des démangeaisons, un écoulement
fétide et une baisse de l’audition.
Investigations.
L’otoscopie permet de visualiser les lésions. Dans la forme diffuse, la peau est
rouge, tuméfiée et souillée de débris purulents.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est simple sous traitement. La principale complication est la
diffusion de l’infection, notamment au pavillon de l’oreille (périchondrite). Il
faut notamment éviter toute manipulation intempestive d’un furoncle.
Traitement ;
En cas de furoncle, le drainage sera spontané et le traitement se résume à des
antalgiques et à des antiseptiques locaux. Dans la forme diffuse, les
antibiotiques et les anti-inflammatoires locaux sont indiqués. En cas de
diffusion de l’infection, on aura recours aux antibiotiques par voie générale.
Prévention et éducation ;
L’éducation implique la compréhension et l’évitement des facteurs favorisants.
1834. OTITE MOYENNE AIGUË.
Définition et causes.
Inflammation de la muqueuse des cavités de l’oreille moyenne (caisse du tympan,
trompe d’Eustache et cavités mastoïdiennes), dont la cause est, le plus souvent,
bactérienne et, plus rarement, virale.
Epidémiologie.
C’est l’affection la plus fréquente chez l’enfant de moins de 5 ans, avec 4,5
millions de consultations/an.
Signes et symptômes.
Chez le nourrisson, les signes sont peu typiques avec une fièvre, une altération
de l’état général et une cassure de la courbe de poids. Chez l’enfant et
l’adulte, les signes auriculaires prédominent avec otalgie, otorrhée,
hypoacousie et sensation d’oreille pleine.
Investigations.
L’otoscopie montre des altérations ou une perforation du tympan.
Evolution, complications et pronostic.
Les complications sont liées à l’extension de voisinage (mastoïdite, paralysie
faciale, labyrinthite, méningite, abcès cérébral, thrombophlébite du sinus
latéral). L’évolution est bonne sous traitement.
Traitement.
L’antibiothérapie est éventuellement complétée par une paracentèse.
Prévention et éducation.
La prévention est la vaccination contre l’Haemophilus influenzae. En cas de
récidives, l’adénoïdectomie (ablation des «végétations») est possible.
1835. OTITE SÉREUSE ou SÉROMUQUEUSE À TYMPAN FERMÉ.
Définition et causes
Existence d’un épanchement chronique, séreux ou muqueux et aseptique, dans
l’oreille moyenne avec un tympan fermé. Les principaux facteurs de risque sont
le tabagisme passif et la vie en collectivité.
Epidémiologie
Elle est très fréquente chez l’enfant de 1 à 5 ans (selon certaines études, 10 à
20 % de cette tranche d’âge), avec une nette prédominance des garçons.
Signes et symptômes
Chez l’enfant, le tableau associe une hypoacousie bilatérale et des otalgies
répétées. Chez l’adulte, cette otite est plus rare et peut révéler l’existence
d’une tumeur maligne du rhinopharynx.
Investigations
Elles comprennent l’otoscopie et le bilan audiométrique.
Evolution, complications et pronostic
L’évolution est spontanément favorable dans de nombreux cas. Les complications
sont l’infection, la perforation et l’otite chronique cholestéatomateuse (>).
Traitement
Les aérateurs transtympaniques (« yoyos ») sont indiqués en cas d’hypoacousie
marquée.
Prévention et éducation
Il faut éviter la pénétration d’eau dans les conduits auditifs externes (bains,
piscine…) chez les porteurs d’aérateurs.
1836. OTOSPONGIOSE Surdité héréditaire, bilatérale et asymétrique, due à une
diminution de la mobilité de la chaîne des osselets alors que le tympan est
normal (surdité de transmission). La maladie apparaît le plus souvent à l’âge
adulte, notamment chez la femme à l’issue d’une grossesse. Des bourdonnements
d’oreille peuvent accompagner la surdité. Le traitement chirurgical
(remplacement des osselets lésés par des prothèses) donne d’excellents
résultats.
1837. OUTSHOORN (KÉRATODERMIE PALMOPLANTAIRE DE)
Maladie cutanée génétique, de transmission autosomique dominante, appelée en
anglais keratolytic winter erythema. Il s’agit d’un épaississement de la peau
des mains et des pieds qui apparaît chez l’enfant. Un peeling superficiel
(abrasion) de la peau lésée démasque une peau érythémateuse (rouge).
1838. OVAIRES POLYKYSTIQUES (SYNDROME DES) Dysfonctionnement
hypothalamo-hypophysoovarien, source d’anovulation ou de dysovulation avec des
ovaires contenant des kystes. On distingue le syndrome des ovaires polykystiques
de type 1 ou syndrome de Stein-Leventhal (>) et le syndrome de type 2, dont les
tableaux sont très proches. Les particularités du type 2 sont des ovaires
déformés par de gros kystes et des causes très variées : anomalie enzymatique
surrénalienne, tumeur de l’ovaire ou de la surrénale, hyperthyroïdies,
hyperprolactinémies, contraception microprogestative.
1839. OVERDOSE AUX OPIACÉS.
Définition et causes.
Accident lié à une surdose en héroïne (ou à un autre opiacé). Il survient le
plus souvent lors de la reprise d’une intoxication arrêtée volontairement ou
involontairement ou lors d’arrivage de nouveaux lots dont la composition est
différente de ceux consommés habituellement.
Epidémiologie.
Le nombre de décès lié aux overdoses est d’environ 200 par an en France.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont un coma, des pupilles très serrées, peu réactives à
la lumière (myosis) et, surtout, une dépression respiratoire qui constitue toute
la gravité du tableau.
Investigations.
Le diagnostic en urgence est clinique. En cas de doute sur le toxique, des
dosages urinaires sont possibles. Une radiographie pulmonaire est utile en cas
de complications.
Evolution, complications et pronostic.
La dépression respiratoire peut entraîner une apnée et la mort. Les principales
complications sont pulmonaires: œdème pulmonaire, inhalation.
Traitement.
Les gestes immédiats sont l’assistance ventilatoire (ballon et masque avec
oxygène à 100 %) et l’injection de l’antidote spécifique des opiacés (naloxone =
Narcan®). Une surveillance est nécessaire car la durée de vie de l’antidote (20
minutes) est très inférieure à celle du toxique et une rechute est possible.
1840. OVERDOSE À LA COCAÏNE ET AUX AMPHÉTAMINES.
Les manifestations des surdoses en cocaïne et en amphétamines sont très
variables mais peuvent entraîner la mort du sujet: états d’agitation avec
hyperthermie, rhabdomyolyse (destruction des fibres musculaires) et convulsions,
œdème pulmonaire, infarctus sur coronaires saines, accidents vasculaires
cérébraux, mort subite…
1841. OXALOSE. Affection héréditaire rare caractérisée par une augmentation de
la production d’acide oxalique due à deux déficits enzymatiques qui entraînent
une des dépôts de cristaux d’oxalate de calcium dans les tissus. Des arthrites
aiguës ou chroniques compliquent l’évolution. La néphrocalcinose, l’insuffisance
rénale et la mort surviennent généralement avant l’âge de 20 ans.
1842. OXYUROSE.
Définition et causes.
Parasitose due a un petit ver, enterobius vermicularis, mesurant de 3 mm a 1 cm
et vivant dans le caecum où il se nourrissant de résidus alimentaires. Les œufs
pondus par la femelle dans la région périanale sont très résistants et sont
véhiculés par les mains du patient (auto¬infestation), la poussière, le linge…
puis sont ingérés et éclosent dans l’intestin.
Épidémiologie.
Elle touche principalement les enfants. La prévalence est de 20 % dans la
population pédiatrique générale et peut atteindre 90 % dans celle des
institutions.
Signes et symptômes.
Le principal symptôme est le prurit anal nocturne, avec de possibles lésions de
grattage pouvant entraîner des insomnies.
Investigations.
Le scotch test (en collant un ruban adhésif sur l’anus, puis en l’examinant au
microscope) met en évidence des œufs.
Évolution, complications et pronostic.
Il n’existe aucune gravité.
Traitement.
Ce sont les antihelminthiques (flubendazole , pamoate de pyrantel , pamoate de
pyrvinium ) en une prise unique.
Prévention et éducation.
Le traitement devra être complété par des mesures particulières pour éviter la
récidive: changement de linge et de literie, couper les ongles, traitement de
toute la famille dans le même temps.
1843. OZÈNE ou (>) RHINITE ATROPHIQUE PRIMITIVE
P
1844. PACHYDERMOPÉRIOSTOSE ou (–>) UEHLINGER (MALADIE DE).
1845. PAGET (MALADIE OSSEUSE DE).
Définitions et causes.
Maladie bénigne et de cause inconnue, touchant plusieurs os, caractérisée par un
remodelage osseux conduisant à une hypertrophie et à une structure osseuse
anormale.
Epidémiologie.
C’est la deuxième maladie osseuse par sa fréquence, après l’ostéoporose: elle
touche 2 à 3 % des plus de 55 ans, avec une légère prédominance masculine.
Signes et symptômes.
Association de douleurs osseuses, articulaires ou, plus rarement, neurologiques
(par compression) et de déformations osseuses localisées (crâne, membres,
vertèbres lombaires, bassin).
Investigations.
Les radiographies montrent des images typiques au niveau du crâne (aspect
floconneux de la voûte), des vertèbres (aspect en cadre), des os longs
(incurvations) ou du bassin. La scintigraphie montre une hyperfixation locale
qui permet un bilan topographique. Il existe une augmentation des phosphatases
alcalines sanguine et de l’hydroxyproline urinaire.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est très lente. Les principales complications sont articulaires,
neurologiques (trouble de l’audition, sciatique…) ou à type de fractures des
os longs. La transformation en sarcome (>) est rare mais très grave.
Traitement.
Il utilise les biphosphonates qui calment les douleurs et retardent l’apparition
des complications.
1846. PAGET DU SEIN (MALADIE DE). Atteinte cutanée du mamelon qui traduit un
cancer du sein sous-jacent. Il existe une plaque rouge, croûteuse, suintante,
ressemblant à de l’eczéma, autour du mamelon. La biopsie fait le diagnostic. La
mammographie recherche le cancer du sein associé. Le traitement est le même que
celui du cancer du sein (>).
1847. PAGET DE LA VULVE (MALADIE DE). Maladie cancéreuse rare liée à une
prolifération de l’épithélium glandulaire de la vulve, qui touche la femme âgée.
Il existe des lésions rouges, bien limitées par une hyperkératose (prolifération
de la couche cornée), qui provoquent des brûlures et des démangeaisons. La
biopsie permet le diagnostic. Un cancer de la vulve peut être associé. Le
traitement est chirurgical.
1848. PAGET-VON SCHROTTER (SYNDROME DE). Syndrome dû à l’obstruction de la veine
axillaire par compression ou thrombose, en apparence sans cause, parfois
consécutive à un traumatisme. Il est caractérisé par un cedème douloureux du
bras, de l’épaule, quelquefois du cou, évoluant spontanément vers la guérison,
avec le développement d’une circulation collatérale.
1849. PALLISTER-KILIAN (SYNDROME DE) . Il s’agit d’une anomalie génétique de
survenue fortuite, caractérisée par l’existence de quatre chromosomes 12
(tétrasomie 12p). Elle se traduit par des déformations faciales, des anomalies
de la pigmentation cutanée, des malformations viscérales, un retard mental
profond et une épilepsie.
1850. PALUDISME.
Définition et causes.
Maladie parasitaire due des protozoaires (animaux unicellulaires) du genre
Plasmodium transmis par la piqûre de moustiques (anophèles femelles).
L’incubation dure de 10 à 20 jours.
Epidémiologie.
C’est la maladie infectieuse la plus répandue dans le monde. Elle sévit dans la
zone intertropicale et touche 300 à 500 millions de personnes par an
(principalement en Afrique), avec plus de 2 millions de morts. Il existe environ
7000 cas d’importation en France.
Signes et symptômes.
Accès de fièvre au retour d’un voyage dans une zone infestée avec une asthénie,
des céphalées, des courbatures et un subictère. On retrouve parfois une
hépatomégalie et/ou une splénomégalie.
Investigations.
Le parasite est mis en évidence dans le sang par frottis et goutte épaisse. Une
anémie et une neutropénie sont fréquentes.
Evolution, complications et pronostic.
La forme pernicieuse avec une atteinte neurologique (convulsions, coma) peut
entraîner un décès, surtout en cas de retard à la mise en route du traitement.
Traitement.
Il repose sur la quinine en intraveineux, éventuellement associée à la
doxycycline (en cas de doute sur une résistance).
Prévention et éducation.
La prévention est fondée sur la chimioprophylaxie, adaptée en fonction des zones
(chloroquine et proguanil ou méfloquine ou cyclines) et sur la protection contre
les moustiques (répulsifs, moustiquaires, vêtements couvrants…)
1851. PANARIS.
Définition et causes.
Infection aiguë, primitive, d’un doigt, dont la cause est une inoculation (piqûre), le plus souvent méconnue, qui permet aux germes de traverser la peau et d’atteindre les tissus cutanés et sous-cutanés. La localisation la plus fréquente est péri- ou sous-unguéale.
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente, en particulier dans certaines professions manuelles et en cas de diabète, d’immunodépression, de corticothérapie ou d’alcoolisme.
Signes et symptômes.
Le stade phlegmasique associe une douleur spontanée avec une impression de
tension, une rougeur et une chaleur locale. Au stade de collection, quelques
heures ou jours plus tard, la douleur est intense, pulsatile, empêchant de
dormir et il existe un gonflement local dû à la collection (le pus est visible
dans la forme sous-cutanée).
Investigations.
La radiographie recherche des signes d’ostéoarthrite ou un corps étranger.
Evolution, complications et pronostic.
Au stade phlegmasique, la régression spontanée ou d’évolution vers la collection
sont possibles. Le stade de collection est irréversible et expose à des
complications (ostéite et ostéoarthrite, phlegmon des gaines, lymphangite,
septicémie).
Traitement.
Au stade phlegmasique, le traitement local associé à une antibiothérapie
antistaphylococcique permet la guérison en 24 ou 48 heures. En cas d’échec ou au
stade de collection, la chirurgie est obligatoire. La vaccination antitétanique
doit être vérifiée.
Prévention et éducation.
Une information des sujets à risque est indispensable pour instaurer un
traitement précoce et éviter les complications.
1852. PANCOAST-TOBIAS (SYNDROME DE). Il résulte de l’extension locale d’une
tumeur du sommet du poumon qui atteint la 8′ racine nerveuse cervicale et les
deux premières thoraciques. Il se manifeste par une douleur au niveau de
l’omoplate, qui irradie dans le bras (territoire du nerf cubital) et qui est
souvent associée à une destruction radiologique des deux premières côtes. Il
peut être associé à un syndrome de Claude Bernard-Homer (>).
1853. PANCRÉAS (PSEUDOKYSTE DU).
Définition et causes.
Collection liquidienne qui apparaît le plus souvent au cours de l’évolution
d’une pancréatite aiguë (plus rarement après un traumatisme).
Epidémiologie.
Complique 15 % des pancréatites aiguës.
Signes et symptômes.
La plainte initiale est une douleur abdominale qui peut irradier dans le dos.
Une masse abdominale est parfois palpable.
Investigations.
L’échographie permet le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Dans un tiers des cas, la régression est spontanée, ce qui se produit rarement
si la taille est supérieure à 5 cm et s’il persiste plus de 6 semaines. Les
complications sont les compressions d’autres organes, la rupture, l’hémorragie
et l’abcès. En cas de rupture et/ou d’hémorragie, la mortalité est élevée.
Traitement.
Une simple surveillance suffit en cas de petite taille. Dans les autres
situations, une ponction à l’aiguille et, en cas d’échec, un drainage
chirurgical sont indiqués.
1854. PANCRÉATITE AIGUË.
Définition et causes.
Maladie inflammatoire aiguë du pancréas entraînant une autodigestion de la
glande et des tissus voisins. Les deux principales causes sont la lithiase
biliaire (50 %) et l’alcool (40 à 50%). Les autres causes sont une infection
virale (oreillons…), un traumatisme (chirurgie, geste diagnostic…), une
obstruction (tumeur…).
Epidémiologie.
L’incidence annuelle est de 50 pour 100000.
Signes et symptômes.
La douleur est à début brutal, d’intensité variable et croissante, souvent
épigastrique, irradiant dans le dos et pliant le malade en deux (position «en
chien de fusil »). Il existe des nausées, des vomissements et une fièvre
modérée.
Investigations.
Les enzymes pancréatiques sanguins (amylase et lipase) sont augmentés.
L’échographie et le scanner abdominal permettent d’évaluer la gravité de
l’atteinte.
Evolution, complications et pronostic.
On distingue la forme œdémateuse (80 % des cas), dont l’évolution est simple, de
la forme nécrosante, dont la mortalité peut atteindre 50 % (collapsus
cardiovasculaire et défaillance multiviscérale). Le score de Ranson, qui utilise
11 critères et analyse l’évolution clinique, permet d’évaluer la gravité de la
maladie.
Traitement.
Le traitement symptomatique comprend le maintien à jeun strict et les
antalgiques. En cas de pancréatite grave, une hospitalisation en soins intensifs
s’impose. La chirurgie ou, parfois, l’endoscopie sont parfois nécessaires
(évacuation d’une lithiase, élimination de plages de nécrose ou de kystes
infectés).
Prévention et éducation.
Le sevrage de l’alcool est impératif pour éviter les récidives.
1855. PANCRÉATITE CHRONIQUE.
Définition et causes.
Fibrose progressive du tissu pancréatique, entraînant à la longue sa destruction
accompagnée fréquemment d’une calcification. L’alcool est la cause la plus
fréquente en France (90 % des cas). Les autres causes sont l’obstacle du canal
pancréatique (lithiase, cancer…), l’hypercalcémie (hyperparathyroïdie) ou
l’hérédité.
Epidémiologie.
La prévalence est de 0,4 pour 1000. Cette affection touche principalement
l’homme d’âge moyen. La durée de l’intoxication (plus de 15 ans) et la quantité
d’alcool consommée sont des facteurs importants.
Signes et symptômes.
Le tableau est variable en fonction du stade de découverte mais les signes les plus fréquents sont des crises douloureuses abdominales récidivantes, un amaigrissement, un ictère. Plus tardivement, il peut exister une diarrhée graisseuse (signe d’une malabsorption) et un diabète.
Investigations.
L’exploration fonctionnelle pancréatique utilise le recueil du suc duodénal par
tubage après un repas et le dosage de la glycémie à jeun et postprandiale (après
un repas). La radiographie d’abdomen sans préparation, l’échographie et le
scanner explorent la morphologie du pancréas. La cholangiopancréatographie
rétrograde par voie endoscopique (CPRE) reste l’examen de référence pour mettre
en évidence les lésions canalaires.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait en deux phases: crises douloureuses récidivantes pendant plusieurs années, puis insuffisance pancréatique (malabsorption et diabète). Les principales complications sont les poussées de pancréatite aiguë et la formation de kystes qui peuvent s’infecter, comprimer les organes de voisinage ou se fistuliser (ascite ou épanchement pleural).
Traitement.
L’arrêt définitif de l’alcool est impératif. Les extraits pancréatiques et
l’insuline compensent l’insuffisance pancréatique. Un régime pas trop riche en
graisse est préconisé. La chirurgie est indiquée en cas de complications.
Prévention et éducation.
La lutte contre l’alcoolisme chronique est essentielle pour faire régresser
cette maladie.
1856. PANDAS SYNDROME Acronyme anglais pour pediatric autoimmune
neuropsychiatrie disorder associated with streptococcal infections. Il s’agit
d’un trouble obsessionnel compulsif (>) de l’enfant pouvant survenir dans les
suites rapprochées d’une infection à streptocoques (angine, scarlatine).
1857. PAN ENCÉPHALITE SCLÉROSANTE SUBAIGUË ou LEUCOENCÉPHALITE SCLÉROSANTE
SUBAIGUË. Affection neurologique survenant plusieurs années après une rougeole.
Elle est très rare et a diminué depuis la diffusion du vaccin conte la rougeole.
L’âge de début moyen se situe entre 5 et 15 ans. La survenue est progressive,
avec une détérioration des fonctions intellectuelles et des crises convulsives.
L’évolution se fait vers un état grabataire, avec un mutisme et une tétraplégie
spastique. Aucun traitement n’a montré une réelle efficacité.
1858. PANNER (MALADIE DE). Trouble de la croissance osseuse touchant le noyau
d’ossification du condyle huméral au moment de son développement maximal
(ostéochondrose).
1859. PANNICULITE NODULAIRE FÉBRILE ou (>) WEBER-CHRISTIAN (MALADIE DE).
1860. PAPILLOMATOSE ORALE FLORIDE. Lésion précancéreuse de la langue, qui est
caractérisée par une hyperplasie des papilles (touffes de villosités souples, de
couleur blanche ou rosée) et qui a tendance à s’étaler superficiellement et très
lentement.
1861. PAPILLOMAVIRUS (INFECTIONS GÉNITALES À).
Définition et causes.
Infections anogénitales dues à différents types de papillomavirus humain (VPH).
Il s’agit d’infections sexuellement transmissibles (IST), dont le principal
facteur de risque est un nombre élevé de partenaires. Le risque de contamination
après contact sexuel atteint 60 à 70%.
Epidémiologie.
Il s’agit d’une des MST les plus fréquentes; elle touche principalement les
jeunes de 16 à 25 ans. Les infections latentes toucheraient près de 10 % des
femmes.
Signes et symptômes.
Les condylomes acuminés (>) ou papuleux représentent l’expression clinique la
plus fréquente. Chez la femme, l’infection est souvent inapparente.
Investigations.
En cas de condylomes ou de frottis cervical suspect, une colposcopie après
application d’acide acétique permet de visualiser les lésions (condylomes plans,
néoplasies intra-épithéliales) et de diriger les biopsies. La recherche et le
typage des virus s’effectuent à partir d’un prélèvement cervical et permettent
d’apprécier le risque cancéreux (VPH 16 et 18 détectés dans 90 % des états
précancéreux et des cancers invasifs du col).
Evolution, complications et pronostic.
Le risque cancéreux doit être apprécié en fonction des lésions et du type de
virus en cause. L’immunodépression favorise les récidives et le développement du
cancer. Aucun traitement ne permet une guérison à 100 % et près d’un tiers des
patients aura des récidives dans les 6 mois.
Traitement.
Le traitement de choix est le laser CO2. Les autres méthodes utilisées sont
l’application d’acide trichloracétique, de podophyllotoxine, la cryothérapie et
la pommade au 5fluorouracile. L’examen et le traitement éventuel du partenaire
sont indispensables.
Prévention et éducation.
La prévention primaire utilise essentiellement le port du préservatif et un
nouveau vaccin actif contre certains types de VPH (Gardasil®), indiqué chez les
jeunes filles avant la puberté. Le dépistage systématique des condylomes et des
lésions infracliniques (frottis régulier) et leur éradication constituent le
seul moyen de prévenir les complications cancéreuses.
1862. PAPILLOMES DU LARYNX. Tumeurs bénignes dues à différents types de
papillomavirus humains (VPH). Chez l’adulte, il s’agit le plus souvent d’une
tumeur unique, plus ou moins volumineuse, dont l’exérèse s’effectue sous
laryngoscopie. Certaines formes mal limitées ou récidivantes sont, en fait, des
lésions précancéreuses. Chez l’enfant, les papillomes sont très nombreux et
peuvent entraîner une gêne respiratoire. Le traitement au laser est très
efficace. En outre, la maladie guérit spontanément à la puberté.
1863. PAPILLOME DU PHARYNX. Tumeur bénigne due à différents types de
papillomavirus humains (VPH). Il s’agit en général d’une petite excroissance
arrondie, à la surface granitée, sur le voile du palais ou sur les piliers de
l’amygdale. Elle ne donne habituellement aucun symptôme et est découverte lors
d’un examen systématique. L’exérèse se fait à la pince.
1864. PAPILLON-HALL (SYNDROME DE). Syndrome malformatif héréditaire, de
transmission autosomique dominante. Il associe des anomalies des doigts
(polydactylie = nombre de doigts augmenté, syndactylie = fusion des doigts) et
une tumeur hypothalamique. Des malformations viscérales sont fréquentes :
imperforadon anale, luette bifide, malformation cardiaque, pulmonaire ou
rénale…
1865. PAPILLON-LÉAGE ET PSAUME (SYNDROME DE). Maladie héréditaire, de
transmission dominante liée au chromosome X, caractérisée par un ensemble de
malformations de la bouche et des mains. La langue est divisée en plusieurs
lobes par l’hypertrophie des freins buccaux, le palais et la lèvre supérieure
sont souvent fendus. Les doigts sont courts, déviés, fléchis ou soudés.
1866. PAPILLON-LEFÈVRE (MALADIE DE). Maladie héréditaire, de transmission
autosomique récessive, caractérisée par des dilatations des vaisseaux
(télangiectasies) des extrémités avec un épaississement de la peau
(hyperkératose) et une sudation abondante (hyperhidrose), ainsi qu’une chute
précoce des dents. Il s’agit d’une variante de la maladie de Meleda (>).
1867. PAPULOSE ATROPHIANTE MALIGNE DE DEGOS. Maladie caractérisée par une
occlusion des petites artères provoquent des infarctus tissulaires au niveau
cutané, digestif, oculaire et neurologique. La cause inconnue. Les lésions
cutanées sont de petites papules rouges, donnant secondairement une zone
atrophique blanchâtre porcelainée légèrement déprimée. L’atteinte digestive se
traduit par des perforations intestinales qui entraînent souvent le décès du
patient.
1868. PAPULOSE BOWENOYDE. Cancer superficiel de la vulve liée à une infection
par un papillomavirus (VPH 16). La papulose bowenoide touche la femme jeune
(autour de 30 ans). Les lésions sont des plaques surélevées (papules)
pigmentées, brunes ou gris rosé, à la surface mamelonnée. Elles touchent la
vulve, le périnée, la marge anale et forment des nappes confluentes
vulvopérinéales. La régression spontanée est la règle. Le laser CO, permet, la
plupart du temps, de faire régresser les lésions.
1869. PAPULOSE LYMPHOMATOÏDE. Maladie cutanée, probablement liée à la présence
d’une prolifération de lymphocytes T, qui reste contrôlée par le patient. Il
s’agit d’une affection bénigne bien que l’histologie soit apparemment maligne.
L’éruption est faite d’éléments papuleux nécrotiques qui guérissent spontanément
en 4 à 6 semaines en laissant des cicatrices. Le principal risque est
l’évolution vers un véritable lymphome.
1870. PARACOCCI DIOÏDOMYCOSE.
Définition et causes
Maladie infectieuse due à un champignon, Paracoccidioides brasiliensis. On pense
que la contamination se fait par inhalation dans l’air environnant.
Epidémiologie
La maladie n’existe qu’en Amérique Centrale et du Sud et atteint le plus souvent
les hommes entre 20 et 50 ans (en particulier, les planteurs de café).
Signes et symptômes
L’atteinte peut toucher, de manière isolée ou en association, la peau et les
muqueuses (ulcères sur le nez et dans la bouche), les ganglions (gros ganglions
cervicaux, supraclaviculaires ou axillaires), les viscères (gros foie, grosse
rate, gros ganglions abdominaux).
Investigations
L’identification du champignon peut se faire sur des prélèvements des ulcères ou
sur des biopsies.
Evolution, complications et pronostic
Le traitement est long et difficile, mais la maladie est rarement mortelle.
Traitement
On utilise le kétaconazole ou l’itraconazole , voire l’amphotéricine B dans les
formes graves.
1871. PARAGONIMOSE.
Définition et causes.
Parasitose également appelée distomatose pulmonaire due à une douve du genre
Paragonimus. La contamination se fait par ingestion de crustacés crus ou mal
cuits.
Epidémiologie.
Elle sévit en petits foyers en Amérique du Sud, en Afrique centrale et dans le
Sud-Est asiatique, et touche l’enfant et l’adulte jeune.
Signes et symptômes.
Il existe un tableau pseudotuberculeux avec une fièvre, une toux quinteuse
hémoptoïque.
Investigations.
Le diagnostic repose sur l’identification d’œufs dans les crachats, le liquide
d’aspiration bronchique ou le liquide pleural.
Evolution, complications et pronostic.
Des pleurésies chroniques sont possibles.
Traitement.
Il fait appel au praziquantel .
Prévention et éducation.
La prévention nécessite une cuisson suffisante des crustacés.
1872. PARALYSIE BULBAIRE PROGRESSIVE ou FAZIO-LONDE (SYNDROME DE).
1873. PARALYSIE FACIALE A FRIGORE ou PARALYSIE DE BELL.
Définitions et causes.
Également appelée paralysie faciale essentielle ou paralysie de Bell, il s’agit
d’une atteinte du nerf facial (nerf crânien VII) au niveau de son noyau ou de
ses branches par un mécanisme œdémateux de cause inconnue (une étiologie virale
ou auto-immune est suspectée). Le nerf facial est essentiellement moteur de la
face et possède une fonction sécrétoire, sensitive et sensorielle par le nerf
intermédiaire de Wrisberg (VIlbis), au niveau des glandes lacrymales, du muscle
de l’étrier, du goût de la partie antérieure de la langue, des glandes
salivaires sublinguales et sous-maxillaires, ainsi que de la conque de
l’oreille.
Epidémiologie.
L’incidence annuelle est de 23/100000. Elle touchera 1 personne sur 60 à 70 au
cours de sa vie.
Signes et symptômes.
L’installation est brutale, souvent d’apparition nocturne et constatée le matin
au réveil, parfois après une exposition au froid. La paralysie touche la partie
inférieure et supérieure de la face, avec une asymétrie faciale, un effacement
des rides du front, une joue flasque, une occlusion palpébrale impossible du
côté atteint (signe de Charles Bell), une chute de la commissure labiale et une
bouche déviée du côté sain lors de son ouverture.
Investigations.
Elles ne sont nécessaires que pour éliminer une autre étiologie.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est favorable avec une guérison complète en 6 à 8 semaines. Une
récupération incomplète doit faire remettre en cause le diagnostic. Les
complications sont dominées par le dessèchement de la cornée.
Traitement.
Il vise à la protection oculaire (larmes artificielles, occlusion de la paupière
avec un sparadrap). Les corticoïdes peuvent être utilisés à la phase précoce.
Prévention et éducation.
Il faut éviter de s’exposer aux courants d’air froid.
1874. PARALYSIE GÉNÉRALE. Complication neurologique tardive de la syphilis
survenant 15 à 20 ans après la primo-infection non ou insuffisamment traitée.
Elle est devenue exceptionnelle aujourd’hui. Les signes de paralysie sont
associés à une démence profonde. Le scanner montre une atrophie cérébrale
majeure à prédominance frontale.
1875. PARALYSIE PÉRIODIQUE FAMILIALE HYPOKALIÉMIQUE ou (>) WESTPHAL (MALADIE
DE).
1876. PARALYSIE DU PLEXUS BRACHIAL
Définition et causes.
Lésion des racines nerveuses du membre supérieur par étirement lors d’un
accouchement difficile (dystocie des épaules, siège, tête en hyper-abduction en
présentation céphalique).
Signes et symptômes.
Le bras est en adduction (rapproché du corps) et en rotation interne, alors que
l’avant-bras est en pronation (paume de la main tournée vers l’arrière). La
mobilité de l’ensemble du bras est réduite, voire absente, selon le degré de
l’atteinte.
Investigations.
Une radiographie du rachis permet d’éliminer une fracture. L’électromyogramme
précise les atteintes.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est fonction de l’importance des lésions: la récupération peut être
totale, mais une paralysie complète peut persister.
Traitement.
Dès la naissance, la kinésithérapie permet d’éviter les rétractions et ankylose.
Puis, après 3 mois, une réparation des lésions nerveuses est possible. Après 18
mois, des transferts musculaires sont possibles pour limiter l’effet des
séquelles et améliorer la mobilité du membre.
1877. PARALYSIE SUPRANUCLÉAIRE PROGRESSIVE ou (-) STEELE-RICHARDSONOLSZEWSKI
(MALADIE DE)PARAMYOTONIE CONGÉNITALE ou (>) VON EULENBURG (MALADIE DE) .
1878. PARANOÏA ou PERSONNALITÉ PARANOÏAQUE.
Définition et causes.
Traits de caractère permanents caractérisés par l’orgueil ou hypertrophie du
moi, la méfiance et la psychorigidité. Elle est souvent la conséquence d’une
enfance difficile. L’attitude paranoïaque est destinée à éviter l’humiliation
qui a été subie à cette période de l’existence. Pour se défendre, le sujet
accuse les autres de façon systématique. Les personnalités paranoïaques sont
plus fréquentes parmi les proches des sujets schizophrènes.
Epidémiologie.
Trouble assez fréquent (entre 0,4 à 3 % de la population générale).
Signes et symptômes.
La méfiance est permanente : le monde est plein d’ennemis et de difficultés, ce
qui impose une vigilance permanente. Le sujet développe des stratégies d’attaque
ou de vengeance qui peuvent être dangereuses. L’hypertrophie du moi associe
orgueil et égoïsme: le paranoïaque se considère comme différent, supérieur et
surdoué. Le paranoïaque est psychorigide: il ne change pas d’avis, il est
imprégné de principes, irréaliste, ce qui le mène souvent à des catastrophes.
L’ensemble de ces signes ne favorisent pas l’intégration sociale: le sujet est
souvent odieux, agressif, difficile, infréquentable.
Evolution, complications et pronostic.
Dans une situation de conflit difficile, le paranoïaque peut se déchaîner et
commettre des actes violents mais, le plus souvent, il se limite à des
procédures juridiques interminables. Les échecs répétés entraînent souvent des
états dépressifs qui peuvent être graves. Enfin, un véritable délire aigu ou
chronique peut s’installer.
Traitement.
La psychothérapie est la base du traitement, parfois complétée par des
psychotropes (neuroleptiques, antidépresseurs).
1879. PARAPHRÉNIE. État mental pathologique où coexistent, d’une part, un délire
fantastique ou de fabulation et, d’autre part, la conservation de la lucidité et
de l’adaptation au monde réel, le passage de l’un à l’autre état s’effectuant
facilement. La frontière avec la schizophrénie (>) est parfois difficile à
établir.
1880. PARAPLÉGIE SPASTIQUE FAMILIALE ou SYNDROME DE STRUMPELLLORRAIN. Maladie
neurologique héréditaire, de transmission autosomique dominante, due à une
atteinte de la moelle épinière (démyélinisation des faisceaux pyramidaux). Sa
prévalence est estimée à
1/100000. Elle est caractérisée par une atteinte des membres inférieurs avec une
contracture en extension qui donne une démarche particulière. Elle débute vers
l’âge de 20 ans, et s’aggrave progressivement et très lentement vers une
paralysie spastique.
1881. PARAPLÉGIE SPASTIQUE TROPICALE. Atteinte de la moelle et des nerfs
caractérisée par une perte de la gaine de myéline (myéloneuropathie
démyélinisante) liée à l’infection par le virus HTLV-1 (Human T-Lymphocyte Virus
de type I). La transmission se fait par contact sexuel, partage de seringue,
transfusion sanguine ou de la mère à l’enfant. C’est une maladie rare qui
s’observe dans les régions tropicales. La maladie débute lentement par des
troubles moteurs avec une hypertonie au niveau des deux membres inférieurs
(parésie spastique). L’évolution est chronique. Il n’existe aucun traitement
efficace.
1882. PARAPSORIASIS EN GOUTTES ou PITYRIASIS LICHENOÏDE.
Affection cutanée inflammatoire, de cause inconnue caractérisée par une éruption
en gouttes. Elle touche surtout l’adolescent et l’adulte jeune, avec une
prédominance masculine. On distingue la forme maculopapuleuse, d’évolution
chronique, la forme aiguë varioliforme (petites papules qui se recouvrent d’une
croûte et guérissent en laissant une cicatrice), qui guérit en quelques mois, et
la forme leucomélanodermique, caractérisée par des troubles pigmentaires qui
apparaissent après plusieurs poussées (taches décolorées sur le cou, les épaules
et les bras). Dans les formes bénignes, aucun traitement n’est nécessaire.
L’exposition solaire améliore les lésions. Dans les formes chroniques, une
PUVA-thérapie peut être utile.
1883. PARAPSORIASIS EN PLAQUES. Maladie cutanée chronique touchant l’adulte,
avec une prédominance masculine. Il existe de nombreuses lésions ovalaires de 2
à 5 cm de diamètre, bien limitées, planes, rose-jaunâtre, avec une desquamation
très fine. Les traitements utilisés sont très décevants.
1884. PARINAUD (SYNDROME DE). Paralysie isolée du regard vers le haut due à une
tumeur ou à un accident vasculaire ischémique touchant une région bien
particulière du tronc cérébral: le prétectum.
1885. PARKER (SYNDROME). Syndrome malformatif comprenant des anomalies
urogénitales (dilatation vésico-urétrale, hydronéphrose, ectopie testiculaire)
et un défaut de musculature abdominale (ventre par endroit recouvert de peau
ridée).
1886. PARKES-WEBER (SYNDROME DE) ou HÉMANGIECTASIE HYPERTROPHIQUE.
Hypertrophie d’un membre associée à des varices, à des angiomes et à des
anévrismes artérioveineux.
1887. PARKINSON (MALADIE DE).
S définition et causes.
Association d’un syndrome parkinsonien et de lésions cérébrales caractérisées
par la perte des neurones dopaminergiques dont la cause est inconnue.
Epidémiologie.
80 000 personnes sont atteintes en France. Le début se situe entre 50 et 65 ans,
sans prédominance de sexe.
Signes et symptômes.
Association d’un tremblement de repos, d’une akinésie (difficulté ou
impossibilité de faire certains mouvements), d’une hypertonie extrapyramidale
(rigidité «plastique» opposant une résistance continue à l’extension du membre,
cédant par petits à-coups), de troubles de la marche et de la posture. Une
dépression, des troubles de la mémoire et du sommeil sont également présents.
Investigations.
Elles sont inutiles, sauf en cas de doute sur le diagnostic.
S évolution, complications et pronostic.
L’évolution initiale est bonne sous traitement: on parle de «lune de miel »,
puis s’installe un déclin moteur avec réapparition du syndrome parkinsonien et
de mouvements anormaux (dyskinésie) pouvant entraîner un confinement au fauteuil
ou au lit.
Traitement.
Le traitement médicamenteux utilise essentiellement la L-dopa , les agonistes
dopaminergiques. Un traitement chirurgical (stimulation électrode par des
électrodes implantées chirurgicalement) peut être proposé dans certains cas
particuliers, notamment chez les sujets jeunes. L’adaptation des prises et
l’association de médicaments doivent permettre une prise en charge individuelle
des fluctuations des effets du traitement.
Prévention et éducation.
Les exercices physiques et de motricité font partie des programmes d’éducation.
Les associations de malades peuvent être d’une grande aide.
1888. PARODONTITE CHRONIQUE.
Définition et causes.
Atteinte infectieuse de la totalité des tissus parodontaux (gencive, ligament parodontal, os alvéolaire, cément). Les facteurs favorisants sont le diabète, une mauvaise hygiène bucco¬dentaire, des lésions due à une prothèse ou des malpositions dentaires.
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente.
Signes et symptômes.
Il existe une inflammation locale, des poches parodontales et une résorption
osseuse qui peut entraîner la perte de la dent.
Investigations.
Les radiographies permettent le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic .
Sans traitement, l’évolution conduit à des pertes dentaires pouvant aller
jusqu’à l’édentation. L’endocardite infectieuse est une complication redoutable.
Traitement. Il comprend une antibiothérapie, le lavage antiseptique des poches
et la chirurgie pour
éliminer les foyers infectieux.
Prévention et éducation.
Une bonne hygiène dentaire et des soins gingivaux réguliers permettent d’éviter
une récidive.
1889. PAROTIDITE. Inflammation de l’une ou des deux glandes parotides. L’origine
est virale (oreillons) ou bactérienne. Dans ce cas, il existe une tuméfaction de
la glande avec un écoulement purulent au niveau du canal de Sténon. La
parotidite bactérienne s’observe soit dans le cadre d’une lithiase salivaire
surinfectée, soit chez des patients immunodéprimés, dénutris, avec une mauvaise
hygiène buccale. Les prélèvements bactériologiques permettent d’adapter le
traitement antibiotique. Parfois, un drainage chirurgical est nécessaire.
1890. PARROT (MALADIE DE) ou (>) ACHONDROPLASIE.
1891. PARSONAGE ET TURNER (SYNDROME DE) . Syndrome caractérisé par l’apparition
brusque d’une violente douleur, suivie d’une paralysie et d’une amyotrophie
(«fonte» rapide des muscles) de l’épaule, accompagnées de troubles de la
sensibilité superficielle. Il survient chez l’adulte jeune et évolue lentement
vers la guérison. Sa cause est inconnue.
1892. PASINI-PIÉRINI (ÉPIDERMOLYSE BULLEUSE DE)(>.) ÉPIDERMOLYSES BULLEUSES
HÉRÉDITAIRES .
1893. PASINI-PIÉRINI (MALADIE DE) ou ATROPHODERMIE IDIOPATHIQUE PRIMITIVE .
Affection cutanée, rare, dont la cause est inconnue. Elle réalise des placards
violacés ou pigmentés, souples, légèrement déprimés, atrophiques, laissant voir
le réseau vasculaire sous¬jacent. Les localisations préférentielles sont le
tronc et la racine des membres. Une association à des plaques de sclérodermie
(plaques d’épaississement et d’induration de la peau) est possible. Les lésions
s’étendent insidieusement, puis se stabilisent et, parfois, régressent. Aucun
traitement n’est efficace.
1894. PASTEURELLOSE.
Définition et causes.
Infection animale due à des bacilles du genre Pasteurella et transmises à
l’homme par griffures ou morsures animales (dans les deux tiers des cas, il
s’agit d’un chat).
Epidémiologie.
C’est une affection assez fréquente du fait du grand nombre d’animaux
domestiques en France.
Signes et symptômes.
La forme cutanéoganglionnaire est la plus fréquente et associe une infection
suppurée localisée et une réaction ganglionnaire satellite. La forme subaiguë
est dominée par des douleurs articulaires, avec une impotence survenant à
distance de la blessure. Une forme septicémique est possible.
Investigations.
Le germe peut être isolé à partir d’un prélèvement de pus ou du sang dans les
formes généralisées. Il existe un sérodiagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Des complications locales sont possibles au niveau des mains (extension aux
gaines tendineuses ou aux articulations). Le traitement antibiotique est
efficace.
Traitement.
L’antibiothérapie utilise l’amoxicilline associé à l’acide clavulanique, un
macrolide ou les cyclines . Dans les formes articulaires chroniques,
l’antigénothérapie est indiquée (intradermo¬réaction à la pasteurelline).
Prévention et éducation.
La prévention repose sur la désinfection et le traitement chirurgical précoce
des morsures, éventuellement associée à une antibiothérapie préventive.
1895. PATAU (SYNDROME DE) ou TRISOMIE 13. Anomalie du nombre de chromosomes dont
l’incidence est de 1/20 000 naissances et augmente avec l’âge maternel. Les
enfants sont petits à la naissance et présentent de nombreuses malformations :
microcéphalie avec un front fuyant, fente labiale et/ou palatine, anomalies des
mains et des pieds. La malformation cardiaque est habituelle et la moitié des
enfants décèdent au cours des premiers mois; seulement 10 % survivent au-delà
d’un an, avec un retard de développement très profond.
1896. PATELLA BIPARTITA ou MALADIE DE GRUBER. Anomalie congénitale caractérisée
par une rotule en deux ou plusieurs morceaux, dont la cause est l’existence d’un
ou de plusieurs points d’ossification supplémentaires. Elle peut faire croire à
une fracture.
1897. PATHOMIMIE. Besoin morbide de simuler, d’imiter une maladie en s’imposant
des symptômes inventés, parfois même au prix d’une automutilation, sans
recherche évidente de profit. Il s’agit d’une maladie hypocondriaque délirante.
Le syndrome de Münchhausen constitue une forme de pathomimie.
1898. PATTERSON-KELLY (SYNDROME DE) ou (>) PLUMMER-VINSON (SYNDROME DE).
1899. PEARSON-ADAMS-DENNY BROWN (SYNDROME DE) .
Inflammation des muscles (myosite) prétibiaux avec présence de myoglobine dans
les urines, survenant après des efforts intenses de danse ou de patinage.
1900. PÉDICULOSE.
Définition et causes.
Atteinte due à différentes sortes de poux, parasites exclusifs de l’homme, qui
est localisée soit à la tête, soit à l’ensemble du corps, soit au pubis
(phtiriase). La contamination se fait par contact direct.
Epidémiologie.
La pédiculose de la tête est endémique dans les écoles primaires. La pédiculose
corporelle s’observe uniquement chez les sujets à hygiène défectueuse. La
phtiriase est considérée comme une maladie sexuellement transmissible.
Signes et symptômes.
Le prurit (démangeaisons) est le principal symptôme. Les lentes sont visibles à
la racine des cheveux ou des poils.
Investigations.
Le diagnostic est clinique.
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est la surinfection, mais elle reste rare.
Traitement.
Il associe l’application d’antiparasitaires (malathion), le peignage soigneux,
le lavage des habits et des draps, ainsi que la décontamination des objets
personnels non lessivables avec une poudre à base de lindane.
Prévention et éducation.
La stratégie de lutte nécessite une bonne coopération et une motivation de
l’ensemble de la communauté scolaire, médicale et administrative.
1901. PELADE. Affection dermatologique comprenant une perte des poils ou des
cheveux (alopécie) caractérisée par des plaques bien circonscrites, propres,
lisses, de forme arrondie. L’évolution est rapide, centrifuge, avec quelques
cheveux en bordure en «point d’exclamation ». La cause est inconnue mais une
cause immunitaire est suspectée. L’évolution se fait en général vers la repousse
en quelques mois, mais certaines formes sont tenaces ou suivies de rechutes. La
corticothérapie locale ou le minoxidil peuvent être efficaces.
1902. PÉLIOSE HÉPATIQUE. Maladie caractérisée par la présence de poches de sang
microscopiques (prolifération et dilatation des sinusoïdes hépatiques) au niveau
du parenchyme hépatique, qui peut aller jusqu’à la congestion et la nécrose. Les
causes peuvent être infectieuses (infection à Rochalimaea henselae au cours du
sida), médicamenteuses (traitement hormonal), toxiques ou tumorales.
1903. PELIZAEUS-MERZBACHER (MALADIE DE). Maladie héréditaire, de transmission
autosomique récessive, caractérisée par une atteinte cérébrale diffuse
(leucodystrophie = existence de zones démyélinisées avec de petits îlots de
fibres nerveuses intactes). Elle débute dès les premiers mois de vie et évolue
lentement. Les principaux signes sont une paraplégie spasmodique progressive,
des troubles de la coordination des mouvements (syndrome cérébelleux) et un
retard mental.
1904. PELLAGRE.
Définition et causes.
Affection due à une carence grave en acide nicotinique (vitamine PP ou B3).
Epidémiologie.
La carence nutritionnelle est rare et se voit surtout chez l’éthylique chronique
et le vieillard. Les maladies provoquant une malabsorption peuvent également
être en cause.
Signes et symptômes.
Il existe des signes cutanés (peau sèche, rouge et épaissie), muqueux (langue
rouge, lèvres douloureuses, fissurées), digestifs (brûlures de la bouche et de
l’œsophage, ballonnement abdominal) et neurologiques (troubles de la mémoire,
désorientation, rigidité des membres, réflexes incontrôlables de succion et de
grasping).
Investigations.
Le diagnostic est essentiellement clinique. Le dosage des métabolites urinaires
de l’acide nicotinique peut être utile.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est bonne sous traitement. Les carences en vitamines du groupe B et
en protéines sont souvent associées.
Traitement.
Il comprend l’administration de vitamine PP per os ou par voie parentérale, en
association avec les autres vitamines du groupe B.
Prévention et éducation.
L’apport systématique au long cours de vitamines chez les patients à risque,
notamment chez les éthyliques chroniques, permet une prévention efficace.
1905. PELLEGRINI-STIEDA (MALADIE DE). Ossification du ligament latéral interne
du genou due à une production osseuse anormale post-traumatique développée à
partir du condyle interne du fémur. D’autres localisations sont possibles
(épaule, coude, cheville, rotule).
1906. PELVISPONDYLITE RHUMATISMALE ou (>) SPONDYLARTHRITE ANKYLOSANTE.
1907. PEMPHIGOÏDE BULLEUSE.
Définition et causes.
Maladie cutanée d’origine auto-immune. On retrouve des anticorps dirigés contre
la membrane basale de l’épiderme, à l’origine des bulles.
Epidémiologie.
Relativement fréquente. Touche essentiellement le sujet âgé.
A signes et symptômes.
Il existe un prurit (démangeaisons) avec des bulles tendues, de taille variable,
reposant sur une peau rouge, cedématiée.
Investigations.
La biopsie permet de faire le diagnostic et de retrouver, notamment, des
anticorps dirigés contre la membrane basale. La numération formule sanguine
retrouve une hyperéosinophilie.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution sous traitement est satisfaisante. Les principales complications
sont les surinfections et les pertes hydroélectrolytiques.
Traitement.
Les corticoïdes par voie générale et les soins d’antisepsie cutanée sont la base
du traitement. Un traitement immunosuppresseur peut être associé dans les formes
résistantes.
1908. PEMPHIGOÏDE GESTATIONIS.
Définition et causes.
Affection cutanée survenant au cours de la grossesse et du post-partum,
caractérisée par une urticaire et des bulles. Son origine est auto-immune.
Epidémiologie.
Elle complique 1 grossesse sur 30 000 à 60000.
Signes et symptômes.
L’éruption, très prurigineuse (qui gratte), débute au niveau de l’ombilic puis
s’étend secondairement au tronc et aux membres.
Investigations.
Le diagnostic est affirmé par la biopsie cutanée (dépôts de complément à la
jonction dermoépidermique) et sur la présence d’une IgG appelée herpes
gestationis factor dans le sérum.
Evolution, complications et pronostic.
L’éruption cède, en général, après l’accouchement et récidive lors des
grossesses ultérieures. Le pronostic maternel et fœtal est bon.
Traitement.
Les corticoïdes entraînent une régression des signes.
1909. PEMPHIGUS CHRONIQUE BÉNIN FAMILIAL ou MALADIE DE HAILEY-HAILEY.
A définition et causes.
Maladie héréditaire cutanée, transmise sur le mode autosomique dominant. Elle
est due à une déficience génétique de la cohésion entre les cellules
épidermiques.
A épidémiologie.
Rare. Elle se manifeste, en général, à l’adolescence ou chez l’adulte jeune.
Signes st symptômes.
Les lésions sont des plaques rouges, surélevées, prurigineuses (qui grattent)
qui peuvent se transformer en bulles. Les localisations préférentielles sont les
plis inguinaux, génitocruraux, axillaires, et le cou.
Investigations.
La biopsie permet le diagnostic.
Évolution, complications et pronostic.
Les lésions sont bénignes mais chroniques et tenaces. Elles peuvent se fissurer
et se surinfecter.
Traitement.
Les corticoïdes associés aux antiseptiques non irritants améliorent les lésions.
Parfois, une excision-greffe est nécessaire.
1910. PEMPHIGUS VULGAIRE.
A définition et causes.
Maladie cutanéomuqueuses d’origine auto-immune. La cause est inconnue. Le
mécanisme responsable des lésions est l’acantholyse: dislocation des connexions
intercellulaires épidermiques entraînant la formation de bulles.
Epidémiologie.
Peu fréquent. Apparaît plutôt après 50 ans.
Signes et symptômes.
Au début, quelques bulles apparaissent sur la peau, puis le pemphigus se
généralise avec des bulles qui se rompent, laissant des érosions rouges,
douloureuses. Il existe également des érosions muqueuses buccales, voire de
toute la sphère ORL, douloureuses, gênant l’alimentation.
Investigations.
Le signe de Nikolsky (décollement facile de l’épiderme du plan cutané
sous-jacent) est typique. La biopsie permet le diagnostic, notamment avec la
mise en évidence d’autoanticorps.
A évolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement, l’évolution est constamment mortelle en 6 à 18 mois.
Sous traitement, la mortalité est estimée à 10 % et est principalement liée aux
infections et aux effets secondaires du traitement.
Traitement.
Les corticoïdes par voie générale et les soins d’antisepsie cutanée sont la base
du traitement. En cas d’échec, on utilise des immunosuppresseurs).
1911. PENA-SHOKEIR (SYNDROME DE) . Ensemble de malformations dont la première
manifestation est une immobilité fœtale avec une absence des mouvements de
déglutition induisant un hydramnios (augmentation du volume de liquide
amniotique). Les conséquences sont une hypoplasie pulmonaire (développement
insuffisant des poumons), des malformations des mains, des pieds et de la face.
Environ 30 % des enfants sont mort-nés et une majorité des enfants nés vivants
décèdent en quelques semaines du fait de problèmes respiratoires. Dans la moitié
des cas, il s’agit d’un syndrome autosomique récessif; dans d’autres cas, on
retrouve une myasthénie (>) maternelle.
1912. PENDRED (SYNDROME DE) . Affection héréditaire, probablement de
transmission autosomique récessive. Elle est caractérisée par une surdité,
compliquée parfois d’une mutité, et d’un goitre apparaissant dans la deuxième
enfance et qui peut s’accompagner de signes d’hypothyroïdie.
1913. PÉPOME. Tumeur pancréatique sécrétant une hormone particulière, le
polypeptide pancréatique dont le rôle reste obscur. La symptomatologie n’est pas
liée à cette hypersécrétion hormonale, mais
au volume de la tumeur. Le diagnostic est assuré par le dosage hormonal. Le
traitement utilise la chirurgie et/ou la chimiothérapie.
1914. PÉRIARTÉRITE (ou PANARTÉRITE) NOUEUSE (PAN).
Définition et causes.
Angéite nécrosante (inflammation vasculaire) touchant les artères de petit et/ou
de moyen calibre dont la cause est inconnue. Il existe deux formes particulières
: l’angéite de Churg et Strauss (>) et la PAN liée au virus de l’hépatite B.
Epidémiologie.
La prévalence est de 6,3/100000 avec une atteinte préférentielle des adultes
entre 40 et 60 ans.
Signes et symptômes.
La présence de plus de 5 des critères de L. Guillevin permet de faire le
diagnostic: altération de l’état général, fièvre, multinévrite, asthme grave
récent, cardiomyopathie primitive, purpura infiltré et/ou nodules sous-cutanés,
polyarthrite, myalgies, artériopathie distale, orchite non infectieuse,
néphropathie vasculaire et/ou glomérulaire, crises douloureuses abdominales,
hypertension artérielle, accident neurologique central, syndrome inflammatoire.
Investigations.
La biologie montre un syndrome inflammatoire et permet la recherche de l’AgHBe
et des anticorps anticytoplasme des polynucléaires neutrophiles (ANCA).
L’artériographie retrouve de multiples microanévrismes et l’histologie montre
une nécrose fibrinoïde de la média.
Evolution, complications et pronostic.
La plupart du temps, les formes aiguës sont contrôlées parle traitement et
guérissent en deux ans. Il existe 5 % de formes suraiguës rebelles au
traitement.
Traitement.
Il est fondé sur les corticoïdes, sauf dans les formes liées au virus de
l’hépatite B pour lesquelles on utilisera les échanges plasmatiques et les
agents antiviraux (lamivudine). Dans les formes sévères, on aura recours aux
immunosuppresseurs et aux échanges plasmatiques.
1915. PÉRIARTHRITE DE LA HANCHE. Affection douloureuse chronique liée à une
inflammation des structures périarticulaires de la hanche. Elle survient surtout
chez la femme entre 40 et 60 ans. Le signe essentiel est une douleur à la
pression du grand trochanter et à l’abduction contrariée de la hanche. Elle est
augmentée à la marche et calmée par le repos. La mobilité reste normale. Les
infiltrations locales de corticoïdes sont efficaces.
1916. PÉRIARTHRITE SCAPULO-HUMÉRALE . Douleurs de l’épaule, avec ou sans
raideur, sans altération radiologique de l’articulation entre l’omoplate et
l’humérus, qui proviennent essentiellement des tendons, des muscles et des
bourses périarticulaires. Cette appellation regroupe plusieurs affections :
épaule douloureuse simple (>), épaule bloquée ou gelée (>) ou capsulite
rétractile, rupture de la coiffe des rotateurs (>) et épaule douloureuse aiguë
(>) .
1917. PÉRICARDITE AIGUË.
Définition et causes.
Inflammation aiguë provoquant un épanchement liquidien dans le péricarde. Les
causes, par ordre de fréquence, sont un virus, un cancer, une maladie de
système, une septicémie, une tuberculose.
Epidémiologie.
La forme virale la plus fréquente s’observe à tout âge, avec une légère
prédominance masculine.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont une fièvre modérée, une douleur thoracique aggravée
par la toux et les mouvements respiratoires, et une dyspnée permanente, de
repos. L’auscultation retrouve souvent un frottement péricardique, d’intensité
variable, parfois mieux entendu en position penchée en avant.
Investigations.
La radiographie de thorax montre un élargissement de la silhouette cardiaque et
l’électrocardiogramme des troubles diffus de la repolarisation, avec un
microvoltage en cas d’épanchement abondant. L’échographie cardiaque confirme le
diagnostic et quantifie l’épanchement.
Evolution, complications et pronostic.
La forme virale est bénigne. La principale complication est l’augmentation de
l’épanchement avec le passage en tamponnade (>) qui peut entraîner un arrêt
cardiaque. La récidive est possible avec l’évolution vers une forme chronique.
Traitement.
Le traitement de la forme virale associe le repos et les anti-inflammatoires non
stéroïdiens. Dans les autres cas, c’est celui de la cause. En cas de mauvaise
tolérance, un drainage chirurgical est indiqué.
1918. PÉRICARDITE CHRONIQUE CONSTRICTIVE.
Définition et causes.
Épaississement du péricarde, plus ou moins calcifié, qui le transforme en un sac
inextensible s’opposant au remplissage des ventricules en diastole (adiastolie).
Les causes les plus fréquentes sont la tuberculose et les séquelles de
radiothérapie, mais toute péricardite subaiguë peut également en être à
l’origine.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont une asthénie, une dyspnée d’effort, une distension
des veines du cou, une hépatomégalie, des œdèmes des membres inférieurs et,
parfois, une ascite.
Investigations.
L’échographie ne permet pas toujours de faire le diagnostic, le scanner et l’IRM
permettent plus facilement de mettre en évidence l’épaississement péricardique.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est variable. Parfois, le traitement médical suffît; dans d’autres
cas, une intervention chirurgicale s’impose.
Traitement.
Le traitement médical associe celui de l’insuffisance cardiaque et celui de
l’éventuelle tuberculose. En cas d’indication chirurgicale, on réalise une
péricardectomie (ablation du péricarde).
1919. PÉRICHONDRITE DU PAVILLON DE L’OREILLE
Définition et causes.
Infection du périchondre qui est l’enveloppe autour du cartilage qui assure sa
vascularisation. La cause la plus fréquente est un traumatisme, une piqûre
d’insecte ou un geste chirurgical. Le germe le plus souvent en cause est le
bacille pyocyanique.
Signes et symptômes.
Il existe une inflammation du pavillon de l’oreille avec une rougeur, une
chaleur et une augmentation de volume. Une fièvre est parfois présente.
Investigations.
Le prélèvement local lors du geste chirurgical permet d’identifier le germe.
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est une nécrose du cartilage avec une déformation de
l’oreille.
Traitement.
Le traitement associe les antibiotiques et un drainage-aspiration chirurgical.
1920. PÉRICORONARITE . Inflammation des tissus mous qui entourent la couronne
d’une dent incluse normalement dans le maxillaire (dent de sagesse). Les
principaux signes sont une contracture de la mâchoire (trismus) et une
congestion de la gencive, douloureuse à la palpation. Dans la plupart des cas,
un traitement antibiotique, suivi de l’extraction de la dent incluse, permet la
guérison. La principale complication est la cellulite de la face.
1921. PÉRIHÉPATITE AIGUË ou (–>) FITZ-HUGH ET CURTIS (SYNDROME DE) .
1922. PÉRIODONTITE.
Définition est causes.
Infection de la membrane alvéolodentaire, secondaire le plus souvent à une carie
profonde.
Epidémiologie.
Elle représente 60 % des foyers infectieux dentaires.
Signes et symptômes.
Douleur d’apparition brutale, très intense, irradiant à l’hémiface, exacerbée
par la pression de la dent. À l’examen, la dent est mobile, douloureuse à la
percussion.
Investigations.
La radiographie rétroalvéolaire ou le panoramique permettent le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Sans traitement, l’évolution se fera vers une extension locale avec abcès
sous-périosté, cellulite ou granulome apical. L’endocardite infectieuse est une
complication redoutable.
Traitement.
C’est un traitement d’urgence associant chirurgie dentaire et antibiothérapie.
1923. PÉRIONYXIS.
Définition et causes.
Inflammation des replis autour de l’ongle. Il peut être aigu et succéder à un traumatisme local. La forme chronique se rencontre chez les personnes qui ont les mains toujours immergées (femmes de ménage, métiers de la restauration…) ou chez les diabétiques.
Epidémiologie.
Affection fréquente, avec une nette prédominance féminine.
Signes et symptômes.
Dans la forme aiguë, la pression de l’ongle fait sourdre une goutte de pus. Dans
la forme chronique, le repli sous-unguéal est tuméfié et sensible, laissant un
espace béant. L’ongle est habituellement atteint (onyxis).
Evolution, complications et pronostic. Les principales complications sont les
surinfections (bactéries et champignons) et l’évolution vers le panaris (>).
Traitement.
Dans la forme aiguë, le drainage par piqûre au scalpel fin et la mise sous
antibiotiques suffisent en général. Dans la forme chronique, le traitement
repose essentiellement sur l’interruption des occupations en cause ou le port de
gants doublés. Les surinfections nécessitent des antibactériens ou des
anticandidosiques locaux pendant plusieurs semaines.
1924. PÉRIOSTITE. Terme général désignant toutes les inflammations aiguës ou
chroniques du périoste, membrane fibreuse recouvrant l’os. Elles s’accompagnent
en général d’ostéite (>).
1925. PÉRITONITE AIGUË.
Définition et causes.
Inflammation ou infection aiguë brutale et diffuse du péritoine due, le plus
souvent, à une perforation d’un organe infecté ou, plus rarement, à une
diffusion bactérienne sans rupture viscérale. Elle peut également se déclarer en
postopératoire (lâchage de suture ou contamination).
Epidémiologie.
Elle est très fréquente et représente la principale urgence abdominale.
Signes et symptômes.
Il existe une douleur abdominale localisée généralisée avec une contracture
(contraction rigide, permanente et douloureuse des muscles de la paroi à la
palpation = « ventre de bois »). Les touchers pelviens déclenchent une douleur
intense au cul-de-sac de Douglas.
Investigations.
Les clichés d’abdomen sans préparation centrés sur les coupoles recherchent de
l’air dans le péritoine (pneumopéritoine) et des niveaux hydroaériques.
L’échographie et le scanner retrouvent un épanchement liquidien plus ou moins
abondant.
Evolution, complications et pronostic.
En l’absence de traitement, l’évolution se fait vers un choc septique avec une
défaillance multiviscérale. Le pronostic dépend de la rapidité de mise en œuvre
du traitement.
Traitement.
Il est avant tout chirurgical, associé à une réanimation adéquate. Le traitement
médical isolé, avec uniquement une antibiothérapie, reste l’exception dans les
cas sans rupture viscérale.
1926. PERLÈCHE . Érosion inflammatoire avec fissure des commissures labiales.
Elle est fréquente chez le sujet âgé et est souvent due à des problèmes
dentaires (prothèse mal adaptée, édentation). Une surinfection aggrave les
lésions. Outre le traitement de la cause (pas toujours réalisable),
l’application d’acide trichloracétique donne de bons résultats.
1927. PERTHES-JONGLING (MALADIE DE) ou OSTÉITE POLYKYSTIQUEDE JÜNGLING .
Localisation aux os des doigts et des orteils de la sarcoïdose (>). Elle se
manifeste par un gonflement, une douleur, des nodosités juxtaarticulaires et de
petites bulles intra-osseuses bien visibles sur les radiographies.
1928. PESTE.
Définition et causes.
Maladie infectieuse aiguë due au bacille Yersinia pestis, qui est transmise par
les piqûres de puces (ou de poux) ou par inhalation de gouttelettes de salive
d’un malade atteint d’une forme pulmonaire. L’incubation est de 2 à 5 jours.
Epidémiologie.
Elle sévit de manière sporadique dans diverses régions du monde. La dernière
épidémie a eu lieu en Inde en 1994. Quelques cas ont été signalés en Algérie
pendant l’été 2003.
Signes et symptômes.
La peste bubonique, la plus fréquente, associe des adénopathies inguinales très
douloureuses et entourées d’un gros œdème à une fièvre élevée et, parfois, des
troubles de la conscience. La peste pulmonaire associe fièvre, toux et
expectorations de grains sanguinolents. La peste septicémique peut compliquer
les formes précédentes ou survenir d’emblée et associe un état de choc et un
syndrome hémorragique grave.
Investigations.
L’isolement du germe se fait sur le sang, les crachats et les prélèvements de
ganglions.
Evolution, complications et pronostic.
Si le traitement est immédiat, la mortalité est faible; sinon, elle peut
atteindre 60 à 100 % en quelques heures à quelques jours.
Traitement.
L’antibiotique utilisé est la streptomycine.
Prévention et éducation.
La contagiosité est très importante et impose l’isolement du malade en milieu
hospitalier. La prévention repose sur la lutte contre les puces et les rats.
1929. PETERS (SYNDROME DE). Anomalie congénitale de la partie avant de l’ceil
s’accompagnant d’une opacité de la cornée et de lésions de l’iris (synéchies ou
accolements antérieurs). L’atteinte est souvent bilatérale, entraînant une perte
presque totale de la vision.
1930. PETGES-CLÉJAT (MALADIE DE) ou POTKILODERMATOMYOSITE.
Forme de dermatomyosite (>) associant une atrophie cutanée (avec des
télangiectasies et une pigmentation donnant à la peau un aspect bigarré) et une
atrophie musculaire prédomi nant au niveau des épaules et des hanches.
1931. PÉTROSITE GRANULOMATEUSE. Atteinte inflammatoire osseuse intéressant la
partie antéro-interne du rocher (apex pétreux). Les symptômes sont des
céphalées, des troubles de l’audition et de l’équilibre, ainsi que des signes en
lien avec une atteinte de certains nerfs crâniens. Le scanner et l’IRM
permettent le diagnostic. Le traitement est chirurgical.
1932. PEUTZ-JEGHERS (SYNDROME DE).
Définition et causes.
Maladie génétique du groupe des phacomatoses (>), de transmission autosomique
dominante, associant une lentiginose périorificielle et une polypose digestive.
Épidémiologie.
Rare.
Signes et symptômes.
La lentiginose se présente sous la forme de taches brûnatres, de 1 à 2 mm de
diamètre, péribuccales et urogénitales, apparaissant dès le plus jeune âge et
augmentant en nombre au cours des années, alors que leur pigmentation diminue.
Les polypes se retrouvent au niveau de l’ensemble du tube digestif.
Investigations.
L’endoscopie permet d’explorer le tube digestif.
Evolution, complications et pronostic.
Des occlusions ou des hémorragies digestives sont possibles. La cancérisation
des polypes survient dans 2 à 3 % des cas.
Traitement.
Une intervention sur les polypes est nécessaire en cas de complications.
Prévention et éducation.
Le conseil génétique est recommandé.
1933. PFAPA SYNDROME ou (>) FAPA SYNDROME.
1934. PFEIFFER (SYNDROME DE). Malformation squelettique caractérisée par une
malformation de la tête (aplatie d’avant en arrière et très développée en
hauteur), des anomalies de la face et une soudure discrète des doigts
(syndactylie), avec de longs orteils et des pouces larges.
1935. PHACE SYNDROME. Acronyme utilisé pour un ensemble de malformations de la
fosse postérieure, de grands hémangiomes faciaux, des anomalies artérielles,
cardiaques (incluant une coarctation aortique), et oculaires (eye). Dans
certains cas, un défaut du développement ventral est présent (incluant une fente
sternale), auquel cas le syndrome s’appelle PHACES. Ce syndrome touche
essentiellement des filles. Le pronostic dépend de la sévérité des signes
cliniques dans le cas d’anomalies cérébrales ou artérielles; des séquelles
neurologiques (tel un retard du développement ou des convulsions) sont très
fréquentes.
1936. PHACOMATOSES. Elles regroupent toutes les entités, souvent héréditaires,
caractérisées parla présence d’anomalies plus ou moins diffuses du développement
et liées à une évolution anormale (dysplasie blatomateuse) des feuillets
embryonnaires. Selon le feuillet, la classification distingue des phacomatoses
ectoblastiques, mésoblastiques et entoblastiques
Phacomatoses ectoblastiques : (tissu nerveux, épithélium sensitif de l’oreille,
du nez et de l’oeil, épiderme et phanères, glande mammaire, antéhypophyse,
glandes sous-cutanées, émail des dents)
• Sclérose tubéreuse de Bourneville
• Neurofibromatoses
• Syndrome de Gorlin
• Syndrome de Sipple
• Nævomatose basocellulaire
• Mélanose neurocutanée
• Nævus linéaire
• Nævus d’Ota
Phacomatoses mésoblastiques : (tissu conjonctif, cartilages, os, muscles, coeur,
vaisseaux, cellules sanguines, lymphatiques, reins, gonades, péricarde, plèvre,
péritoine, rate, surrénale)
• Maladie de Von Hippel-Lindau
• Syndrome de Sturge-Weber
• Maladie de Rendu-Osler
• Syndrome de Wyburn-Mason
• Syndrome de Bean
• Maladie de Mafucci
• Syndrome de Cobb
• Syndrome de Klippel-Trénaunay
• Glomangiomatoses
• Ataxie-télangiectasies
• Syndrome de Gardner
• Syndrome d’Albright
• Léiomyomatose
• Lipomatose multiple
• Lipomatose neuroméningée
Phacomatoses entoblastiques : (épithélium du tube digestif, des voies
respiratoires, de la vessie, de l’urètre, de l’oreille moyenne et de la trompe
d’Eustache; parenchyme amygdalien, thyroïdien, parathyroïdien, thymus, foie et
pancréas)
• Syndrome de Gardner
• Syndrome de Peutz-Jeghers
• Syndrome de Turcot .
1937. PHARYNGITE. Inflammation aiguë de la muqueuse pharyngée. On distingue la
rhinopharyngite (>) et l’amygdalite ou angine (>).
1938. PHÉNYLCÉTONURIE.
Définition et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique récessive, caractérisée par un
trouble du métabolisme d’un acide aminé, la phénylalanine, dû à un déficit
enzymatique.
Epidémiologie.
La fréquence est de 1/15000 naissances.
Signes et symptômes.
Aucune anomalie n’est présente à la naissance, mais un retard mental se
développe progressivement.
Investigation.
On dose le taux de phénylalanine dans le sang.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait vers une arriération mentale grave en l’absence de
traitement. Le pronostic est d’autant meilleur que le traitement a été précoce.
Traitement.
Il consiste en un régime pauvre en phénylalanine : remplacement des protéines
par des mixtures à base d’acides aminés sans phénylalanine.
Prévention.
Le test de Guthrie (recherche du déficit enzymatique) effectué pour tous les
nouveau-nés à la fin de la première semaine de vie permet un dépistage
systématique.
1939. PHÉOCHROMOCYTOME.
Définition et causes.
Tumeur qui est développée le plus souvent à partir de la médullosurrénale ou,
plus rarement, à partir de résidus embryonnaires extra-surrénaux et qui sécrète
des catécholamines (adrénaline et noradrénaline), qui jouent un rôle essentiel
dans la régulation de la pression artérielle.
Epidémiologie.
II est responsable de 0,1 à 1 % des causes d’hypertension artérielle. Se
développe le plus souvent chez l’adulte sans prédominance de sexe.
Signes et symptômes.
Il s’agit soit d’une hypertension artérielle paroxystique, dont les crises sont
déclenchées par un effort, des médicaments ou des émotions et dont la durée est
d’environ une heure, soit d’une hypertension artérielle permanente, qui peut
également être entrecoupée de paroxysmes. L’hypotension orthostatique est
fréquente.
Investigations.
Le diagnostic repose sur les dosages urinaires et plasmatiques des
catécholamines et de leurs métabolites et sur l’imagerie, scanner, IRM et
scintigraphie à la MIBG pour localiser la tumeur.
Evolution, complications et pronostic.
Les complications sont celles de l’hypertension artérielle (rétinopathie,
infarctus du myocarde, hémorragie cérébrale). Le pronostic est sombre dans les
formes malignes.
Traitement.
Il est chirurgical après préparation médicale pour éviter une crise
hypertensive.
1940. PHIMOSIS. Rétrécissement du prépuce gênant la découverte du gland. Il
expose aux infections et à une complication mécanique, le paraphimosis, qui est
un étranglement du gland par l’anneau du prépuce avec impossibilité de
recalotter. Le traitement consiste en une circoncision chirurgicale. Il est, le
plus souvent, congénital mais peut être acquis (séquelles d’inflammation).
Devant un phimosis acquis chez le vieillard, il faut rechercher un cancer
sous-jacent.
1941. PHLÉBITE ou (>) THROMBOSE VEINEUSE PROFONDE
1942. PHLEGMATIA CAERULEA DOLENS. Variété de phlébite (>) compliquée d’un spasme
artériel. Elle est caractérisée par la brutalité de son début, l’intensité de la
douleur, un œdème accompagné de cyanose et d’une peau froide. L’évolution est
souvent grave, avec un collapsus et une gangrène.
1943. PHLEGMON DE L’AMYGDALE.
Définition et causes.
Collection suppurée localisée entre l’amygdale et le muscle constricteur du
pharynx, qui est le plus souvent une complication de l’amygdalite aiguë.
Epidémiologie.
Il est rare chez l’enfant mais fréquent chez l’adulte jeune.
Signes et symptômes.
Le tableau associe une fièvre avec une altération de l’état général, une douleur
sévère à la déglutition (dysphagie), une contracture des muscles de la mâchoire
(trismus) avec une limitation de l’ouverture de la bouche et une position
antalgique du cou penchée du côté atteint. L’examen retrouve une tuméfaction du
pilier antérieur de l’amygdale.
Investigations.
Le diagnostic est clinique.
Evolution, complications et pronostic.
Une extension avec cellulite locale est possible, ainsi qu’une septicémie.
Traitement.
Il associe une antibiothérapie et un éventuel drainage chirurgical.
Prévention et éducation.
La prévention des récidives implique l’amygdalectomie au décours d’un épisode
aigu.
1944. PHOBIE SOCIALE Il s’agit d’une peur persistance et intense d’une ou
plusieurs situation sociales, plus ou moins nombreuses et précises, qu’il ne
faut pas confondre avec la timidité. En effet, dans la phobie sociale, les
répercussions de l’anxiété et des évitements constituent des handicaps.
L’association à un autre trouble psychiatrique est fréquente. Les traitements
préventifs comprennent la psychothérapie cognitivo-comportementale ou certains
antidépresseurs.
1945. PHOTODERMATOSE MÉDICAMENTEUSE. La photosensibilité est une réaction
anormale de la peau à la lumière: éruption très prurigineuse (qui gratte),
érythémateuse (rouge) et recouvertes de petites vésicules existant sur les zones
de peau exposées à la lumière. De nombreux médicaments, administrés par voie
locale ou générale, peuvent être à l’origine de cette réaction.
1946. PHTIRIASE ou (>) PÉDICULOSE.
1947. PHYCOMYCOSES. Terme générique correspondant à de nombreuses maladies dues
à la présence de filaments mycéliens (champignons) non cloisonnés dans les
tissus. Il existe des formes sous-cutanées observées dans le Sud-Est asiatique
avec de multiples tuméfactions sous-cutanées grotesques du cou et du thorax,
spontanément résolutives. La forme rhinocérébrale (mucormycose) s’observe chez
les patients immunodéprimés et les diabétiques en acidocétose. Elle est
généralement fatale avec un envahissement ORL et cérébral.
1948. PIAN.
Définition et causes.
Infection non vénérienne due à un tréponème, Treponema pallidum pertenue, très
proche de celui de la syphilis. La transmission s’effectue par contact direct
avec des plaies infectées. La période d’incubation est de plusieurs semaines.
Epidémiologie.
Elle se rencontre dans les régions intertropicales, touche surtout l’enfant
jeune et est favorisée par le manque d’hygiène.
Signes et symptômes.
La lésion primaire est une ulcération unique, en général au niveau des jambes.
Puis apparaît une éruption généralisée avec des granulomes qui guérissent
spontanément.
Investigations.
Le tréponème peut être visualisé à partir de prélèvements des lésions; les
réactions sérologiques sont croisées avec celles de la syphilis.
Évolution, complications et pronostic.
La lésion initiale guérit en général en 6 mois. Les lésions tardives (au-delà de
cinq ans) sont extensives et souvent destructrices, en particulier au niveau de
la face.
Traitement.
L’antibiothérapie par pénicilline est très efficace.
Prévention.
La prévention consiste à traiter les sujets atteints et à améliorer les
conditions d’hygiène.
1949. PIBIDS SYNDROME ou (>) IBIDS SYNDROME .
1950. PICK (MALADIE DE).
Définition et causes.
Démence de la période présénile appartenant au groupe des démences frontales et
caractérisée par une atrophie circonscrite aux lobes frontaux et aux
circonvolutions temporales. La cause est inconnue.
Epidémiologie.
L’âge de survenue est de 50 à 60 ans. L’ensemble des démences frontales
représentent 15 % des démences dégénératives préséniles.
Signes et symptômes.
Le début est insidieux et progressif, associant des troubles du comportement
(altération de la personnalité, désinhibition et hyperactivité) et des troubles
du langage (réduction progressive de la parole).
Investigations.
Elles comprennent le scanner et l’IRM.
Evolution, complications et pronostic.
Comme dans la maladie d’Alzheimer, l’évolution est lente et inexorable vers le
décès, avec une durée moyenne de sept ans.
Traitement.
Le traitement est uniquement palliatif (psychotropes pour les troubles du
comportement, orthophonie pour les troubles du langage).
1951. PICK-HERXHEIMER (MALADIE DE) ou (>) ACRODERMATITE ATROPHIANTE CHRONIQUE.
1952. PICKWICK (SYNDROME DE). Forme d’apnée du sommeil (4), de type obstructif
(blocage de la voie aérienne supérieure malgré une commande nerveuse normale),
touchant des sujets obèses qui ont tendance à dormir sur le dos.
1953. PIÉBALDISME. Variété d’albinisme héréditaire, de transmission autosomique
dominante, caractérisée par l’association d’une mèche de cheveux blancs et d’une
hypopigmentation touchant le front, la racine du nez et la face antérieure du
tronc.
1954. PIED D’ATHLÈTE ou INTERTRIGO DES ORTEILS.
Définition et causes.
Infection cutanée du groupe des dermatophyties due à un champignon,
Trichophyton, de transmission interhumaine par la marche pieds nus dans un local
contaminé (piscine, salle de sport, salle de bain…).
Epidémiologie.
C’est la plus fréquente des dermatophyties. Elle est favorisée parla chaleur et
l’humidité, responsables d’une macération, et par les microtraumatismes.
Signes et symptômes.
Il peut exister une simple desquamation, des bulles ou une macération blanchâtre
et douloureuse touchant, de préférence, les derniers espaces interorteils.
Investigations.
L’examen direct et la mise en culture d’un prélèvement local retrouvent le
champignon.
Evolution, complications et pronostic.
Une surinfection bactérienne est possible (érysipèle de jambe).
Traitement.
Il utilise les antifongiques locaux. La griséofulvine ou le kétoconazole par
voie générale sont préconisés en cas d’échec.
Prévention et éducation.
La prévention comprend des soins d’hygiène (séchage attentif, poudre
anti-transpiration, lavage des tapis de bains, changement de chaussures…).
1955. PIED-BOT. Malformation congénitale, assez souvent bilatérale, qui serait
due à une malposition du fœtus in utero. Le pied est en varus équin (tourné en
dedans, avec la pointe vers le bas), avec un bord interne incurvé, la plante qui
regarde en dedans et une rétraction du tendon d’Achille. La correction
s’effectue dès la naissance par des manipulations et la mise en place de plâtres
successifs. La chirurgie s’impose si la malformation persiste après l’âge de
deux ans.
1956. PIED D’IMMERSION ou PIED DES TRANCHÉES. Lésions des tissus musculaires et
nerveux au niveau du pied qui s’observe chez les naufragés ou les soldats dont
les pieds ont été mouillés, sans être gelés, pendant de longues périodes. Les
symptômes sont un engourdissement, des fourmillements douloureux et des crampes
dans les jambes. Initialement les pieds sont pales, sans pouls, puis ils
deviennent rouges, enflés etdouloureux lors du réchauffement dans un
environnement sec. À ce stade, un refroidissement peut être utile. Des séquelles
à type de troubles de la sensibilité au froid et de douleurs peuvent persister
pendant plusieurs années.
1957. PIEDS-MAINS-BOUCHE (SYNDROME) Il s’agit d’une atteinte cutanéomuqueuse
liée à une infection par virus Coxsackie (groupe des entérovirus). Tous les âges
peuvent être touchés, avec une prédominance chez les enfants. Au niveau de la
bouche, on observe macules rouges évoluant vers des vésicules puis des
ulcérations. L’éruption cutanée vésiculeuse atteint les pieds et les mains. Les
lésions régressent en une dizaine de jours.
1958. PIEDRA Mycose des cheveux. La piedra blanche est due à Trichosporon
beigelii, qui se manifeste par des nodules de couleur blanchâtre, plutôt mous,
au niveau des cheveux et des poils. La piedra noire, due à Piedraia hortai, se
présente sous la forme de nodules de couleur brun-noir, très durs, adhérents aux
cheveux; elle sévit dans les régions tropicales.
1959. PIERINI-PASINI (ATROPHODERMIE IDOPATHIQUE DE) (>) PASINI-PIERINI (MALADIE
DE).
1960. PIERRE-MARIE-BAMBERGER (SYNDROME DE) ou (>) OSTÉOARTHROPATHIE
HYPERTROPHIANTE PNEUMIQUE.
1961. PIERRE ROBIN (SYNDROME DE).
Définition et causes
Syndrome associant un défaut de développement du massif facial et des troubles
fonctionnels de la succion et de la déglutition. Il s’agit d’une anomalie
embryonnaire, parfois intégré dans un syndrome polymalformatif, dont la cause
est inconnue.
Signes et symptômes
La triade caractéristique associe:
• Un microrétrognathisme (mandibule de petite taille) ;
• Une chute de la langue en arrière;
• Une fente palatine. Les troubles sont d’importance variable: difficultés de
succion et de déglutition, reflux gastrocesophagien, malaise avec bradycardie,
dyspnée obstructive et pauses respiratoires.
Evolution, complications et pronostic
Initialement, les complications sont liées aux troubles de la respiration et de
l’alimentation. À long terme, il existe des séquelles (retard psychomoteur,
surdité) dans la moitié des cas.
Traitement
Il est variable selon les formes : simple stimulation de la succion, gavage,
intubation… La réparation de la fente palatine se fera au cours de la première
année.
1962. PILI ANNULATI Anomalie héréditaire des cheveux, de transmission
autosomique dominante. Les cheveux ont un aspect sablé et une brillance
attractive. La cause est un trouble de la croissance des cheveux avec
l’inclusion d’air dans certaines zones de leur tige.
1963. PILI TORTI. Anomalie congénitale et presque toujours familiale des cheveux
qui, dès leur apparition, ont une apparence laineuse, moirée, due à la torsion
du cheveu sur lui-même. Vers la puberté, la chevelure reprend peu à peu son
aspect normal.
1964. PILOMATRICOME. Tumeur bénigne du follicule pileux qui se présente sous la
forme d’un nodule unique dur, quelquefois douloureux et ulcéré, situé au niveau
des membres supérieurs, de la face et du cou. Elle survient, le plus souvent,
chez des sujets jeunes (moins de 20 ans dans la moitié des cas). L’évolution est
bénigne et le seul traitement est l’ablation chirurgicale.
1965. PINTA ou CARATÉ. Infection non vénérienne de la peau, présente en
Amérique, due à un tréponème, Treponema carateum, très proche de celui de la
syphilis. La transmission se fait par contact direct. La lésion initiale siège
au niveau du visage, du cou ou des fesses et est suivie d’une éruption un mois à
un an après, sous forme de plaques qui évoluent vers une dépigmentation donnant
à la peau un aspect marbré. Le traitement par la pénicilline est très efficace.
1966. PITHIATISME. État pathologique se manifestant chez certains sujets par des
troubles qu’il est possible de reproduire par suggestion avec une exactitude
parfaite et qui sont susceptibles de disparaître sous l’influence de la
persuasion seule.
1967. PITYRIASIS LICHENOIDE ou (–>) PARAPSORIASIS EN GOUTTES.
1968. PITYRIASIS ROSE DE GILBERT.
Définition et causes.
Affection cutanée inflammatoire, bénigne. Une origine microbienne virale est
suspectée mais n’a pas été démontrée. Elle est pas ou très peu contagieuse.
Epidémiologie.
Elle survient, le plus souvent, chez un sujet jeune au printemps ou à l’automne.
Signes et symptômes.
La lésion inaugurale caractéristique est un médaillon rose, ovale, recouvert de
petites squames qui siège le plus souvent sur le tronc. Puis d’autres plaques
apparaissent sur le tronc, le cou et la partie proximale des membres.
Investigations.
Le diagnostic est clinique.
Evolution, complications et pronostic.
Les lésions régressent habituellement en 5 à 8 semaines et ne laissent pas de
traces. La récidive est exceptionnelle.
Traitement .
Aucun traitement n’est nécessaire. En cas de démangeaisons, une crème corticoïde
de faible activité peut être utile.
1969. PITYRIASIS RUBRA PILAIRE. Affection cutanée rare, de cause inconnue. Elle
est caractérisée par une éruption prurigineuse (qui démange) de papules rouges
squameuses qui se multiplient et deviennent confluentes, associée à un
épaississement de la couche cornée de la paume des mains et de la plante des
pieds (kératodermie palmoplantaire) de couleur jaune orangé. Les localisations
sont le cuir chevelu, le visage, les coudes et les genoux. L’évolution peut être
chronique, entrecoupée de rémissions ou se faire vers une guérison spontanée. Le
traitement est difficile. Seuls les rétinoïdes sont efficaces, mais ils n’ont
qu’un effet suspensif
1970. PITYRIASIS VERSICOLOR.
Définition et causes.
Mycose cutanée superficielle, bénigne, due à Malassezia Mir (champignon
normalement présent sur la peau).
Epidémiologie.
Affection très fréquente. La contamination est interhumaine directe ou indirecte
(serviettes, vêtements), essentiellement l’été. Un terrain réceptif est
nécessaire (certaines peaux sont réfractaires).
Signes et symptômes.
Les lésions sont de petites taches allant du rose au brun, de taille variable,
confluentes (allant de l’aspect de gouttes à de grandes nappes polycycliques),
recouvertes de petites squames. Après un certain temps, les lésions deviennent
achromiques (dépigmentées) et particulièrement inesthétiques sur une peau noire
ou bronzée. Elles sont localisées sur la partie supérieure du corps.
Investigations.
Sous la lampe de Wood, les lésions ont une fluorescence jaune-verdâtre. Le
scotch-test — application d’un ruban adhésif sur une lésion grattée — permet un
examen au microscope.
Evolution, complications et pronostic.
Les récidives sont très fréquentes malgré le traitement.
Traitement.
Il associe un traitement local, par sulfure de sélénium ou dérivés imidazolés,
et général, pour les formes sévères, avec le kétoconazole.
Prévention et éducation.
Le lavage soigneux des vêtements est indispensable pour éviter une récidive. Il
faut éviter les pratiques responsables d’une sudation importante (sauna, hammam,
sports intensifs…).
1971. PLACENTA PRAEVIA.
Définitions et causes.
Implantation du placenta sur ou à proximité de l’orifice interne du col de
l’utérus (le placenta peut le recouvrir en totalité ou partiellement, ou il peut
seulement l’affleurer).
Epidémiologie.
Il est observé dans 1/200 accouchements, plutôt chez les multipares ou chez des
patients présentant des anomalies utérines (fibrome…).
Signes et symptômes.
Des saignements indolores (métrorragies) de sang rouge surviennent soudain, sans
contractions utérines, en fin de grossesse (entre 28 et 32 semaines).
Investigations.
L’échographie permet le diagnostic. L’examen au spéculum confirme l’origine
endo-utérine du saignement. Le toucher vaginal doit être évité car il peut
aggraver l’hémorragie.
Evolution, complications et pronostic .
En cas d’hémorragie abondante, la vie de la mère et de l’enfant est en jeu (25 %
des morts maternelles par hémorragie sont dues à un placenta praevia). Le risque
principal pour l’enfant est la prématurité.
Traitement.
En cas d’hémorragies peu abondantes et de terme éloigné, le repos au lit est
conseillé. Dès que le terme rend l’accouchement possible, une césarienne est
généralement préférable.
1972. PLEURÉSIE PURULENTE
Définition et causes
Épanchement pleural contenant du pus secondaire d’une pneumopathie aiguë ou d’un
foyer à distance (ORL).
Epidémiologie
Elle survient, le plus souvent, chez des patients débilités (alcoolotabagie,
bronchopathie chronique, cancer évolutif, immunodépression).
Signes et symptômes
Association d’une fièvre, d’une altération de l’état général, d’une douleur
basithoracique majorée par l’inspiration, d’une dyspnée (dépendant du volume de
l’épanchement) et d’une toux. On retrouve une diminution du murmure vésiculaire,
une matité et une abolition des vibrations vocales.
Investigations
La radiographie de thorax et le scanner localisent l’épanchement. La ponction
pleurale évacue un liquide épais et purulent.
Evolution, complications et pronostic
Les complications sont l’enkystement, la fistulisation bronchopleurale et la
compression avec un déplacement du médiastin. L’évolution est longue sous
traitement.
Traitement
Il associe une antibiothérapie et une évacuation par ponction, drainage ou
chirurgie. La kinésithérapie et le nursing chez le malade alité sont un
complément indispensable.
1973. PLEURÉSIE SÉROFIBRINEUSE.
Définition et causes.
Épanchement de liquide citrin dans la plèvre de deux types, exsudat et
transsudat. Dans l’exsudat, l’albumine est > 30 g et les LDH > 200 UI ; les
principales causes sont infectieuses, tumorales ou cardiaques. Dans le
transsudat, l’albumine est < 30 g et les LDH < 200 UI ; les principales causes
sont l’insuffisance cardiaque, la cirrhose et le syndrome néphrotique.
Epidémiologie.
Elles sont plus fréquentes que les pleurésies purulentes.
Signes et symptômes
>Pleurésie purulente.
Investigations.
La radiographie de thorax et le scanner localisent l’épanchement. La ponction
pleurale permet l’examen biochimique et cytobactériologique du liquide. La
biopsie pleurale est indiquée en cas d’exsudat; la thoracoscopie en cas de
suspicion de tuberculose ou de cancer.
Evolution, complications et pronostic. L’évolution et le pronostic sont fonction
de l’étiologie. Les complications sont la compression médiastinale et la
surinfection.
Traitement.
L’évacuation se fait par ponction ou drainage.
Prévention et éducation.
Lorsque l’épanchement est asséché, une kinésithérapie intensive et prolongée est
instituée pour éviter des séquelles pleurales pouvant retentir sur la fonction
respiratoire.
1974. PLICAS DU GENOU. La synoviale du genou possède des replis ou plicas. Le
repli interne peut devenir source de douleurs, de sensations de ressaut ou de
blocages brefs, souvent à la suite d’un traumatisme ou d’efforts sportifs.
L’arthroscopie permet le diagnostic et le traitement par résection qui assure la
guérison.
1975. PLUMMER (MALADIE DE) ou (>) GOITRE MULTINODULAIRE TOXIQUE.
1976. PLUMMER-VINSON (SYNDROME DE) ou SYNDROME DE PATTERSON-KELLY.
Anomalie morphologique exceptionnelle, survenant surtout chez la femme,
caractérisée par un repli membraneux situé à la partie supérieure de
l’oesophage, qui entraîne une dysphagie (difficulté à avaler) aux aliments
solides. Elle est parfois associée à une anémie par déficit en fer. Le
traitement consiste en l’apport de fer, la rupture de la bride par fibroscopie
ou sa dilatation par des bougies. Une surveillance est nécessaire du fait du
risque accru de cancer.
1977. PNEUMATOSE KYSTIQUE INTESTINALE. Entrée d’air dans la sous-muqueuse de la
paroi intestinale (grêle et/ou côlon) du fait d’une dégénérescence de la
musculeuse. Dans plus de 80 % des cas, elle est secondaire à une bronchopathie
chronique obstructive ou à une pathologie digestive obstructive, inflammatoire
ou ischémique. Les troubles digestifs sont, le plus souvent, modérés, mais il
peut parfois exister des rectorragies ou un syndrome d’obstruction colique. Le
traitement est essentiellement médical du fait de la bénignité de la maladie et
de la régression spontanée des symptômes dans près de 20 des cas.
1978. PNEUMATURIE. Passage d’air dans l’urine. Symptôme rare qui indique
habituellement l’existence d’une fistule entre les voies urinaires et l’intestin
(diverticulite, cancer du côlon).
1979. PNEUMOCONIOSES. Groupe de maladies pulmonaires secondaires à l’inhalation
et à la rétention de poussières minérales ou métalliques. Elles provoquent de
lésions pulmonaires, notamment une fibrose, à l’origine de troubles
respiratoires évoluant vers une insuffisance respiratoire chronique. Les
principales affections sont la silicose et l’asbestose.
1980. PNEUMOCYSTOSE.
Définition et causes.
Infection pulmonaire due à un champignon, Pneumacystis carinii. C’est une
infection opportuniste qui survient chez les sujets immunodé- primés.
Epidémiologie.
Au début de l’épidémie, la pneumocystose inaugurait le sida chez plus de 50 %
des patients. Aujourd’hui, grâce à la prévention, sa fréquence a diminué mais
elle demeure l’infection inaugurale du sida la plus fréquente (20 % des cas).
Signes et symptômes.
Il existe une toux sèche, une dyspnée d’effort puis de repos et une fièvre 38 ou
38,5 °C.
Investigations.
La radiographie pulmonaire peut être normale au début, puis montre des opacités
bilatérales diffuses (pneumopathie alvéolo-interstitielle) et, au stade avancé,
deux poumons blancs. Une hypoxie (P02 basse) avec une normocapnie (PCO2 normale)
sont retrouvés aux gaz du sang. Le germe peut être mis en évidence dans le
liquide de lavage bronchoalvéolaire.
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est une insuffisance respiratoire aiguë sur poumons
blancs. L’évolution sous traitement est, le plus souvent, favorable.
Traitement.
L’association triméthoprime-sulfaméthoxazole est le traitement de choix (en cas
d’intolérance, on peut utiliser la pentamidine . L’oxygénothérapie est
indispensable. Parfois, l’intubation et la mise sous ventilation assistée sont
nécessaires.
Prévention.
La prévention primaire est systématique chez tout patient séropositif ayant
moins de 200 CD4/mm3 . Une prévention secondaire (après une première infection)
est indispensable selon le même schéma.
1981. PNEUMOPATHIE D’HYPERSENSIBILITÉ ou ALVÉOLITE ALLERGIQUE EXTRINSÈQUE.
Définition et causes.
Réaction allergique respiratoire impliquant les alvéoles et les bronchioles
terminales. Elle est due à l’inhalation d’agents divers professionnels ou
environnementaux. La forme initialement décrite est le poumon du fermier lié à
la manipulation de foin moisi.
Epidémiologie.
Cette maladie est présente chez les fermiers, les éleveurs d’oiseaux, les
peintres automobiles…
Signes et symptômes.
Les manifestations aiguës, se répétant à chaque nouvelle exposition, comprennent
un syndrome pseudo-grippal avec une fièvre, une toux, des crachats blanchâtres
et une dyspnée. La forme chronique est moins typique et associe une fièvre
modérée, une asthénie, une dyspnée, des douleurs thoraciques et une altération
de l’état général.
Investigations.
La radiographie pulmonaire montre des anomalies diffuses (infiltrat
micronodulaire) prédominant aux bases. Dans les formes chroniques, les épreuves
fonctionnelles respiratoires mettent en évidence une atteinte restrictive.
Évolution, complications et pronostic.
Evolution est généralement favorable avec l’évitement des agents en cause et le
traitement.
Traitement et prévention.
Les corticoïdes sont utiles à la phase aiguë. La soustraction à l’agent en cause
n’est pas toujours facile et peut poser des problèmes (modification du mode de
vie ou de l’activité professionnelle).
1982. PNEUMOPATHIE INFECTIEUSE AIGUË ou PNEUMONIE.
Définition et causes.
Infection aiguë du parenchyme pulmonaire. Dans la plupart des cas, la
contamination se fait par voie aérienne (plus rarement par voie sanguine à
partie d’un foyer infectieux à distance). Les germes les plus fréquents sont
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Mycoplasma pneumoniae,
Influenzavirus A et Chlamydia pneumoniae. Les principaux facteurs de risque sont
le tabac, la pollution, l’âge ou une pathologie sous-jacente.
Epidémiologie.
L’incidence des pneumopathies communautaires (en l’absence d’hospitalisation
dans la semaine qui précède) est de 2 à 15 cas pour 1 000 par an. 500000
patients de plus de 15 ans sont hospitalisés pour ce motif chaque année.
Signes et symptômes.
Le début est, en général, brutal avec une fièvre élevée, une altération de
l’état général et des frissons. Puis apparaissent une toux avec des douleurs
thoraciques et une dyspnée. L’auscultation retrouve, le plus souvent, un foyer
de râles crépitants.
Investigations.
La radiographie pulmonaire montre, dans la forme typique, une image dense au
niveau d’un lobe pulmonaire. La recherche du germe utilise la fibroscopie avec
prélèvements bronchiques et les hémocultures.
Évolution, complications et pronostic.
L’évolution est en général bonne sous antibiothérapie. La principale
complication est l’insuffisance respiratoire aiguë imposant une mise sous
ventilation assistée. La formation d’un abcès ou d’un épanchement pleural est
possible. La mortalité des pneumopathies hospitalisées est de l’ordre de 20 % et
peut atteindre 50 % en cas de nécessité des soins intensifs.
Traitement .
Le traitement antibiotique de première intention est empirique (amoxicilline ou
macrolide en ambulatoire) et sera adapté en cas d’échec ou d’isolement du germe.
1983. PNEUMOPATHIE NOSOCOMIALE.
Définition et causes
Infection pulmonaire survenant au moins 72 heures après l’admission du patient à
l’hôpital. Les principaux facteurs favorisants sont l’existence d’une
broncho-pneumopathie chronique, un âge de plus de 70 ans, une immunodépression,
une intubation, un séjour en réanimation, une antibiothérapie préalable et un
acte chirurgical thoraco-abdominal.
Epidémiologie
Il s’agit du troisième site d’infection nosocomiale (après les infections
urinaires et cutanées), mais de la première cause de décès. L’ensemble des
infections nosocomiales serait responsable de près de 10 000 morts par an en
France.
Signes et symptômes
Il s’agit de l’association d’une fièvre et de signes pulmonaires.
Investigations
La radiographie de poumon permet le diagnostic. La recherche du germe utilise
les hémocultures et le brossage bronchique protégé sous fibroscopie.
Évolution, complications et pronostic
la mortalité est importante et est estimée entre 20 et 50 % chez les patients
intubés.
Traitement
L’antibiothérapie initiale utilise une association à large spectre qui est
adaptée en fonction des résultats des examens bactériologiques.
Prévention et éducation
Les règles d’hygiène (interruption de la transmission entre le personnel et les
patients) et une utilisation raisonnée des antibiotiques (limitant l’apparition
de souches multirésistantes) constituent les points centraux de la prévention.
1984. PNEUMOTHORAX.
Définition et causes
Passage d’air dans l’espace pleural normalement virtuel. Il peut être spontané
primitif (sans anomalie pulmonaire préexistante), spontané secondaire (maladie
respiratoire comme un emphysème) ou traumatique.
Epidémiologie.
La forme la plus fréquente est le pneumothorax spontané primitif de l’adulte
jeune (20 à 40 ans), dont l’incidence est de 9/100000. La forme secondaire est
fréquemment liée à une bronchopathie chronique obstructive et s’observe chez des
gens plus âgés.
Signes et symptômes.
Le pneumothorax spontané primitif se produit en général au repos, chez un sujet
longiligne. Le début est brutal, avec une douleur en coup de poignard, augmentée
par la toux et les mouvements et une dyspnée variable (un petit pneumothorax
peut être peu ou pas symptomatique). L’examen retrouve une abolition du murmure
vésiculaire à l’auscultation et une hypersonorité à la percussion. En cas
d’insuffisance respiratoire chronique, une dyspnée aiguë domine le tableau.
Investigation.
La radiographie de thorax (voire le scanner dans les cas difficiles) montre
l’épanchement gazeux (champ hyperclair = en noir sur le cliché). Les gaz du sang
permettent d’apprécier la tolérance..
Evolution, complications et pronostic La mauvaise tolérance respiratoire est le
premier signe de gravité (pneumothorax compressif refoulant le médiastin ou
maladie pulmonaire sous-jacente). En cas de décollement de l’autre poumon
(pneumothorax bilatéral) survient une asphyxie aiguë. Un épanchement sanguin
(hémopneumothorax) associé est possible.
Traitement.
En cas de détresse, l’évacuation de l’air (exsufflation à l’aiguille, drainage)
est une urgence. En cas de pneumothorax minime, le simple repos peut être
suffisant pour obtenir une résorption spontanée. En cas de récidive, une
symphyse (« collage » pleural) est recommandée par thoracoscopie (talcage…) ou
par thoracotomie classique avec abrasion pleurale.
Prévention et éducation.
Le patient doit être informé de la gravité potentielle d’une récidive
controlatérale avec le risque de pneumothorax bilatéral et d’une asphyxie aiguë.
1985. PODAGRE. Nom donné à l’atteinte des articulations du pied, notamment la
métatarsophalangienne du gros orteil, au cours de la goutte.
1986. POEMS SYNDROME. ou SYNDROME DE CROW-FUKASE. Syndrome associant une
polyneuropathie, une organomégalie (organes anormalement gros), une
endocrinopathie, un myélome et des lésions cutanées (s pour skin). L’évolution
est relativement lente, mais le pronostic est globalement médiocre.
1987. POGOSTA (MALADIE DE). Maladie due au virus Sindbis du groupe des
arboviroses (>), transmise par un moustique, que l’on appelle maladie d’Ockelbo
en Suède, fièvre de Carélie en Russie et maladie de Pogosta en Finlande. Elle
associe une fièvre peu élevée, des douleurs musculaires et articulaires, une
éruption maculopapuleuse sur le tronc et les extrémités. Le traitement est
symptomatique. Des douleurs articulaires résiduelles peuvent persister pendant
deux ans.
1988. POÏKILODERMATOMYOSITE ou (>) PETGES-CLÉJAT (MALADIE DE) .
1989. POLAND (MALADIE DE) . Malformation congénitale associant une absence de
sein unilatérale, une hypotrophie du mamelon, une atrophie du muscle grand
pectoral, des anomalies des côtes sous-jacentes et de la main du même côté.
1990. POLIOMYÉLITE ANTÉRIEURE AIGUË .
Définition et causes.
Maladie infectieuse aiguë due au Poliovirus qui provoque des lésions de la
moelle épinière et du cerveau. L’homme est le seul hôte naturel du virus,
l’infection est très contagieuse et la transmission se fait par contact direct.
L’incubation est de 1 à 2 semaines. L’infection n’est apparente que dans 1 cas
sur 100.
Epidémiologie.
La maladie est devenue exceptionnelle en France. Quelques cas chez des adultes
de plus de 40 ans ayant échappé à la vaccination ont été observés après des
voyages dans les zones d’endémie.
Signes et symptômes.
La forme typique débute par une fièvre élevée, une pharyngite et des signes
digestifs. Puis apparaissent des douleurs musculaires avec un syndrome méningé
et des paralysies prédominant aux membres inférieurs, asymétriques et variables
d’un groupe musculaire à l’autre. Des formes respiratoires sont fréquentes avec
une paralysie des muscles thoraco¬abdominaux, qui peut entraîner une détresse
respiratoire.
Investigations.
Le virus peut être mis en évidence dans les selles. Le liquide céphalorachidien
montre une lymphocytose modérée et une élévation progressive de l’albumine, mais
le virus est exceptionnellement retrouvé. L’élévation du taux d’anticorps à deux
prélèvements à 2 semaines d’intervalle confirme le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
La récupération des paralysies s’étale sur plusieurs semaines ou mois et une
récupération complète n’est possible que pour les muscles peu touchés. Le
pronostic est particulièrement grave chez le nourrisson, avec des troubles
importants du développement. Chez l’enfant, elles se traduisent par une atrophie
musculaire, des rétractions tendineuses, des troubles cutanés et osseux et des
anomalies de la croissance.
Traitement.
Le traitement est uniquement symptomatique. En cas de troubles respiratoires,
une ventilation artificielle est nécessaire. Au stade des séquelles, un
traitement chirurgical orthopédique peut être utile.
Prévention.
La vaccination devrait permettre à terme une éviction de la maladie. C’est une
maladie à déclaration obligatoire.
1991. POLIOSE. Trouble circonscrit de la pigmentation, qui se manifeste par une
mèche de cheveux blancs. Il se retrouve dans le piébaldisme (>), la sclérose
tubéreuse de Bourneville (>), mais il peut également s’agir d’une simple
malformation isolée, souvent héréditaire.
1992. POLIP SYNDROME ou MNGIE SYNDROME. Acronyme anglais pour polyneuropathy,
ophtalmo plegia, leukoencephalopathy intestinal pseudoobstnution. Une autre
appellation est MNGIE syndrome (myo-neuro-gastro-intestinal encephalopathy). Il
s’agit d’une maladie mitochondriale, dont le tableau clinique associe une
leuco-encéphlopathie, une ophtalmoplégie, une polyneuropathie et une
pseudo-occlusion intestinale chronique.
1993. POLYANGÉITE MICROSCOPIQUE Maladie très proche de la périartérite noueuse
(>) mais comprenant une atteinte rénale (glomérulonéphrite rapidement
progressive >) et une pulmonaire (hémorragie alvéolaire avec hémoptysie). Le
traitement utilise des médicaments immunosuppresseurs.
1994. POLYARTHRITE CHRONIQUE JUVÉNILE ou SYNDROME DE WISSLER-FANCONI.
Définition et causes.
Maladie touchant l’enfant de moins de 16 ans, caractérisée par une inflammation
articulaire évoluant depuis au moins 3 mois. La forme généralisée est la maladie
de Still (>).
Epidémiologie
L’incidence est d’environ 5/100000. Elle est plus fréquente chez les filles.
L’âge moyen de début est de 6 ans, avec deux pics de fréquence entre 3 et 4 ans
et entre 9 et 14 ans.
Signes et symptômes.
Les articulations touchées (genoux, poignets, doigts, coudes, chevilles, pieds,
hanche, épaules, cou…) sont le siège d’une inflammation modérée et chronique,
source de douleurs et d’impotence. Au niveau des articulations superficielles
s’ajoutent un gonflement et une chaleur locale. Une inflammation des tendons et
des gaines (ténosynovite) est souvent associée.
Investigations.
Au début les radiographies sont normales, puis apparaît une hypertransparence
des extrémités osseuses (ostéoporose), un pincement des articulations et, plus
tard, des érosions (mains et poignets).
Evolution, complications et pronostic.
Les troubles localisés de la croissance et de la maturation osseuses sont très
fréquents (raccourcissement des doigts, des avant-bras, allongement d’un membre
inférieur en cas d’atteinte unilatérale du genou, raideur du cou…) et
aboutissent à une invalidité. L’évolution se fait par poussées entrecoupées de
rémissions souvent incomplètes.
Traitement.
Les médicaments utilisés sont l’aspirine, les anti-inflammatoires non
stéroïdiens et les sels d’or. La kinésithérapie et l’utilisation de prothèses de
fonction ou de posture sont indispensables pour préserver la fonction
articulaire. Parfois, la chirurgie est nécessaire pour corriger les
déformations.
1995. POLYARTHRITE RHUMATOÏDE.
Définition et causes.
Maladie inflammatoire chronique de l’ensemble du tissu conjonctif, à
prédominance synoviale, qui fait partie des maladies auto-immunes. La cause est
inconnue mais il existe une prédisposition génétique.
Epidémiologie.
La prévalence est de 0,1 à 1 % avec une nette prédominance féminine (4 femmes
pour 1 homme). L’âge de début est de 45 ans.
Signes et symptômes.
La phase de début comprend des douleurs articulaires (polyarthralgies)
bilatérales et symétriques (interphalangiennes proximales,
métacarpophalangiennes, poignets, métarsophalangiennes) avec une raideur
matinale. Les nodules cutanés sont rares mais spécifiques de la maladie. A la
phase d’état, on observe des poussées inflammatoires articulaires récidivantes
avec des déformations des doigts et des orteils.
Investigations.
Il existe un syndrome inflammatoire et on retrouve le facteur rhumatoïde parle
test au latex et la réaction de Waaler-Rose. Les radiographies sont initialement
normales puis montrent les atteintes articulaires.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait vers une extension par poussées successives avec un handicap
fonctionnel chez 50 % des patients dix ans après le début des symptômes. Une
compression médullaire est possible en cas d’atteinte cervicale évoluée. Dans
les formes sévères la durée de vie est réduite en moyenne de cinq à dix ans.
Traitement.
Il doit être mis en route le plus précocement possible, afin de prévenir
l’apparition de déformations et de conserver le meilleur fonctionnement possible
des articulations. Il associe un traitement visant à soulager les symptômes
(antalgiques, anti-inflammatoires non stéroïdiens, corticoïdes) et un traitement
de fond avec différents médicaments (méthotrexate, sels d’or, sulfasalazine,
antipaludéens, D-pénicillamine ou ciclosporine). La kinésithérapie et
l’ergothérapie sont également importantes. Dans certains cas, une destruction de
la synoviale par l’injection de certains produits ou son ablation par une
intervention chirurgicale peut être indiquée. De nouveaux produits apparaissent
prometteurs pour limiter l’évolution de la maladie.
Prévention et éducation.
Une prise en charge « à la carte » est négociée entre le patient et l’équipe
soignante. Une prise en charge médico-psychologique est nécessaire et les
associations de malades offrent une aide précieuse.
1996. POLYCHONDRITE ATROPHIANTE
Définition et causes.
Affection inflammatoire destructrice du cartilage et des autres tissus
conjonctifs, en particulier au niveau de l’oreille, du nez, du larynx, de la
trachée, de l’oeil, des valvules cardiaques et des vaisseaux sanguins. Une
origine auto-immune est suspectée du fait de son association fréquente à une
polyarthrite rhumatoïde, un lupus ou à d’autres connectivités.
Epidémiologie.
C’est une maladie rare, qui touche aussi bien l’homme que la femme, à l’âge
moyen de la vie.
Signes et symptômes.
Initialement, les principaux signes sont une tuméfaction rouge, douloureuse, du
pavillon de l’oreille et du nez, associée à des douleurs articulaires, notamment
chrondrocostales. Les autres atteintes, par ordre de fréquence, sont l’oeil
(conjonctivite, sclérite, iritis), l’arbre respiratoire (douleurs, troubles de
la parole, dyspnée), l’oreille interne (surdité), le système cardiovasculaire
(insuffisance aortique) et les reins (glomérulonéphrite nécrosante).
Investigations.
Le diagnostic est essentiellement clinique. La biopsie du cartilage est parfois
utile pour éliminer d’autres pathologies.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait par poussées successives, dont la fréquence et la sévérité
sont très variables. Le pronostic est sévère, avec un taux de survie à cinq ans
de 75 %. La mort résulte le plus souvent d’atteintes respiratoires ou
vasculaires.
Traitement.
Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés dans les formes mineures.
La corticothérapie reste le traitement de référence, éventuellement complétée
par les immunosuppresseurs.
1997. POLYENDOCRINOPATHIE DE TYPE I ou SYNDROME DE WHITAKER Syndrome débutant en
général dans l’enfance, qui associe une hypoparathyroïdie, une insuffisance
corticosurrénalienne (maladie d’Addison) et une candidose chronique. Une origine
auto-immune est suspectée. Des cas familiaux sont possibles.
1998. POLYENDOCRINOPATHIE DE TYPE II ou SYNDROME DE SCHMIDT
Syndrome débutant à l’âge adulte, en général vers 30 ans, avec une prédominance
féminine, qui associe une insuffisance corticosurrénalienne (maladie d’Addison),
une atteinte thyroïdienne et un diabète sucré insulinodépendant. Une origine
auto-immune est suspectée. Les formes familiales représentent 50 % des cas.
1999. POLYKYSTOSE RÉNALE DE L’ADULTE
Définition et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique dominante, caractérisée par le
développement de kystes qui détruisent progressivement les reins.
Epidémiologie.
L’incidence est de 1/400 à 1000 personnes. C’est la plus fréquente des maladies
rénales héréditaires et elle est responsable de près de 10 % des insuffisances
rénales terminales.
Signes et symptômes.
La maladie peut être asymptomatique. L’atteinte rénale apparaît le plus souvent
à l’âge adulte, avec une hématurie, une HTA et une insuffisance rénale. Des
kystes hépatiques sont présents dans 70 % des cas. Une atteinte
cardio-vasculaire est également présente avec des anévrismes cérébraux.
Investigations.
L’échographie (rénale et hépatique) et l’urographie intraveineuse montrent des
gros reins, un refoulement des cavités et de multiples tumeurs non échogènes.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait vers une insuffisance rénale terminale aux alentours de 50
ans. Les infections urinaires et l’hypertension artérielle sont des
complications fréquentes. Les anévrismes cérébraux peuvent se rompre.
Prévention.
Une enquête familiale et le conseil génétique sont préconisés.
2000. POLYKYSTOSE RÉNALE DE L’ENFANT
Définition et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique récessive, caractérisée par
l’association de kystes rénaux qui dérivent des canaux collecteurs et d’une
fibrose hépatique.
Epidémiologie.
Elle est beaucoup plus rare que la forme adulte et touche 1/40000 naissances.
Signes et symptômes.
L’atteinte rénale n’est pas prédominante et peut être asymptomatique. L’atteinte
hépatique entraîne une hypertension portale responsable d’hémorragies
digestives.
Investigations.
Elles comprennent l’échographie (rénale et hépatique) et l’urographie
intraveineuse.
Evolution, complications et pronostic.
La forme du nouveau-né entraîne, en général, un décès rapide. L’insuffisance
rénale terminale peut être atteinte dans l’enfance mais l’évolution peut
s’étendre jusqu’à l’âge adulte.
Traitement.
Il comprend la dérivation portocave et la transplantation rénale.
Prévention.
Le diagnostic prénatal est possible par échographie.
2001. POLYMASTIE Malformation congénitale due à une anomalie embryonnaire et
caractérisée par un sein surnuméraire, situé en position thoracique sur la ligne
axillo-inguinale (correspondant à la crête mammaire embryologique). Il pourra,
lors de l’allaitement, subir des modifications comme le sein normal. La gêne
occasionnée par sa taille, sa position (axillaire) ou des considérations
esthétiques peut faire envisager son exérèse chirurgicale.
2002. POLYMYOSITE. Maladie de système caractérisée par une atteinte
inflammatoire et dégénérative des muscles. Elle est souvent associée à la
dermatomyosite (>) qui est la même maladie avec, en plus, une atteinte cutanée.
2003. POLYOSTÉOCHONDRITE . Maladie du développement osseux, héréditaire de
transmission autosomique dominante, qui atteint surtout les articulations des
membres de manière symétrique, avec une hypotonie musculaire et une hyperlaxité
ligamentaire. Elle se manifeste vers l’âge de 3 à 4 ans par des troubles de la
marche et guérit en fin de croissance en laissant des séquelles limitées (petite
taille, anomalie de la hanche à type de coxa vara).
2004. POLYPES COLORECTAUX ADÉNOMATEUX.
Définition et causes.
Tumeurs développées en saillie à partir des glandes de la muqueuse colorectale.
Il existe une prédisposition génétique associée à des facteurs favorisants
(tabac, alcool, alimentation riche en graisses animales et pauvre en fibres
végétales).
Epidémiologie.
Le taux de prévalence augmente avec l’âge : 7 % des 45-49 ans, 19 % des 65-70
ans. Il existe une prédominance masculine et, dans 40 %, des cas, les polypes
sont multiples.
Signes et symptômes.
Les polypes de petite taille sont asymptomatiques. Les principales
manifestations sont des rectorragies (émission de sang par l’anus), des
émissions glaireuses et des troubles du transit.
Investigations.
La coloscopie et le lavement baryté visualisent les polypes. Des troubles
hydroélectrolytiques sont possibles en cas d’émissions glaireuses abondantes.
Evolution, complications et pronostic.
Le principal risque est la cancérisation (3 % des cas dans un délai de sept à
dix ans).
Traitement.
La coloscopie permet une exérèse à la pince ou à l’anse diathermique. La
chirurgie est indiquée en cas de gros polypes.
Prévention.
L’ablation doit être systémique du fait du risque de cancérisation.
2005. POLYPES DES CORDES VOCALES.
Définition et causes.
Petites formations arrondies, avec ou sans pied, siégeant sur une ou sur les
deux cordes vocales. Les causes sont un abus vocal, des allergies laryngées
chroniques, l’inhalation fréquente de produits irritants (cigarette, fumées
industrielles).
Epidémiologie.
Relativement fréquent.
Signes et symptômes.
Il existe un enrouement et des troubles de la voix.
Investigations
La laryngoscopie visualise les lésions et la biopsie permet d’éliminer une
tumeur maligne.
Evolution, complications et pronostic.
Le principal risque est la transformation cancéreuse.
Traitement.
Le traitement consiste en l’ablation chirurgicale ou au laser des polypes sous
laryngoscopie.
Prévention.
La prévention des récidives comprend l’élimination de la cause et une prise en
charge orthophonique en cas d’abus vocal.
2006. POLYPE SOLITAIRE DE KILLIAN ou FIBROMYXOME.
Polype implanté au niveau du sinus maxillaire, plus rarement de l’ethmoïde, qui
se développe vers l’arrière des fosses nasales. Il se rencontre, le plus
souvent, chez l’adolescent ou l’adulte jeune. Le principal symptôme est une
obstruction nasale. Le traitement est l’exérèse chirurgicale.
2007. POLYPOSE NASALE.
Définition et causes.
Tumeurs bénignes, de la forme d’une larme, apparaissant au niveau de la cavité
nasale et souvent des sinus. Leur développement s’effectue souvent dans le cadre
d’une rhinite allergique (>) ou d’infections aiguës ou chroniques locales.
Epidémiologie.
Affection fréquente.
Signes et symptômes.
Les polypes entraînent une obstruction nasale et une hypersécrétion.
Investigations.
La rhinoscopie directe permet une visualisation des polypes. Les radiographies
et le scanner des sinus mesurent l’extension de l’atteinte.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont les surinfections. Il existe des aggravations
saisonnières et des rémissions spontanées. Les récidives sont fréquentes après
traitement.
Traitement.
Le traitement médicamenteux utilise les corticoïdes locaux, qui réduisent ou
éliminent les polypes. Mais, le plus souvent, une exérèse chirurgicale des
polypes et, dans les formes sévères, la mise à plat des sinus pour assurer leur
bonne ventilation sont nécessaires.
2008. POLYPOSE RECTOCOLIQUE FAMILIALE.
Définition et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique dominante avec une pénétrance
variable (formes sporadiques possibles), caractérisée par la présence, avant
l’âge de 30 ans, de plus de 100 polypes rectocoliques développés à partir des
glandes de la muqueuse intestinale.
Epidémiologie.
La prévalence est de 1/8 000. Elle est à l’origine de 1 % des cancers
colorectaux.
Signes et symptômes.
Association de diarrhée, de rectorragies (émission de sang par l’anus) et de
douleurs.
Investigations.
La coloscopie permet le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
La cancérisation est la principale complication. Son taux augmente avec le temps
et est de 100% à 20 ans.
Traitement.
Il comprend une coloproctectomie (ablation du côlon et du rectum).
Prévention.
La prévention repose sur la détection précoce dans les familles à risque et un
traitement systématique.
2009. POLYRADICU LON ÉVRITE ou POLYNEUROPATHIE.
Terme qui désigne un ensemble d’affections caractérisées par une atteinte étendue du système nerveux périphérique. Les troubles sont essentiellement sensitifs et moteurs au niveau des membres. Les principales causes sont inflammatoires (syndrome de Guillain-Barré), métaboliques (diabète, insuffisance rénale…), toxiques médicaments…), nutritionnelles et carentielles (alcoolisme, carences en vitamines du groupe B…). Les polyneuropathies peuvent être également associées à des maladies systémiques (lupus, polyarthrite
rhumatoïde…) ou à des cancers. Il existe, en outre, de nombreuses neuropathies héréditaires, dont la plus fréquente est la maladie de Charcot-Marie-Tooth.
2010. POLYTHÉLIE. Malformation congénitale due à une anomalie embryonnaire et
caractérisée par un ou plusieurs mamelons surnuméraires situés sur la ligne
axillo-inguinale (correspondant à la crête mammaire embryonnaire). Elle est
fréquente et touche 2 % de la population générale. Dans la majorité des cas, il
s’agit d’un mamelon surnuméraire unique situé sous le sein normal. Le préjudice
est uniquement esthétique. La cancérisation est très rare.
2011. POMPE (MALADIE DE) . Maladie métabolique héréditaire, de transmission
autosomique récessive, due à un déficit enzymatique qui entraîne l’accumulation
de glycogène dans les cellules. L’atteinte musculaire est prédominante avec une
hypotonie importante accompagnée d’une insuffisance cardiaque et respiratoire.
La maladie débute entre 0 et 6 mois et aboutit au décès vers l’âge de 2 ans.
2012. POOL VIDE (MALADIE DU). Dysfonction plaquettaire caractérisée par une
absence, au sein des plaquettes, des granules qui stockent certaines substances
nécessaires à l’activation plaquettaire. Le temps de saignement est parfois
allongé. Certaines personnes atteintes de la maladie présentent des anomalies de
coloration capillaire, des troubles visuels et sont sensibles aux infections.
2013. POROKÉRATOSES. Affections cutanées constituées d’éruptions qui présentent
trois caractéristiques: un bourrelet périphérique filiforme, un aspect
histologique particulier de cette bordure formée de lamelles disposées en pile
d’assiettes (lamelle coronoïde) et un risque important de cancérisation. Il
existe des formes héréditaires et des formes acquises. Le traitement par les
rétinoïdes n’est que suspensif. Les lésions peuvent être détruites à l’azote
liquide ou au laser CO2, ou bien bénéficier d’une exérèse chirurgicale. Les
rayonnements ultraviolets représentant un facteur favorisant, la protection par
les vêtements et par écran total est recommandée.
2014. POROME ECCRINE. Tumeur cutanée bénigne touchant les glandes sudoripares.
Il s’agit d’une tumeur bourgeonnante, charnue et congestive, dont la base large
est cernée par un collier de kératine de couleur jaunâtre. Elle est souvent
située au niveau du talon. La transformation cancéreuse est possible. L’excision
chirurgicale est donc conseillée en vue d’un examen anatomopathologique.
2015. POROME FOLLICULAIRE. Tumeur cutanée bénigne des régions pileuses
(sourcils, moustache, barbe) apparaissant chez l’homme âgé (plus de 60 ans). Il
s’agit d’un nodule avec des squames et une croûte, parfois traversée par
quelques poils.
2016. PORPHYRIES. Anomalies héréditaires ou acquises de certaines enzymes de la
synthèse de l’hème de l’hémoglobine, qui se traduit par l’accumulation de
précurseurs, les porphyrines. On distingue les porphyries hépatiques (porphyrie
aiguë intermittente, coproporphyrie héréditaire, porphyrie variegata, porphyrie
de Doss), la porphyrie cutanée tardive et les porphyries érythropoïétiques
(maladie de Gunther, protoporphyrie).
2017. PORPHYRIE AIGUË INTERMITTENTE.
Définition et causes.
Maladie héréditaire, de transmission autosomique dominante, caractérisée par un
déficit enzymatique aboutissant à l’accumulation de précurseurs de l’hémoglobine
dans l’organisme. Les facteurs déclenchants des crises sont la période
prémenstruelle chez la femme, le stress, l’alcool, le jeûne, la fatigue, les
contraceptifs hormonaux et surtout de très nombreux médicaments influant sur le
métabolisme hépatique.
Epidémiologie.
Elle représente la plus fréquente des porphyries héréditaires, avec une
incidence du gène d’environ 1/1000. Mais seuls 10 % des sujets auront une
expression clinique, avec une nette prédominance de femmes.
Signes et symptômes.
La crise aiguë se manifeste par des douleurs abdominales accompagnées, dans un
tiers des cas, par des troubles d’allure psychiatrique (dépression, anxiété,
confusion, hallucinations visuelles…). Les urines sont colorées en rouge dans
les formes sévères.
Investigations.
La présence de précurseurs des porphyrines, d’uroporphyrines et de
coproporphyrines dans les urines et dans les selles affirme le diagnostic. Le
déficit enzymatique (PBG désaminase) est mis en évidence dans les érythrocytes.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont neurologiques (elles peuvent être
révélatrices de la maladie). Les signes sont très variables: faiblesse
musculaire, paralysie flasque, atteinte des nerfs crâniens, convulsions… En
général, l’évolution de la crise est favorable en quelques jours.
Traitement.
Le traitement de la crise utilise la perfusion de soluté glucoseet d’hémine
associée à des antalgiques.
Prévention et éducation.
Le patient doit signaler sa maladie pour éviter la prescription des très
nombreux médicaments contre-indiqués. En outre, il doit connaître les facteurs
déclenchants des crises.
2018. PORPHYRIE CUTANÉE TARDIVE.
Définition et causes.
Maladie caractérisée par un déficit enzymatique aboutissant à l’accumulation de
précurseurs de l’hémoglobine dans l’organisme. Il existe une forme sporadique,
la plus fréquente, et une forme familiale, plus rare. Les principaux facteurs
déclenchants sont l’alcool, les œstrogènes et de nombreux médicaments influant
sur le métabolisme hépatique.
Epidémiologie.
C’est la plus fréquente de l’ensemble des porphyries. Elle se manifeste chez
l’adulte.
Signes et symptômes.
L’atteinte cutanée se manifeste par des bulles ou des vésicules, plus ou moins
douloureuses, qui apparaissent sur les zones exposées au soleil, souvent en été.
La cicatrisation est lente et laisse des cicatrices le plus souvent pigmentées.
La peau est très fragile et est lésée au moindre traumatisme. Les urines sont
colorées en rouge.
Investigations.
On retrouve, dans les urines, une importante excrétion d’uroporphyrines, plus
modérée de coproporphyrines. Il existe également une surcharge en fer.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution sous traitement est, en règle générale, favorable. Le risque de cancer du foie, de lupus et de diabète est élevé chez ces patients.
Traitement, prévention et éducation.
Le traitement général est variable et utilise des saignées et des antipaludéens.
Le traitement à visée cutanée est surtout préventif: éviter les traumatismes et
l’exposition solaire, arrêter l’intoxication éthylique, la pilule et les autres
médicaments potentiellement en cause.
2019. PORPHYRIE DE DOSS Porphyrie hépatique de découverte récente, dont la
symptomatologie est similaire à la porphyrie aiguë intermittente (>). C’est une
maladie héréditaire de transmission autosomique récessive. Elle est caractérisée
par un déficit en ALA déshydrase qui se traduit par la présence, dans les
urines, de d’acide delta-aminolévulinique (ALA) et de coproporphyrine III.
2020. PORPHYRIE VARIEGATA Porphyrie très semblable à la porphyrie aiguë
intermittente. L’enzyme déficitaire est différente (PROTO oxydase) cc qui se
traduit par la présence en plus dans les urines de protoporphyrines.
2021. POSNER-SCHLOSSMANN (SYNDROME DE). Syndrome, simulant le glaucome aigu,
caractérisé par des crises répétées d’hypertension oculaire unilatérales, peu
douloureuses. Elles surviennent chez le sujet jeune, n’altèrent pas l’acuité
visuelle et ont, en général, un pronostic favorable. Il existe des précipités
blancs sur la face postérieure de la cornée. Une origine allergique est
suspectée.
2022. POTT (MAL DE).
Définition et causes.
Il s’agit d’une spondylodiscite (>) tuberculeuse, c’est-à-dire d’une infection
vertébrale par le bacille de la tuberculose. L’origine est souvent une
tuberculose ancienne non ou mal traitée ou en cours d’évolution (pulmonaire).
Epidémiologie.
Il est devenu rare et touche surtout des adultes, particulièrement les immigrés
originaires d’Afrique noire.
Signes et symptômes.
Le début est, le plus souvent, progressif et insidieux avec des douleurs
vertébrales (lombaires, dorsales ou cervicales, selon la localisation) et une
altération de l’état général (fièvre modérée, amaigrissement). La douleur est
retrouvée à la pression et il existe parfois des signes d’atteinte des racines
(sciatique, cruralgie).
Investigations.
La radiologie est en retard sur la clinique: l’aspect typique est celui d’un
disque affaissé, avec des images de lacunes au niveau des corps vertébraux. Le
scanner évalue l’étendue des lésions et peut guider la biopsie, qui permet de
retrouver le germe au niveau du prélèvement.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont les compressions neurologiques par abcès ou
déformations rachidiennes qui peuvent, au pire, entraîner une paraplégie.
Traitement.
L’antibiothérapie antituberculeuse classique suffit si la destruction vertébrale
est limitée. Le repos au lit, voire l’utilisation d’appareils de maintien,
peuvent être indiqués dans les premiers mois. La chirurgie est nécessaire en cas
d’abcès compressifs.
Prévention et éducation.
La prévention par la vaccination et le traitement antibiotiques des infections
tuberculeuses pulmonaires ont considérablement fait diminuer cette maladie.
2023. POTTER (SYNDROME DE) Absence congénitale des deux reins provoquant la mort
du nouveau-né en quelques jours (parfois la mort in utero). D’autres
malformations (poumons, voies urinaires, organes génitaux) peuvent être
associées.
2024. POUMON TROPICAL ÉOSINOPHILIQUE ou (>) WEINGARTEN (SYNDROME DE).
2025. POURFOUR DU PETIT (SYNDROME). Syndrome dû à l’irritation du sympathique
cervical, provoquée le plus souvent par un goitre ou une tumeur locale, qui
représente l’inverse du syndrome de Claude Bernard-Horner. Il associe une
mydriase, une exophtalmie et un élargissement de la fente palpébrale.
2026. PRADER-WILLI (SYNDROME DE). Maladie génétique sporadique due à une
anomalie du chromosome 15 (1/10 000 naissances), caractérisée par une petite
taille, une obésité généralisée, une hypotonie, un hypogonadisme (insuffisance
de fonctionnement des gonades, testicules ou ovaires) et un déficit
intellectuel.
2027. PRÉMATURITE.
Définition et causes.
Toute naissance survenant avant 37 semaines d’aménorrhée (à partir du premier
jour des dernières règles) est une naissance prématurée. La grande prématurité
concerne les grossesses se terminant avant 32 semaines. Les principales causes
sont:
• obstétricales (grossesses multiples, placenta praevia…) ;
• maternelles (infections, diabète…);foetales (malformations) ;
• socio-économiques (conditions de travail…).
Épidémiologie.
Le taux de prématurés, après une diminution continuelle pour atteindre moins de
4 % des naissances, est remonté ces dernières années à 7 %, du fait, notamment,
de l’augmentation des grossesses multiples, liées au développement des pratiques
de procréation médicalement assistée.
Signes et symptômes.
L’enfant prématuré pèse, en général, moins de 2 500 g, sa peau est fine,
brillante, son activité et son tonus sont réduits et ses membres ne sont pas en
flexion.
Évolution, complications et pronostic.
La majorité des problèmes sont liés à l’immaturité des organes : poumons
(détresse respiratoire, maladie des membranes hyalines), système nerveux central
(insuffisance de coordination des réflexes de succion, apnée d’origine centrale,
hémorragie intraventricualire), infections, troubles de la régulation thermique
et glycémique (> entérocolite ulcéronécrosante), troubles digestifs,
hyperbilirubinémie (ictère), yeux (> fibroplasie rétrolentale). Avant 32
semaines, la mortalité et le risque de séquelles neurologiques restent
importants.
Traitement.
Le transfert anténatal de la mère dans un centre adapté au degré de prématurité
(disposant d’une unité ou d’une réanimation néonatale) est indispensable.
Prévention.
Le dépistage des grossesses à haut risque, leur prise en charge dans des centres
spécialisés et l’utilisation de la corticothérapie anténatale (diminution des
complications de la prématurité) contribuent à réduire la mortalité néonatale
liée à la grande prématurité.
2028. PRESBYACOUSIE. Il s’agit d’une atteinte progressive avec l’âge,
correspondant au vieillissement des composants de l’oreille interne. L’atteinte
prédomine dans les aigus. Les patients sont gênés pour la compréhension dans le
bruit. La lecture labiale, l’entraînement auditif, l’utilisation maximale
d’informations non auditives et l’amplification par une prothèse peuvent fournir
une aide aux patients.
2029. PRESBYTIE.
Définition et causes.
Diminution physiologique et inéluctable du pouvoir d’accommodation liée au
vieillissement.
Epidémiologie.
Se manifeste vers 45 ans dans toute la population.
Signes et symptômes.
II existe une difficulté croissante à la vision de près, qui oblige à éloigner
le plan de travail, à augmenter l’éclairage…
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est inexorable et inéluctable.
Traitement.
Les lunettes ou les lentilles apportent une correction satisfaisante.
2030. PRIAPISME.
Définition et causes.
Érection anormale, douloureuse, prolongée, non accompagné de désir ou
d’excitation sexuelle. Les principales causes sont certains médicaments ou
stimulants sexuels, la drépanocytose, une leucémie myéloïde chronique, une
infection urogénitale, une tumeur pelvienne ou un traumatisme de la moelle
épinière.
Évolution, complications et pronostic..
le traitement doit etre rapide pour éviter des séquelles, notamment une
impuissance. Les récidives sont fréquentes chez les drépanocytaires.
Traitement.
Une ponction à l’aiguille des corps caverneux après une anesthésie locale permet
une décompression rapide. L’injection intracaverneuse d’étiléfrine limite le
risque de récidive.
Prévention et éducation.
Chez le drépanocytaire, l’apprentissage de la technique d’injection
intracaverneuse est utile. Lorsque les épisodes intermittents gênent la vie
courante et/ou deviennent de plus en plus fréquents, un traitement préventif per
os est institué.
2031. PRINZMETAL (ANGOR DE) (>) ANGOR DE PRINZMETAL.
2032. PRIONS (MALADIES DUES AUX). Maladies neurologiques, appelées encéphalites
spongiformes ou démences transmissibles, caractérisées par l’accumulation de
particules protéiques infectieuses (prions) dans les cellules nerveuses du
cerveau. Les formes actuellement connues sont l’encéphalopathie spongiforme
transmissible (>), dont la forme la plus connue est l’ESB ou encéphalopathie
spongiforme bovine, la maladie de Creutzfeld-Jacob (>),la maladie de
Gerstmann-Strdussler-Scheinker (>), l’insomnie familiale fatale (>), et le kuru
(>).
2033. PROCIDENCE DU CORDON OMBILICAL . Complication rare de fin de grossesse qui
correspond à la descente du cordon dans le vagin. Elle se reconnaît par un
écoulement de liquide amniotique accompagné de la présence, dans le vagin, d’une
tige turgescente et battante. Si l’enfant est mort, ce n’est pas une urgence.
Dans les autres cas, il faut réaliser une césarienne le plus rapidement possible
pour extraire l’enfant.
2034. PROGÉRIA . Syndrome de vieillissement prématuré héréditaire de
transmission autosomique récessive. Il en existe deux formes:
• La progéria de l’enfant ou syndrome de Hutchinson-Gilford: apparition dans la
première enfance avec un nanisme, une atmphie cutanée, une calvitie, une
ostéoporose et une artériosclérose; la mort survient entre 10 et 20 ans ;
• La progéria de l’adulte ou syndrome de Werner: apparition des signes dans la deuxième enfance avec un visage en «tête d’oiseau », une petite taille, des membres longs, une calvitie, la perte des dents, une atrophie cutanée, une infertilité, un diabète, une artériosclérose; la mort survient vers 50 ans.
2035. PROLACTINOME ou ADÉNOME A PROLACTINE.
Définition et causes.
Tumeur bénigne développée à partir des cellules lactotropes de l’antéhypophyse
qui est une des principales causes d’hyperprolactinémie.
Epidémiologie.
C’est le plus fréquent des adénomes hypophysaires.
Signes et symptômes.
Chez la femme, il existe une aménorrhée (absence de règles), une galactorrhée
(écoulement de lait), une infertilité, une sécheresse vaginale et une diminution
de la libido. Chez l’homme, on constate une baisse de la libido, voire une
impuissance, une galactorrhée et une gynécomastie (hypertrophie des seins). La
tumeur entraîne parfois des céphalées frontales et une atteinte du champ visuel.
Investigations.
La prolactinémie est élevée et les réponses aux tests dynamiques sont faibles ou
absentes. Le scanner ou l’IRM permettent de localiser la tumeur.
Evolution, complications et pronostic.
Dans les petits adénomes, la guérison peut être définitive après chirurgie. Le
traitement médical réduit sensiblement le volume de ceux de grande taille.
Traitement.
Les petits adénomes sont traités par chirurgie et ceux de grande taille par
traitement médical avec un agoniste dopaminergique (bromocriptine).
Prévention.
Une surveillance est indiquée en cas de grossesse car l’augmentation de volume
d’un adénome existant est possible.
2036. PROLAPSUS GÉNITAL.
Définition et causes.
Descente à travers le bassin osseux des organes pelviens génito-urinaires
(vessie, vagin, utérus et rectum), dont les principales causes sont les
accouchements longs et difficiles, plus ou moins associés à une faiblesse des
tissus et au vieillissement. Chez la femme jeune, il s’agit d’anomalies
congénitales rares.
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente, dont le retentissement urinaire est préjudiciable
pour la vie sociale.
Signes et symptômes.
Association d’une pesanteur pelvienne, d’une tuméfaction vulvaire, de troubles
urinaires (incontinence d’effort…), de troubles sexuels et de troubles de
l’exonération.
Investigations.
L’examen gynécologique permet de faire le diagnostic (abaissement du col,
bombement de la vessie dans le vagin…). Une étude urodynamique est nécessaire
en cas d’indication opératoire.
Evolution, complications et pronostic.
Les principales complications sont urinaires. Le risque de cancer du col est
augmenté.
Traitement.
Le traitement médical s’appuie principalement sur la rééducation périnéale. En
cas d’échec ou de prolapsus important, la chirurgie est indiquée.
Prévention et éducation.
La prévention est essentielle pendant la grossesse, au moment de l’accouchement,
en préservant le périnée (épisiotomie…), en post partum (rééducation
périnéale) et à la ménopause (traitement substitutif).
2037. PROLAPSUS VALVULAIRE MITRAL ou SYNDROME DE BARLOW.
Définition et causes.
Bombement d’une ou des deux valves mitrales dans l’oreillette gauche pendant la
systole, provoquant une fuite plus ou moins importante. Dans la plupart des cas,
la cause est inconnue. Il peut être observé dans certaines maladies : Basedow,
rhumatisme articulaire, cardiopathie ischémique, communication interauriculaire,
Marfan…
Epidémiologie.
Il atteint près de 5 % de la population générale.
Signes et symptômes.
Il est asymptomatique dans la majorité des cas. Dans le cas contraire, les
signes (souvent chez une femme jeune) sont peu spécifiques: douleurs
thoraciques, palpitations, vertiges, anxiété… L’auscultation retrouve un click
en milieu de systole et un souffle en fin de systole.
Investigations.
L’échographie confirme le diagnostic. L’électrocardiogramme est, la plupart, du
temps normal.
Evolution, complications et pronostic.
Dans 80 % des cas, il s’agit d’une forme bénigne. Les formes graves sont
caractérisées, notamment, par une fuite mitrale importante et de nombreuses
extrasystoles ventriculaires sur l’enregistrement Holter. Les principales
complications sont l’insuffisance mitrale, l’endocardite, les troubles du rythme
grave, la mort subite et les accidents vasculaires cérébraux et rétiniens.
Traitement.
Dans les formes bénignes, une simple surveillance suffit. Un suivi plus
rapproché est nécessaire dans les formes graves, car le risque de complications
est plus élevé. Dans ces dernières, le sport de compétition et la contraception
hormonale sont contre-indiqués.
2038. PRONATION DOULOUREUSE.
Définition et causes.
Passage de la tête du radius sous le ligament annulaire qui la plaque contre le
cubitus (ou ulna) au niveau du coude. Le mécanisme le plus fréquent est le
soulèvement d’un enfant par un adulte en tirant sur la main.
Epidémiologie.
Il s’agit de l’atteinte du coude la plus fréquente chez les enfants âgés de I à
5 ans. Elle semble plus fréquente chez les filles et atteint de préférence le
membre supérieur gauche, quel que soit le sexe.
Signes et symptômes.
L’interrogatoire permet d’évoquer le diagnostic: absence de traumatisme et
traction par le bras de l’enfant. L’enfant se met brusquement à pleurer et
refuse de bouger et d’utiliser son bras juste après l’épisode de traction. Il
tient son bras flasque sur le côté, en position d’adduction et de rotation
interne. Il peut bouger les doigts mais pleure dès qu’on essaie de lui bouger le
bras. Il n’existe ni déformation, ni oedème du niveau du coude.
Investigations.
Si l’histoire est typique, aucun examen n’est nécessaire. En cas de doute, une
radiographie sera effectuée pour éliminer une fracture ou lorsque deux
tentatives de réduction de la luxation ont été infructueuses.
Evolution, complications et pronostic.
Il s’agit d’un problème banal qui peut parfois être réglé «accidentellement» par
les parents lors de manipulations du bras pour enfiler un pull ou un manteau, ou
tout simplement en examinant le bras. Lorsque l’enfant est vu dans un délai
supérieur à 4 à 6 heures, la réduction de la luxation peut s’avérer parfois
difficile.
Traitement.
La réduction est d’une simplicité déconcertante: il suffit d’empoigner le coude
avec une main pendant que l’autre exerce une légère traction sur le poignet en
tournant la main vers le haut tout en fléchissant l’avant-bras sur le coude; on
ressent parfois un petit dic (la tête du radius se remet en place), l’enfant est
soulagé et bouge de nouveau le bras comme par «miracle ».
Prévention et éducation.
L’éducation des parents doit inclure la connaissance de cet accident afin de
pouvoir éviter les gestes et les attitudes qui le favorisent.
2039. PROSTATITE.
Définition et causes.
Inflammation de la glande prostatique. Elle peut être aiguë et d’origine
bactérienne (par voie ascendante à partir de l’urètre ou, plus rarement, par
voie sanguine), ou chronique par persistance de germes dans les voies séminales
et urinaires. Les manoeuvres endoscopiques (cystoscopie, sondage vésical
intermittent ou à demeure…) peuvent être à l’origine de l’infection.
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente chez l’adulte et exceptionnelle avant la puberté.
Signes et symptômes.
Dans la forme aiguë, les signes sont d’apparition brutale, avec une fièvre
élevée, des signes urinaires (pollakiurie = mictions très fréquentes, dysurie =
difficulté pour uriner, impériosité, brûlures mictionnelles). Le toucher rectal
retrouve une grosse prostate douloureuse.
Investigations.
L’examen cytobactériologique des urines est le seul examen vraiment
indispensable pour identifier le germe.
Evolution, complications et pronostic .
L’évolution est, en général, favorable sous traitement antibiotique. Les
principales complications sont la formation d’un abcès, la diffusion vers les
organes génitaux externes (épididymite, orchite…), voire une septicémie, ou
l’évolution vers la chronicité.
Traitement.
Il comporte une antibiothérapie par fluoroquinolones , initialement par voie
veineuse, le repos et, éventuellement, des anti-inflammatoire. En cas de
rétention urinaire, le sondage est interdit et le recours au cathétérisme
suspubien est obligatoire.
Prévention.
Le respect de règles d’asepsie rigoureuse lors des manoeuvres endoscopiques
permet de limiter le risque de prostatite.
2040. PROTÉE (SYNDROME DE). Syndrome malformatif très rare associant
l’hypertrophie d’une moitié du corps, des excroissances osseuses (exostoses), le
développement excessif des doigts (macrodactylie) et diverses tumeurs (angiomes,
lipomes).
2041. PROTÉINE C (DÉFICIT EN).
Définition et causes.
Maladie génétique de transmission autosomique, en général dominant, caractérisée
par un déficit en protéine C, synthétisée par le foie et intervenant dans la
coagulation physiologique. La gravité est variable selon que le patient est
hétérozygote (un gène déficient) ou homozygote (deux gènes déficients). La
conséquence est un risque de thrombose veineuse accru.
Epidémiologie.
La prévalence des hétérozygotes est estimée à 1 cas sur 200 dans la population
générale. La prévalence des hétérozygotes ou homozygotes ayant des
manifestations cliniques au cours de l’enfance ou à l’âge adulte est estimée
entre 1/6 000 et 1/36000. Le déficit grave s’exprimant dès la naissance est
beaucoup plus rare, avec une cinquantaine de cas décrits actuellement dans le
monde.
Signes et symptômes.
Les troubles sont très variables en fonction de l’intensité du déficit:
thromboses veineuses plus fréquentes dans les situations à risque, thromboses
veineuses à répétition, nécroses cutanées au début d’un traitement par
antivitamine K, accidents thrombotiques graves à la période néonatale.
Investigations.
Le dosage plasmatique de la protéine C affirme le diagnostic.
Evolution, complications, pronostic.
Dans la forme néonatale, le tableau initial (dans les heures ou les jours qui
suivent la naissance) est celui d’un purpura nécrotique sans fièvre. Non
traitée, la maladie évolue vers un décès par dans un tableau de thromboses
multiviscérales. Dans les autres cas, les complications sont celle des
thromboses veineuses profondes (>), notamment l’embolie pulmonaire. Le
traitement par les antivitamines K peut entraîner, chez certains patients, la
survenue d’hématomes avec des nécroses cutanées.
A traitement.
En cas de déficit modéré, le traitement utilise l’héparine avec un relais par un
antivitamine K. En cas de déficits importants ou de complications avec les
antivitamines K, il est possible depuis peu d’utiliser des concentrés de
protéine C humaine , tant en curatif qu’en préventif.
A prévention.
En cas de thromboses veineuses à répétition, un bilan complet de l’hémostase
intégrant le dosage de la protéine C est nécessaire.
2042. PROTÉINE S (DÉFICIT EN).
Déficit génétique du même type que celui en protéine C (>).
2043. PROTÉINOSE ALVÉOLAIRE PULMONAIRE ou LIPOPROTÉINOSE ALVÉOLAIRE PULMONAIRE.
Définition et causes.
Pneumopathie infiltrante diffuse caractérisée par l’accumulation dans les
alvéoles d’une substance composée de protéines et de phospholipides. La cause
reste obscure.
Epidémiologie.
Très rare. Elle atteint essentiellement l’homme d’âge moyen.
Signes et symptômes.
Le tableau clinique est variable et peu spécifique : dyspnée effort, toux sèche,
douleurs thoraciques diffuses…
Investigations.
Le bilan comprend une radiographie et un scanner thoracique, des gaz du sang et
des épreuves fonctionnelles respiratoires. Le diagnostic de certitude nécessite
une fibroscopie bronchique avec un lavage bronchiolo-alvéolaire qui met en
évidence une substance lipoprotéique.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est variable, avec 30 % de rémissions spontanées en quelques mois et
plus de 50% avec le traitement. Parfois peut se développer une insuffisance
respiratoire restrictive sévère nécessitant une oxygénothérapie permanente. Les
principales complications sont les surinfections.
Traitement.
Il utilise les grands lavages pulmonaires sous anesthésie générale et avec une
intubation sélective.
2044. PROTOPORPHYRIE. Porphyrie (>) dont la caractéristique est que les urines
des malades ne présentent aucune anomalie dans le taux de porphyrines. Il s’agit
d’une maladie héréditaire de transmission autosomique dominante. Elle se
manifeste en général dès l’enfance par des lésions de type urticaire
(démangeaisons, rougeur, oedème, douleur) sur les zones exposées au soleil. Le
traitement par bêta-carotène est relativement efficace.
2045. PRUNE-BELLY (SYNDROME DE). Malformation congénitale associant l’absence
d’un ou plusieurs plans de la musculature abdominale et de graves anomalies de
l’appareil urogénital.
2046. PRURIGO. Nom générique donné à certaines affections cutanées,
caractérisées par l’existence de papules assez volumineuses, recouvertes le plus
souvent d’une petite croûte noirâtre due à des lésions de grattage.
2047. PSEUDOHERMAPHRODISME FÉMININ.
Définition et causes.
Anomalie de la différenciation sexuelle avec la présence de signes de
virilisation plus ou moins accentués, présents dès la naissance, chez des sujets
de caryotype XX dont les gonades sont des ovaires. La principale cause est une
hyperplasie des surrénales (>) foetales qui provoque un excès de production
d’androgènes. Plus rarement, l’hyperandrogénie peut être d’origine maternelle
(tumeur, médicaments).
Epidémiologie.
Relativement fréquent.
Signes et symptômes.
Les principaux signes sont une hypertrophie du clitoris qui peut aller jusqu’à
un aspect masculin.
Investigations.
Elles comprennent la recherche du corpuscule de Barr sur frottis de la joue,
complétée par un caryotype, et un bilan hormonal.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic est bon sous réserve d’un traitement à vie.
Traitement.
Le sexe d’élevage doit être féminin. Le traitement hormonal substitutif utilise
les corticoïdes. Une intervention chirurgicale précoce corrige la virilisation
des organes génitaux externes et permet l’abouchement du vagin en position
normale. La maternité est possible.
Prévention.
Un diagnostic anténatal de l’hyperplasie des surrénales (maladie héréditaire de
transmission autosomique récessive) dans la fratrie permet un traitement
préventif in utero si l’enfant est une fille.
2048. PSEUDOHERMAPHRODISME MASCULIN.
Définition et causes.
Anomalie de la différenciation sexuelle caractérisée par une virilisation
insuffisante des organes génitaux internes et/ou externes chez des sujets de
caryotype XY porteurs de testicules. Les principales causes sont un
développement imparfait (dysgénésie) testiculaire, un déficit de synthèse de la
testostérone, une insensibilité aux androgènes (4 Testicule féminisant).
Epidémiologie.
Rare.
Signes et symptômes.
L’aspect des organes génitaux est variable, allant d’un micropénis avec anomalie
de l’abouchement de l’uretère (hypospadias) à un aspect féminin normal. Les
testicules sont, le plus souvent extériorisés, présents au niveau des bourrelets
génitaux, ressemblant parfois à des hernies inguinales.
Investigations.
Elles comprennent un caryotype et un bilan hormonal.
Evolution, complications et pronostic.
Le choix du sexe est difficile (ne faire aucune déclaration de naissance
initiale, ni attribution de prénom avant le résultat du bilan). En cas de
dysgénésie (développement imparfait) testiculaire ou de testicules abdominaux,
le risque de cancérisation impose la castration.
Traitement.
Les possibilités thérapeutiques dépendent de la cause et de l’anatomie
extérieure du sujet.
2049. PSEUDOKYSTES DU PANCRÉAS (>) PANCRÉAS. (PSEUDOKYSTES DU).
2050. PSEUDOMYXOME PÉRITONÉAL ou MALADIE GÉLATINEUSE DU PÉRITOINE.
Maladie rare caractérisée par une volumineuse ascite, en rapport avec une tumeur
mucineuse péritonéale. Le traitement fait appel à la chirurgie et la
chimiothérapie.
2051. PSEUDOPELADE DE BROCQ. Il s’agit d’une maladie qui entraîne une perte des
cheveux (alopécie). Elle se caractérise par de petites plaques incomplètement
dénudées, nacrées, disséminées comme des « pas dans la neige», touchant surtout
les femmes entre 25 et 45 ans. Il n’existe pas de traitement mais l’évolution
est, en général, lente et limitée.
2052. PSEUDOPOLYARTH RITE RHIZOMÉLIQUE
Définition et causes
Rhumatisme inflammatoire chronique des ceintures (épaules et hanches) de cause
inconnue. Il peut être associé à la maladie de Horton (>).
Epidémiologie
Elle s’observe après 50 ans et surtout après 60, avec une fréquence deux fois
plus importante chez la femme que chez l’homme.
Signes et symptômes
Il existe des douleurs et un enraidissement des épaules et du bassin entraînant
une impotence fonctionnelle, associés à des signes généraux (fièvre, anorexie,
asthénie, amaigrissement).
Investigations
Les radiographies sont normales et la vitesse de sédimentation est très
augmentée. La biopsie de l’artère temporale peut montrer une artérite
gigantocellulaire (comme dans la maladie de Horton).
Evolution, complications et pronostic
En général, la maladie guérit sous traitement en 1 à 3 ans. En cas d’association
avec une artérite crânienne, le risque de cécité est grand et le traitement doit
être très précoce.
Traitement
C’est une corticothérapie au long cours qui ne sera diminuée que progressivement
devant la disparition des signes cliniques.
2053. PSEUDOXANTHOME ÉLASTIQUE ou MALADIE DE GRONBLADSTRANDBERG.
Définition et causes.
Maladie génétique hétérogène, le plus souvent de transmission autosomique
récessive, caractérisée par une anomalie généralisée du tissu conjonctif
provoquant des atteintes cutanées, oculaires et vasculaires.
Epidémiologie.
C’est une affection rare.
Signes et symptômes.
La peau du cou et des aisselles, des régions inguinales et péri-ombilicales est
épaissie, lâche, et a perdu son élasticité. Des anomalies rétiniennes peuvent
entraîner des hémorragies et un déficit visuel. L’atteinte vasculaire se
manifeste par une artériopathie des membres inférieurs, un angor, une
hypertension artérielle ou un accident vasculaire cérébral.
Investigations.
La biopsie cutanée et le fond d’oeil montrent des anomalies caractéristiques.
Evolution, complications et pronostic .
L’évolution dépend de la gravité et de la localisation des lésions vasculaires.
Traitement.
Il est symptomatique. Le laser est indiqué pour les lésions rétiniennes.
Prévention et éducation
Il faut éviter les expositions solaires et contrôler tous les facteurs de risque
vasculaire.
2054. PSITTACOSE ou ORNITHOSE.
Définition et causes.
Pneumopathie infectieuse due à Chalmydia psittaci et transmise par voie
respiratoire par certains oiseaux. On parle de psittacose pour les perroquets et
les perruches et d’ornithose pour les volailles, les pigeons… L’incubation est
de 1 à 3 semaines.
Epidémiologie.
Elle se rencontre chez les possesseurs d’oiseaux de compagnie et chez les
professionnels (zoo, élevage de volailles…).
Signes et symptômes.
Le début peut être brutal ou insidieux, avec fièvre, frissons, malaise général
et anorexie, puis apparaît une toux sèche pénible.
Investigations.
La radiographie pulmonaire montre des signes de pneumopathie atypique. La
sérologie affirme le diagnostic.
Evolution, complications et pronostic.
Une endocardite, une péricardite et une pleurésie sont possibles. En l’absence
de traitement, la mortalité est non négligeable dans les cas graves.
Traitement.
Les tétracyclines sont efficaces.
Prévention et éducation.
La prévention associe l’isolement obligatoire et le traitement systématique
(alimentation avec des antibiotiques) des oiseaux d’importation. Le patient doit
être mis en isolement strict car la toux et les crachats sont contagieux.
2055. PSORIASIS.
Définition et causes.
Dermatose érythématosquameuse caractérisée par un état inflammatoire et une
prolifération des cellules épidermiques dont la différenciation est anormale.
Elle est héréditaire (30 % de cas familiaux), et révélée et aggravée par de
nombreux facteurs environnementaux (infections, psychologiques, médicaments).
Epidémiologie.
Elle atteint 2 à 3 % de la population.
Signes et symptômes.
Plaques rouges recouvertes de squames blanchâtres de taille et en nombre
variable, peu prurigineuses et siégeant préférentiellement de manière symétrique
sur les coudes, les genoux et également sur le cuir chevelu ou la région
lombosacrée.
Investigations.
Le diagnostic est clinique, un examen anatomopathologique est rarement utile.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est chronique, avec des poussées de durée variable, et le traitement
n’est que suspensif. Les principales complications sont les formes généralisées,
le rhumatisme psoriasique (dans 20 à 30 % des cas), les surinfections et
l’eczématisation.
Traitement.
Dans les formes peu étendues, le traitement local utilise la vaseline salicylée,
un dérivé de la vitamine D, les corticoïdes, un rétinoïde local. Dans les formes
graves (plus de 40 % de la surface du corps touchée), un traitement par voie
générale est indiqué. Les moyens dispo¬nibles sont les rétinoïdes, la
PUVA-thérapie (rayons ultraviolets après absorption de psoralènes), le
méthotrexate ou la ciclosporine. Du fait de la chronicité et de l’incidence
esthétique, un soutien psychologique est nécessaire
2056. PSORIASIS DES LANGES. Éruption bien délimitée survenant sous les couches,
caractérisée par des plaques rouges recouvertes de squames blanchâtres bien
limitées, totalement indolores. Il touche en général les enfants après 6 mois.
Le diagnostic est difficile et il est souvent confondu avec une dermatite
séborrhéique (>) ou une candidose (>). Le traitement comprend l’utilisation de
bains, de produits émollients, de crèmes hydratantes et de pommades à base de
corticoïdes. La guérison s’effectue sans séquelles dans la moitié des cas, mais
une évolution est possible vers un psoriasis avant l’âge de 15 ans (25 % des
cas) ou une dermatite atopique (25 % des cas).
2057. PSYCHOSE DÉLIRANTE AIGUË ou (>) BOUFFÉEDÉLIRANTE.
2058. PSYCHOSE HALLUCINATOIRE CHRONIQUE. Définition et causes. Maladie mentale
caractérisée par l’importance et l’intensité des hallucinations. Les
Anglo-Saxons la considèrent comme une schizophrénie (4) tardive.
Epidémiologie.
Le début se situe le plus souvent entre 30 et40 ans, avec une prédominance
féminine.
Signes et symptômes.
Le début se manifeste par un délire d’allure paranoïaque. Le malade se sent
espionné, dans un environnement hostile, il entend des voix, des pensées
s’introduisent dans son esprit. Puis les hallucinations auditives et psychiques
(voix malveillantes, menaçantes, injurieuses) dominent, avec des impressions
désagréables et douloureuses attribuées à des influences extérieures. Le malade
se sent téléguidé, privé de sa liberté de penser, d’agir et sous l’emprise d’une
commande à distance (syndrome d’influence).
Evolution, complications et pronostic.
Il n’existe pas de trouble du comportement et l’adaptation à la vie quotidienne
reste bonne pendant de longues années (le noyau délirant et hallucinatoire est
appelé «enkysté»).
Traitement.
Il est fondé sur les neuroleptiques qui seront poursuivis durant des années et
arrêtés progressivement en fonction de l’évolution.
2059. PSYCHOSE MANIACO-DÉPRESSIVE.
Définition et causes.
Trouble de l’humeur d’évolution périodique définie par une succession de
périodes dépressives et/ou de périodes maniaques, séparées par des intervalles
libres. La cause est inconnue mais il existe une prédisposition familiale. On
distingue la maladie unipolaire, définie par la succession d’épisodes
dépressifs, et la maladie bipolaire, définie par la survenue d’épisodes
dépressifs et d’épisodes maniaques.
Epidémiologie.
La forme bipolaire touche 1 % de la population, avec un début entre 20 et 30
ans, et un sex ratio de 1. La forme unipolaire touche 3 % de la population, avec
un début entre 30 et 40 ans, un sex ratio de 2 femmes pour 1 homme.
Signes et symptômes.
Les épisodes dépressifs sont mélancoliques avec une tristesse, un profond
pessimisme, une mésestime de soi, une indifférence pour le monde environnant, un
ralentissement psychomoteur, une insomnie et une réduction de la libido. Les
accès maniaques sont caractérisés par une euphorie, un optimisme et une
mégalomanie, une excitation psychomotrice avec une fuite des idées, une
agitation et une desinhibition instinctuelle (grossièreté, attentats à la
pudeur), une insomnie, une anorexie et une augmentation de la libido.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution se fait souvent vers un raccourcissement des intervalles libres et
une augmentation de la durée des accès. En moyenne, 20 des patients décèdent par
suicide. Il existe un risque accru d’abus ou de dépendance à l’alcool et de
toxicomanie.
Traitement.
Les accès dépressifs bénéficient des médicaments antidépresseurs et de la
sismothérapie (électrochocs). Les accès maniaques font appel aux neuroleptiques.
Une hospitalisation sous contrainte (HDT = hospitalisation sur demande d’un
tiers) est souvent nécessaire, associée parfois à une protection des biens en
cas d’accès maniaque (risque de dépenses inconsidérées).
Prévention.
Le risque de récidive justifie un traitement préventif (sels de lithium) et une
prise en charge psychothérapeutique.
2060. PSYCHOSE PUERPÉRALE.
Définition et causes.
Psychose (maladie mentale où le sujet n’est pas conscient de ses troubles)
survenant brutalement dans les semaines qui suivent l’accouchement. Il s’agit
vraisemblablement de la révélation d’une maladie préexistante déclenchée par le
stress de la grossesse et de l’accouchement.
Epidémiologie.
Peu fréquent. Des signes prémonitoires se manifestent parfois pendant la
grossesse (anxiété, cauchemars, agitation nocturne…).
Signes et symptômes.
Les principaux symptômes sont des bouffées délirantes avec une confusion, des
troubles de l’humeur, en général une anxiété, pouvant alterner avec des phases
d’excitation. Les thèmes délirants les plus fréquents sont centrés autour de la
relation mère-enfant, avec fréquemment une négation de la grossesse et de
l’accouchement.
Evolution, complications et pronostic.
Dans la majorité des cas, l’évolution se fait vers une guérison en 3 à 5 mois,
mais le passage à la chronicité est possible. Le risque de suicide et
d’infanticide doit être pris en compte. Le taux de récidive, en cas de grossesse
ultérieure, est estimé à 20 %.
Traitement.
Le traitement utilise les neuroleptiques et une psychothérapie.
2061. PTÉRYGION. Voile de conjonctive s’étendant sur la cornée en partant de
l’angle interne de l’oeil. La cause serait une irritation chronique liée à la
vie au grand air (vent, poussières…). Les principales complications, en cas
d’extension, sont les troubles de la vision et des problèmes inflammatoires
locaux. Le traitement est chirurgical.
2062. PTOSIS. Chute de la paupière supérieure. Il peut être congénital (anomalie
du muscle releveur) ou acquis : sujets âgés, causes neurologiques (syndrome de
Claude Bernard-Homer >, par exemple) ou musculaires (myopathie, myasthénie),
lésions cicatricielles conjonctivales ou traumatismes. En cas de gêne
importante, le traitement est chirurgical.
2063. PUBERTÉ PRÉCOCE.
Définition et causes.
Apparition de signes de maturation sexuelle survenant avant l’âge de 10 ans et
demi chez le garçon et 8 ans chez la fille. On distingue:
• La puberté précoce vraie, liée une activation hypothalomohypophysaire (tumeur
cérébrale, sans cause retrouvée) ;
• La fausse puberté précoce (tumeur surrénale ou ovarienne) ;
• La puberté précoce dissociée (prise d’oestrogène, sans cause retrouvée). Deux
causes rares sont la puberté précoce masculine familiale (>) et le syndrome de
McCune-Albright (>).
Epidémiologie.
La puberté précoce est trois fois plus fréquente chez les filles que chez les
garçons.
Signes et symptômes.
Le signe essentiel est une poussée de croissance. Chez la fille, il existe un
développement des seins, de la pilosité axillaire et pubienne, puis une
apparition des règles. Chez le garçon, les testicules augmentent de volume, la
verge et la pilosité se développent et la voix mue. Dans la puberté précoce
vraie, il existe un parallélisme entre le développement des caractères sexuels
et l’augmentation du volume des gonades. Dans la forme dissociée, les caractères
sexuels secondaires se développent alors que les gonades restent immatures. Dans
la forme dissociée, il existe un développement isolé des seins et de la
pilosité.
Investigations.
Le bilan hormonal montre une élévation de la FSH et de la LH, ainsi que de la
testostérone chez le garçon et de l’cestradiol chez la fille. Le scanner est
essentiel à la recherche d’une tumeur intracrânienne.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est marquée par deux problèmes: l’un psychologique, et l’autre
concernant la croissance avec une taille finale très inférieure au potentiel
génétique des parents.
Traitement.
Il comprend le traitement de la cause éventuelle (tumeur) et les agonistes de la
LH-RH qui bloquent la maturation osseuse et permettent d’améliorer la taille
finale.
2064. PUBERTÉ PRÉCOCE MASCULINE FAMILIALE. Syndrome héréditaire rare touchant
les garçons, caractérisé par une puberté précoce (>). La cause est une
activation autonome des cellules de Leydig au niveau des testicules,
indépendante de la commande hypothalamohypophysaire. Le traitement utilise des
antagonistes des androgènes qui réduit la production de testostérone par les
cellules de Leydig.
2065. PULPITE. Inflammation de la pulpe dentaire qui apparaît principalement
dans le cadre des caries dentaires. Elle se manifeste par des douleurs intenses
(« rage de dents »). En l’absence de traitement, elle évolue vers la gangrène
pulpaire. Le traitement consiste à extirper la pulpe sous anesthésie locale et à
obturer la cavité par un pansement inerte.
2066. PURPURA FULM/NANS. Complication gravissime et brutale, exceptionnelle, des
méningites bactériennes, principalement à méningocoques (>), survenant
principalement chez l’enfant. Il s’agit d’un syndrome méningé fébrile avec
l’apparition brutale de petites taches cutanées rouges, ne s’effaçant pas à la
pression (purpura), rapidement extensives. L’évolution est le plus souvent
fulgurante vers un état de choc et un décès. Le traitement antibiotique doit
être débuté sans délai, avant même la ponction lombaire.
2067. PURPURA RHUMATOÏDE ou PURPURA DE HENOCH-SCHONLEIN.
Définition et causes.
Vascularite (inflammation des vaisseaux) aiguë ou chronique touchant
essentiellement les petits vaisseaux cutanés, articulaires, digestifs ou rénaux.
Un mécanisme allergique déclenché par certaines infections respiratoires est
discuté.
Epidémiologie.
Cette affection s’observe essentiellement chez l’enfant entre 4 et 10 ans, avec
une prédominance masculine et une survenue plus fréquente en hiver.
Signes et symptômes.
Le début est brutal avec une éruption faite de petits points rouges (purpura) au
niveau des membres inférieurs, des douleurs articulaires, des douleurs
abdominales à type de coliques, et une atteinte rénale (néphropathie
glomérulaire) avec hématurie et protéinurie.
Investigations.
Le diagnostic est clinique. La biopsie rénale permet d’évaluer l’atteinte
glomérulaire.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est bénigne dans la majorité des cas, avec une régression des
symptômes en quelques semaines, mais les rechutes sont fréquentes. La principale
complication est l’évolution vers l’insuffisance rénale chronique.
Traitement.
Il consiste en un repos au lit avec un lever progressif. Les corticoïdes sont
largement utilisés pour contrôler les douleurs abdominales et articulaires. En
cas d’atteinte rénale, les résultats du traitement par les corticoïdes et les
immunosuppresseurs restent incertains.
2068. PURPURA THROMBOPÉNIQUE IDIOPATHIQUE (PTI) .
Définition et causes.
Thrombopénie (diminution du nombre de plaquettes) due à un mécanisme
immunologique entraînant la destruction des plaquettes. Les causes sont
principalement des infections virales .
Epidémiologie.
L’affection survient à tout âge, avec une fréquence augmentée chez l’enfant de
moins de 10 ans et la femme jeune.
Signes et symptômes.
Les petits points hémorragiques cutanés et muqueux apparaissent en général 10 à
20 jours après une infection.
Investigations.
L’hémogramme montre une diminution isolée du nombre de plaquettes. Le
myélogramme est riche en mégacaryocytes. Des anticorps anti-plaquettes fixés sur
les membranes des plaquettes et libres dans le sérum peuvent être mis en
évidence.
Evolution, complications et pronostic.
Les purpuras aigus, survenant surtout chez l’enfant, apparaissent brutalement et
guérissent en quelques semaines (une rechute est possible). Les purpuras
chroniques, survenant surtout chez l’adulte, débutent progressivement et
évoluent de façon variable avec des phases d’aggravation durant quelques mois ou
toute la vie. Des complications hémorragiques sévères (cérébrales ou viscérales)
peuvent entraîner la mort du patient.
Traitement.
Les médicaments utilisés sont les corticoïdes et les immunoglobulines
polyvalentes intraveineuses. La splénectomie (ablation de la rate) est indiquée
dans certaines formes chroniques. Les transfusions de plaquettes sont réservées
aux manifestations hémorragiques graves.
2069. PURPURA THROMBOTIQUE THROMBOCYTOPÉNIQUE (PTT) ou SYNDROME DE MOSCHOWITZ.
Définition et causes.
Maladie rare caractérisée par des lésions anatomiques des petits vaisseaux qui
s’accompagne d’une destruction des globules rouges et d’une diminution du nombre
de plaquettes (thrombopénie). La cause est inconnue.
Epidémiologie.
Cette affection touche des sujets de tous âges, plus volontiers les adultes
jeunes et plus particulièrement des femmes.
Signes et symptômes.
Les signes cutanés (petits points rouges hémorragiques) sont discrets. Il existe
une fièvre, des signes neurologiques labiles et un ictère.
Investigations.
La thrombopénie est sévère. On retrouve une anémie hémolytique (>) avec une
schizocytose (globules rouges fragmentés, déformés en forme de casque ou de
triangle). Le bilan rénal montre une insuffisance rénale.
Evolution, complications et pronostic.
Maladie autrefois constamment mortelle. Aujourd’hui, une rémission est obtenue
dans les deux tiers des cas de traitement précoce.
Traitement.
Il consiste en des plasmaphérèses associées à un traitement symptomatiques
(transfusions de globules rouges, de plaquettes…). On peut également utiliser
les antiagrégants plaquettaires.
2070. PURTILO (SYNDROME DE) . Syndrome d’infection chronique au virus
Epstein-Barr, caractérisé par un syndrome lymphoprolifératif (multiplication
anormale de lymphocytes), qui touche surtout l’enfant. Il peut se manifester par
une évolution aiguë, voire fulminante, ou par une forme plus chronique, avec des
épisodes fébriles récurrents. Cliniquement, il existe une polyadénopathie et une
hépatosplénomégalie.
2071. PUSTULOSE EXANTHÉMATIQUE AIGUË GÉNÉRALISÉE.
Forme de toxidermie médicamenteuse (>) caractérisée par une fièvre et une
éruption brutale de pustules sur une peau rouge. Il existe souvent une
hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles, associée à une
hyperéosinophilie. Les médicaments responsables sont des antibiotiques de
différentes classes, des inhibiteurs calciques et les antipaludéens. Les signes
apparaissent dans un délai variable après la prise du médicament (24 heures à 15
jours) et la guérison survient en 7 à 10 jours après son arrêt.
2072. PUSTULOSE SOUS-CORNÉE ou (>) SNEDDON-WILKINSON (SYNDROME DE).
2073. PYCNODYSOSTOSE. Maladie osseuse héréditaire de transmission autosomique
récessive. Elle se manifeste par un nanisme avec des membres courts et une
fragilité osseuse, source de fractures pour des traumatismes minimes. En outre,
le visage est rétréci, le menton fuyant et il existe une déformation du tronc
(cyphoscoliose). La durée de vie est habituellement normale.
2074. PYÉLONÉPHRITE AIGUË.
Définition et causes.
Infection du bassinet et du rein due, le plus souvent, à un germe remontant les
voies urinaires. Toutes les causes d’obstruction et de stase des urines (calcul,
malformation, tumeur, grossesse) vont favoriser l’infection. Le germe le plus
souvent rencontré est Escherichia coli, puis ce sont Proteus mirabilis,
Klebsiella et Enterobacter.
Epidémiologie.
C’est une affection fréquente qui représente 20 % des infections graves
extrahospitalières. La plupart des cas s’observent chez la femme jeune.
Signes et symptômes.
Le tableau clinique associe une fièvre élevée avec des frissons, des douleurs
lombaires et des signes urinaires (brûlures, difficultés pour uriner = dysurie,
mictions fréquentes = pollakiurie).
Investigations.
L’examen cytobactériologique des urines et les hémocultures permettent
d’identifier le germe. Le bilan sanguin retrouve une hyperleucocytose et des
signes d’infection. Un bilan rénal est nécessaire pour évaluer le retentissement
rénal. L’échographie initiale recherche un gros rein, un abcès ou une dilatation
des voies urinaires. Après la mise en route du traitement un uroscanner peut
être utile pour apprécier les lésions rénales.
Evolution, complications et pronostic.
L’évolution est, en général, rapidement favorable lorsque le traitement est
précoce. La principale complication est le choc septique (>).
Traitement.
L’antibiothérapie est débutée dès que les prélèvements bactériologiques ont été
effectués et sera poursuivie 2 à 6 semaines. Elle utilise initialement une
céphalosporine de troisième génération ou une fluoroquinolone, puis le
traitement sera adapté en fonction des résultats de l’antibiogramme. Un
aminoside n’est associé que dans les formes sévères. En cas d’obstacle sur les
voies urinaires, un drainage s’impose.
Prévention.
En cas de récidive, un bilan urologique complet est nécessaire à la recherche
d’une cause déclenchante, notamment une malformation.
2075. PYÉLONÉPHRITE CHRONIQUE. Lésions rénales réalisant une néphrite
interstitielle chronique (>) dues à une infection urinaire chronique et
récidivante. En l’absence de cause urologique curable (obstacle,
malformation…), l’évolution se fait lentement vers l’insuffisance rénale
chronique.
2076. PYÉLONÉPHRITE XANTHOGRANULOMATEUSE. Inflammation rénale résultant d’une
réponse immune anormale à un obstacle compliqué d’infection. Cette affection
atteint en général une femme de la cinquantaine souffrant, depuis plusieurs
années, de lithiases rénales à l’origine d’épisodes infectieux. Elle se
manifeste par l’apparition progressive de douleurs lombo-abdominales, de fièvre,
d’asthénie, d’anorexie et d’une perte de poids. Le traitement consiste le pus
souvent en une néphrectomie.
2077. PYLE (MALADIE DE)ou DYSPLASIE MÉTAPHYSAIRE. Maladie osseuse héréditaire,
de transmission probablement autosomique dominante (parfois récessive). Les
patients ont une morphologie normale, à l’exception de déformations en valgus
des genoux (jambes arquées). Les anomalies radiologiques (os longs mal modelés
et corticales minces) sont plus marquées que les signes cliniques. Deux
complications peuvent se rencontrer: la scoliose et une fragilité osseuse.
2078. PYODERMA FACIAL. Forme fulminante de la rosacée (>) qui débute de manière
soudaine chez une femme de 30 à 40 ans. Les pustules sont très nombreuses et
douloureuses ; une fièvre et des douleurs articulaires (arthralgies) peuvent
être associées.
2079. PYODERMA GANGRENOSUM.
Définition et causes.
Dermatose neutophilique aseptique, de cause inconnue, significativement associée
à certaines hémopathies malignes ou à des maladies inflammatoires (rectocolite
hémorragique, maladie de Crohn, polyarthrite rhumatoïde ou spondylarthrite).
Signes et symptômes.
Au début apparaissent une ou plusieurs pustules entourées d’un halo
inflammatoire qui évoluent vers une plaque infiltrée, ulcérée (apparition
fréquente sur les zones de traumatisme, comme les points de ponction veineuse).
On constate également une fièvre, une fatigue et des atteintes articulaires.
Investigations.
La biopsie cutanée montre un infiltrat massif de polynucléaires neutrophiles.
Evolution, complications et pronostic.
Le pronostic dépend de celui des pathologies associées.
Traitement
Corticoïdes.
2080. PYOMYOSITE.
Définition et causes.
Formation d’abcès profonds dans les gros muscles striés. Les abcès peuvent se
développer par extension d’une infection locale (os ou tissu mou) ou par voie
sanguine, vraisemblablement sur un muscle lésé par un traumatisme antérieur
méconnu. Les musdes quadriceps et fessiers sont les plus fréquemment touchés.
Epidémiologie.
C’est une affection rare qui survient chez des sujets affaiblis (sidéens
notamment).
Signes et symptômes.
Il existe des douleurs à type de crampes suivies d’un oedème et d’une gêne à la
mobilisation avec une fièvre modérée. A la palpation, le muscle est induré,
douloureux et retrouve, dans la moitié des cas, une fluctuation (phase
suppurée).
Investigations.
L’aspiration à l’aiguille ramène du pus qui contient presque toujours du
staphylocoque doré.
Evolution, complications et pronostic.
La principale complication est l’extension avec des lésions musculo-tendineuses
pouvant laisser des séquelles.
Traitement.
A la phase non suppurée, l’antibiothérapie seule suffit. En présence d’une
collection de pus, l’incision et le drainage chirurgical sont nécessaires.
2081. PYROPOÏKI LOCYTOSE HÉRÉDITAIRE. Maladie héréditaire caractérisée par une
anomalie de la membrane des globules rouges, ce qui les rend plus fragiles. Elle
est rattachée à l’elliptocytose héréditaire (>), dont elle semble être une des
formes sévères. Sa spécificité est la présence de petites hématies de forme
bizarre qui éclatent à des températures de 44 à 45 °C.
2082. PYROSIS. Sensation de brûlure prenant naissance au niveau du creux
épigastrique, remontant en arrière du sternum et pouvant aller jusqu’au cou.
Elle se manifeste en général après un repas ou en position allongée et peut être
accompagné d’une remontée du contenu acide de l’estomac jusque dans la bouche.
La cause la plus fréquente est le reflux gastro-oesophagien.
2083. PYRUVATE KINASE (DÉFICIT EN). Déficit rare d’un enzyme du globule rouge,
la pyruvate kinase, transmis sur le mode autosomique récessif, qui se traduit
par une hémolyse, entraînant une anémie dont la sévérité dépend du degré de
l’atteinte. Le traitement comprend l’apport quotidien d’acide folique et des
transfusions dans les crises aiguës. La splénectomie peut parfois entraîner une
amélioration.
Explorer :
A lire aussi:
- DICTIONNAIRE DES MALADIES T – U – V – W – X – Y – Z.S’informer de maladies comme par exemple la tachycardie, tendinite, thrombose, toxoplasmose, tuberculose, urticaire, varicelle, varices, vitiligo, zona. Consultez votre dictionaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES T – U – V – W – X – Y – Z. La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES Q – R – SDécouvrez des maladies comme reflux, rhinopharyngite, roséole, rougeole, sarcoïdose, scarlatine, schizophrénie, sciatique, sclérose en plaques, scoliose, septicémie, sida, sinusite, spina Bifida, syphilis. Consultez votre dictionaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES Q – R – S La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES N – O – PDécouvrez des maladies comme narcolepsie, orgelet, ostéoporose, paludisme, pancréatite, papillomavirus, pervers narcissique, pharyngite, phlébite, pneumonie, pneumothorax, polype, progéria, psoriasis, psychose. Consultez votre dictionaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES N – O – P La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des effets […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES K – L – MDécouvrez des maladies comme : leucémie, lumbago, lupus, maladie, maladie de Charcot, maladie de Crohn, maladie de Lyme, maladie de Verneuil, malaise vagal, méningite, migraine, mononucléose, mucoviscidose, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES K – L – M La […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES H – I – JDécouvrez des maladies comme : hallux valgus, hémorroïdes, hépatite B, hernie discale, hernie hiatale, hernie inguinale, herpès, hypertension, hyperthyroïdie, hypothyroïdie, impétigo, infarctus, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES H – I – J La pathologie est l’étude des maladies, […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES F – Gdécouvrez des maladies comme : fibromyalgie, furoncle, gale, gangrène, gastro entérite, glaucome, grippe, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES F – G La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES BDécouvrez des maladies comme : boulimie, bouton de fièvre, BPCO, bronchite, burn-out, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES B La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES CDécouvrez des maladies comme : cancer, chlamydia, cholestérol, conjonctivite, constipation, coqueluche, cystite, cytomégalovirus. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES C La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des effets morbides qu’elle entraîne. C Bacchus C Définition et causes. Dilatations de […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES D – EDécouvrez des maladies comme dépression, diabète, diabète de type 2, diarrhée, diverticulite, ebola, eczéma, embolie pulmonaire, emphysème, endométriose, epicondylite, epilepsie, erysipèle, escarre. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES D – E La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble des manifestations d’une maladie et des effets […]
- DICTIONNAIRE DES MALADIES ADécouvrez des maladies comme : acné, acouphènes, AIT, algodystrophie, allergies, anémie, angine, angine blanche, appendicite, arthrose, autisme, AVC, etc. santé tube vous propose une information validée sur plus de 2000 pathologies. Consultez votre dictionnaire de maladies. DICTIONNAIRE DES MALADIES A La pathologie est l’étude des maladies, de leurs causes et de leurs symptômes. Ensemble […]
